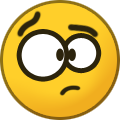-
Compteur de contenus
16 127 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
9
Tout ce qui a été posté par alexandreVBCI
-

Décès du général Marcel Bigeard
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Suchet dans Histoire militaire
Les cendres du commandant héroïque de Dien Biên Phù reposeront aux côtés des grands noms de l'armée française. Le ministère de la Défense a annoncé jeudi que les cendres du général Marcel Bigeard seront transférées à l'Hôtel des Invalides, à Paris. Décédé le 18 juin 2010 à l'âge de 94 ans, Marcel Bigeard souhaitait que celles-ci soient dispersées au-dessus de Dien Biên Phù, au Vietnam, pour «rejoindre ses camarades tombés au combat» en mai 1954. Face au refus des autorités vietnamiennes, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, avait adressé une lettre à la fille du général, Marie-France, pour lui proposer que les cendres de son père soient transférées aux Invalides, lieu de repos des grands noms de l'armée française. A ce jour, la date de ce transfert n'a pas encore été déterminée. Un personnage historique de l'armée française Elevé à titre posthume à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur française par Nicolas Sarkozy en 2011, le général Bigeard est considéré par les militaires comme le dernier personnage héroïque de l'armée française. Baroudeur des guerres coloniales, Commandant du 6e bataillon de parachutistes coloniaux, il avait résisté jusqu'à la chute de Dien Biên Phù, avant d'être détenu six mois par l'armée Vietminh. Marcel Bigeard a également mené une carrière politique. Le général avait occupé la fonction de secrétaire d'Etat à la Défense durant 18 mois de 1975 à 1976 sous la présidence de Valery Giscard d'Estaing avant d'être élu député de Meurthe-et-Moselle de 1978 à 1988. -

SMX-25 de Naval Group et autres navires submersibles
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de LBP dans Europe
Il y a 40 ans on avait le courage de lancer des programmes de rupture comme le concorde ou le TGV, mais aujourd'hui il n'y a aucune chance que l'on se lance sur une production de SMX-25. Trop futuriste pour le pouvoir politique et la marine. -

énergie Energies renouvelables : projets et conséquences
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Economie et défense
Après les verts et le PS, c'est au tour de l'UMP de présenter un plan pour le développement des énergies renouvelables : «Un rendez-vous programmatique majeur». C'est Jean-François Copé qui l'affirme: le développement durable tient à cœur à l'UMP, qui compte bien s'appuyer sur les bases du Grenelle de l'environnement pour son programme 2012. La «convention développement durable» du parti présidentiel, présentée ce jeudi, accorde une large part à la création de filières industrielles vertes, notamment dans les énergies renouvelables. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-voix du volet vert du programme de l'UMP, le développement des énergies renouvelables doit passer en premier lieu par la création de filières industrielles, «sinon cela reviendrait à importer des produits chinois», a déclaré la ministre de l'Environnement mercredi, lors de la présentation de la convention à la presse. En s'appuyant sur les marchés publics et en développant la formation d'ingénieurs spécialisés, le programme de l'UMP propose ainsi de développer des «filières vertes françaises intégrées»: «A titre d'exemple, une filière complète en matière de photovoltaïque irait de la production de panneaux en France jusqu'au recyclage des panneaux usagés.» Une approche que Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) estime positive: «Il faut développer les énergies renouvelables chez nous, mais il faudrait aussi nous dire comment on fait, estime-t-il. Il manque une boite à outils avec les différentes procédures administratives et les moyens incitatifs nécessaires, notamment les tarifs d'achats ou les procédures d'appels d'offres.» -
Tiens ça me donne une idée : "un leclerc offert pour un Rafale acheté !" comme ça on règle deux problèmes en un coup : on vend notre zinc et on se débarrasse des leclerc invendables en stock ! :P
-

USA
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
Le pouvoir des lobbys est toujours aussi puissant. "L'industrie agroalimentaire vient de marquer un point important aux États-Unis et de montrer combien elle pèse, en l'occurrence face à la lutte contre le surpoids des jeunes engagée par l'administration Obama, et notamment par Michelle, la femme du président américain. Le pouvoir espérait bien éliminer les pizzas et les frites des repas des enfants. Le Congrès - largement encouragé par l'Institut américain des aliments surgelés - pourrait en décider autrement en décrétant que le concentré de tomates présent en mince couche sur le lit de pâte des pizzas permet à cet aliment d'entrer dans la catégorie des légumes." oui, vous avez bien lu, le Congrès américain considère que la pizza est un légume. Sans la moindre honte. Avec une telle corruption au Congrès, comment compte-t-ils réglés le problème de la dette sans que le lobby de l'armement s'oppose aux réductions de budgets ? -
La dette de l'Etat fédéral américain dépasse 15 000 milliards de dollars depuis mardi, selon des chiffres publiés mercredi par le département du Trésor, au grand dam de nombre de républicains qui font porter toute la responsabilité à l'administration Obama. Elle atteignait ce jour-là 15 033,6 milliards de dollars à la clôture des comptes quotidiens du Trésor, soit 55,8 milliards de plus que la veille, a indiqué le ministère. Cela correspond à 99 % du PIB américain prévu par la Maison Blanche pour l'ensemble de l'année 2011. Ces chiffres ont provoqué un déchaînement de réactions chez nombre d'élus républicains qui ont incriminé Barack Obama. 'Ce chiffre marque un jour infâmant pour l'histoire américaine. Vous méritez des dirigeants qui s'attaquent vraiment au problème', a déclaré sur Twitter Paul Ryan, président de la commission de la chambre sur le budget. La candidate ultraconservatrice à la présidentielle américaine de 2012, Michele Bachmann, a estimé mercredi que les Etats-Unis sont comparables à un bateau qui va tomber dans les chutes du Niagara. 'Ce qui a changé c'est la rapidité de la dette', a-t-elle ajouté, en notant que lorsqu'elle était entrée au Congrès comme représentante en janvier 2007, la dette américaine était à 8 600 milliards de dollars. Rick Perry, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre 2012, a dénoncé 'la politique socialiste d'Obama qui ruine le pays'. Le gouverneur du Texas a affirmé sur Twitter qu''il était temps de réformer Washington'. 'L'Amérique vient de passer un cap inimaginable : notre dette dépasse 15 000 milliards de dollars. Cela fait plus de 48 000 dollars par Américain', a tonné Reince Priebus, président du comité national du Parti républicain. Le sénateur Mitch McConnell a ajouté dans un communiqué : "Nous avons une dette qui pèse autant que notre économie. Cela nous fait beaucoup ressembler à la Grèce", a-t-il déclaré. Le franchissement à la hausse du seuil des 15 000 milliards de dollars a eu lieu alors que la Commission mixte du Congrès pour la réduction du déficit budgétaire peine à parvenir à un accord qui définirait des économies budgétaires d'au moins 1 200 milliards de dollars cumulés sur dix ans. Faute d'accord d'ici au 23 novembre, la loi prévoit la mise en œuvre automatique, à partir de 2013, de réductions des dépenses de l'Etat d'un total de 1 200 milliards de dollars sur dix ans, réparties à part égale entre les dépenses de défense et le reste des dépenses. La dette publique américaine avait franchi à la hausse le cap des 10 000 milliards de dollars en septembre 2008. Depuis cette date, les Etats-Unis accumulent 1 000 milliards de dette supplémentaire tous les sept mois et demi en moyenne. Dans son dernier Moniteur des finances publiques publié en septembre, le Fonds monétaire international (FMI) estime que la dette publique des Etats-unis devrait atteindre 100 % du PIB à la fin de l'année, 105 % en 2012, et continuer de progresser jusqu'à 115 % en 2016.
-

Emeutes et évolutions dans le monde Arabe
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Koweït: des milliers de manifestants envahissent le Parlement Ils ont pénétré dans la salle principale pour réclamer la démission du Premier ministre. Depuis plusieurs semaines, un scandale de corruption agite la monarchie. Des milliers de manifestants ont envahi ce mercredi le bâtiment du Parlement à Koweït, après que les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation réclamant la démission du Premier ministre, a annoncé un député de l'opposition. "Nous sommes entrés à présent dans le Parlement", a déclaré le député Moussallam al-Barrack qui avait pris la tête de la manifestation avec d'autres parlementaires et militants qui demandaient également la dissolution du Parlement. Ces violences interviennent alors qu'un scandale de corruption agite la monarchie pétrolière depuis plusieurs semaines. Selon la presse, des députés pro-gouvernementaux ont reçu des centaines de millions de dollars de pots-de-vin. La révélation de ce scandale a entraîné une forte mobilisation de l'opposition contre le gouvernement de cheikh Mohammad Nasser, un neveu de l'émir. (AFP) -

budget Les budgets militaires en Europe vont-ils souffrir de la crise ?
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de S-37 Berkut dans Economie et défense
La crise économique atteint les budgets de défense. Le Parlement sonne l’alarme. Quel impact la crise économique a sur les budgets de défense ? La question hante tous les militaires et les industriels du continent. Sans aucune exception. Car aucun pays ne semble épargné par les reports ou suppressions d’investissements, fermeture de casernes, diminution des effectifs quand ce n’est pas le licenciement sec ou la fin de contrats de plusieurs centaines de militaires, civils ou contractuels, sans oublier les répercussions pour l’emploi dans l’industrie. La question suscite aussi de l’inquiétude au Parlement européen qui doit adopter un rapport d’initiative, préparé par le polonais de la plate-forme civique, Krzysztof Lisek, et qui sera adopté en commission ce 17 novembre (en plénière en décembre). Le parlement s’inquiète « des coupes sans précédent opérées dans les budgets de la défense, trop souvent mises en œuvre au coup par coup, avec peu ou pas de coordination avec les partenaires de l’UE ou de l’OTAN ». Ces coupes budgétaires non coordonnées « risquent d’entraîner la perte totale de certaines capacités militaires en Europe ». Un rappel au règlement Le Parlement s’alarme également de « l’actuelle dépendance disproportionnée vis-à-vis des États-Unis dans les affaires liées à la défense » Les USA contribuent à 75% des dépenses de défense totales de l’OTAN, précise-t-il. Les États membres dépensent collectivement environ 200 milliards d’euros par an pour la défense, « soit à peine un tiers du budget américain de la défense ». Il appelle ainsi tous les États membres de l’Union à « assumer pleinement leur part de responsabilité dans la paix et la sécurité de l’Europe, de son voisinage et du monde dans son ensemble ». Chaque Etat s’est engagé « dans le Traité et dans les conclusions du Conseil européen notamment, à renforcer leurs capacités militaires ». Seul moyen : changer de méthode, travailler plus en commun Pour les eurodéputés, la seule « façon d’aller de l’avant » repose sur « une coopération accrue ». Ils proposent de mettre en place une nouvelle démarche : une meilleure coordination de la planification de la défense, ce qui inclut l’harmonisation des exigences militaires, la mise en commun et au partage de certaines fonctions et moyens, une coopération améliorée dans la recherche et le développement technologique, la collaboration et de la consolidation industrielles, l’optimisation du processus de passation des marchés et à la suppression des entraves au marché. L’Union européenne ayant en la matière « des outils et des mécanismes qui peuvent aider les Etats membres à atteindre cet objectif », notamment en « identifiant les domaines qui pourraient bénéficier de fonds européens accrus ». Un semestre européen de la défense Le Parlement demande aux Etats de procéder à des « examens systématiques de la sécurité et de la défense selon des critères et un calendrier communs ». Mais pas seulement. Il veut aller plus loin et suggère d’en faire un « exercice régulier lié aux procédures budgétaires, à l’instar d’un « semestre européen » des examens de la sécurité et de la défense » à l’image de ce qui se fait en matière économique et sociale. Dans l’esprit des parlementaires, c’est l’Agence européenne de défense qui aurait un rôle moteur dans cet exercice. L’agence européenne de défense chargée de définir l’utile et l’inutile Dans une première étape, les États membres soumettraient « pour avis » leur projet d’examen de la sécurité et de la défense nationales à l’Agence, laquelle les évaluera à la lumière du plan de développement des capacités, des plans des autres États membres et des initiatives pertinentes de l’OTAN; estime qu’à très court terme, l’AED pourrait également jouer un rôle important dans la définition des priorités en matière de capacités et dans l’identification des « répétitions inutiles au niveau des capacités des États membres ». Supprimer le superflu La prochaine étape pourrait passer par « un processus de consultations mutuelles des États membres en vue d’harmoniser leurs exigences militaires ». Le Parlement estime que les États membres devraient profiter « de ce processus pour évaluer également les surcapacités existantes, surtout en ce qui concerne les ressources matérielles et humaines moins prioritaires sur le plan opérationnel ». La Mise en commun n’est plus un choix Le Parlement se montre « fermement convaincu que la mise en commun et le partage des capacités ne sont plus une option, mais une nécessité ». Il estime que plusieurs secteurs peuvent être au coeur de cette mise en commun : « le transport stratégique, du soutien logistique, la maintenance, les capacités spatiales, le soutien médical, l’éducation et la formation ». Tout comme les Etats ont intérêt à rechercher en commun comment résoudre les déficits de capacités : le ravitaillement en vol, la surveillance maritime, les véhicules aériens sans pilote (UAV), la protection CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire), la lutte contre les engins explosifs improvisés, la communication satellitaire, les capteurs et plateformes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) et les systèmes de combat et d’information. Plusieurs modèles existent pour cette coopération, détaille le rapport qui ne se contente pas de généralités mais donne quelques exemples concrets qui pourraient/devraient être mis en coopération : - la propriété conjointe (à l’image de Galileo, par exemple les capacités spatiales, les drones, les avions de transport stratégique) ; - la mise en commun de moyens détenus nationalement (à l’image de l’EATC, par exemple hélicoptères de transport, les avions de patrouille maritime et les moyens d’évacuation par mer) ; - la mise en commun de l’acquisition de biens (à l’image de l’A400M) ; - le partage des rôles et des tâches (par exemple, les académies militaires, les installations d’essai et d’évaluation et des installations de formation des pilotes, les unités CBRN les avions sanitaires). Passer des alliances La coopération peut passer par des alliances bilatérales. A l’image de l’accord franco-britannique, les eurodéputés pourraient appeler au lancement d’autres projets de coopération, notamment parmi les pays du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Rép. Tchèque et Slovaquie). Mais, plus généralement, les Etats doivent « exploiter le potentiel offert par l’Agence en termes de soutien administratif et juridique et à lui confier la gestion de leurs initiatives de coopération ». Miser sur la recherche et le technologie (R&T) Les parlementaires estiment que les États membres devraient « exclure absolument la R&T de leurs coupes budgétaires ». Ils esitment qu’un certain nombre de projets (protection CBRN, avions ou bateaux sans pilote, surveillance maritime, cyberdéfense, lutte contre les IED…) ont des aspects civils comme militaires et souhaiteraient que l’agence européenne de défense et la Commission européenne travaillent ensemble. Trouver de nouveaux financements L’objectif est de pouvoir utiliser davantage les fonds européens, en les fléchant davantage vers des projets de défense. Il faut d’ailleurs « trouver de nouvelles formes de financement européen » dans le prochain cadre financier pluriannuel. Le programme Erasmus militaire devrait ainsi pouvoir être financé par le budget européen à l’image de son grand frère civil. Un quartier général est nécessaire Enfin, ce n’est pas la première fois que les parlementaires le disent. Mais ils enfoncent, à nouveau, le clou en axant. « La création d’un quartier général de l’Union européenne ne renforcerait pas seulement la capacité de l’Union à soutenir la paix et la sécurité internationales, mais entraînerait également à long terme des économies pour les budgets nationaux grâce à la mise en commun et au partage ». Et le rapport d’appeler la Haute représentante « explorer les options juridiques existantes pour établir une capacité européenne permanente de planification et de commandement militaires de ce type ». (bruxelles2.eu) -

[Union Européenne] nos projets, son futur
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
Un pas vers le fonds européen pour la démocratie. Objectif : soutenir la transition démocratique dans les pays du voisinage, de l’Algérie à la Biélorussie, en passant par l’Egypte, l’Autorité palestinienne, la Géorgie ou l’Azerbaïdjan. Cette création pourrait approuvée par les ministres des Affaires étrangères, le 1er décembre. Cette proposition figurait dans la communication de la Commission sur la politique du voisinage, publiée en mai dernier. Et les ministres avaient endossé cette idée en juin. Mais uniquement sur le principe. L’idée du Fonds européen de la Démocratie est portée par la présidence polonaise de l’Union européenne – soutenue par Prague et Stockholm – qui ne ménage pas ses efforts en ce sens. Elle part du principe que l’Instrument « pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde » est trop lourd pour pouvoir s’adapter à toutes les situations. Ce fonds bénéficierait d’un apport du budget communautaire mais aussi d’autres contributions, des Etats membres comme d’autres Etats hors UE. A Varsovie, on espère des contributions de pays proches comme la Norvège. Trois thinks tanks se sont regroupés pour présenter des propositions pour la coopération en matière de défense dans le cadre du triangle de Weimar (France, Allemagne, Pologne). Jean-Pierre Maulny (IRIS), Marcel Dickow et Hilmar Linnenkamp (SWP), et Marcin Terlikowski (PISM) viennent de publier « Weimar Defence Cooperation – Projects to Respond to the European Imperative » Document qui a fait l’objet d’une discussion à Varsovie lundi (14 novembre). Ces trois centres de recherche ont voulu montrer trois projets concrets – hors ceux déjà engagés (comme les hélicoptères) – qui permettraient aux trois pays d’unir leurs efforts, à court, moyen ou plus long terme. Une initiative que je trouve très intéressante car loin des analyses générales, elle s’attache à trouver des projets concrets, à mettre en oeuvre plus en rapidement. Le renforcement des battlegroups est le premier d’entre eux. La création du Weimar Battlegroup à titre semi-permanent serait efficace, selon eux. Avec une spécialisation des fonctions : le soutien médical aux Français, la logistique aux Allemands, le système C3 (commandement, contrôle et communications) resterait effectué en coopération. Mais le but du trio de Weimar est d’avoir « des éléments intégrés pour bâtir graduellement une architecture C3 commune » dans le cadre du projet « battlegroup Plus ». On pourrait même envisager – explique un officiel polonais – que le commandement du FHQ à Ulm soit quasi-permanent. Les auteurs estiment que cette coopération devrait être supportée par un « petit secrétariat ». 2e projet : une plateforme commune pour les avions sans pilote (MALE). Projet d’avenir mais sensible quand on sait que les Français et Britanniques ont commencé une coopération sur le sujet. Mais l’utilité d’un UAV ne saurait se limiter aux aspects militaires. Il pourrait aussi être utile dans la sécurité : surveillance des frontières notamment (une étude de concept est déjà engagée sur ce point à l’agence européenne de défense) ou reconnaissance lors de catastrophes naturelles ou technologiques (on pense à l’accident nucléaire de Fukushima). Les « Weimar » pourraient introduire un propjet de recherche commun. 3e projet : les blindés. Sujet aussi épineux. On comptait jusqu’à peu 23 projets différents pour 27 Etats membres. Autant dire une pléthore qui ne pourra pas durer éternellement. Les Allemands veulent acheter le Puma, la France a développé le VCBI et la Pologne veut remplacer ses BMP1 post-soviétiques par un nouvel AFV. Mais personne ne semble vouloir renoncer à ce qui pourrait faire son industrie de demain. Le « terrestre » est un sujet auxquel tiennent les Polonais qui ont, eux aussi, une industrie qu’ils voudraient bien préserver. Là aussi il y a une opportunité, estiment les auteurs de la note. Le temps du « je peux le faire tout seul » paraît révolu. Les gouvernements du triangle de Weimar devraient proposer l’établissement d’un groupe de coordination stratégique sur les véhicules blindés, estiment les auteurs de la note. (bruxelles2.eu) -

[Somalie] Piège en haute mer pour des pirates au large
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Bill dans Actualités marines
Un dhow otage des pirates depuis 12 jours a été libéré par la corvette espagnole « Infanta Cristina – qui participe à l’opération anti-piraterie de l’UE (Eunavfor Atalanta). Les militaires espagnols avaient reçu pour consigne d’enquêter sur un bateau de pêche, repéré comme suspect car utilisé comme bateau-mère par les pirates. Arrivé à proximité, la conversation s’engagea avec les marins du dhow, le « Al Tahal » immatriculé aux Comores. Son capitaine confirma qu’il était bien sous le contrôle des pirates. Les Espagnols décidèrent de passer à l’action. Une équipe de Marines fut dépêchée. Les pirates ne demandèrent pas leurs restes et jetèrent rapidement leurs armes à la mer, selon la marine espagnole. Le capitaine du chalutier et l’équipage de 21 Pakistanais a été libéré. Ils avaient été capturés il y a douze jours, par deux skiffs composés de neuf pirates. Ceux-ci pourraient appartenir à un groupe d’action pirate qui écume la côte sud d’Oman depuis des semaines et est soupçonné d’être responsable de quatre attaques infructueuses contre les navires marchands. Les pirates ne seront pas poursuivis. Le capitaine du chalutier ayant renoncé aux poursuites, ils ont été débarqués par la marine espagnole sur les côtes somaliennes. >:( La frégate « Lübeck » part le 18 Novembre de sa base navale de Wilhelmshaven en direction de la Corne de l’Afrique pour rejoindre la force antipiraterie de l’UE (Eunavfor Atalanta). Placée sous le commandement du capitaine Martin Ruchay, elle devrait mettre environ 14 jours pour franchir la distance qui sépare l’Allemagne de Djibouti, où elle prendra le relais de la Frégate « Bayern ». Rappelons que c’est un officier allemand, le contre amiral Thomas Jugel, qui assure le commandement de la force européenne anti-piraterie, sur zone. Il cédera ses fonctions en décembre à un officier espagnol. -
Contre-productif : les réductions budgétaires en Grande-Bretagne ont conduit à une augmentation des couts Les réductions des dépenses militaires britanniques ont entraîné en un an une augmentation de 466 millions £ (545 millions €) du coût des 15 plus importants programmes militaires du pays, a révélé l’équivalent de notre Cour des Comptes. Le National Audit Office explique que la décision de retarder le programme des sous-marins Astute pourrait aussi avoir pour conséquence le manque de sous-marins d’attaque. Le NAO a effectué une mise à jour de l’état des 15 plus importants programmes d’armement de la Grande-Bretagne. Selon lui, les coûts ont continué à augmenter au cours de la dernière année. Les projets — de nouveaux sous-marins, avions de chasse, hélicoptères et destroyers — dépassent désormais de 6,1 milliards £ (7,1 milliards €) le budget qui avait été alloué lorsque ces programmes ont été officiellement lancés. Le retard cumulé de ces projets atteint maintenant près de 27 ans, indique le NAO dans son rapport. Au cours de la dernière année, les principaux facteurs ayant entraîné une augmentation des coûts, sont un retard de 12 mois sur le projet de drone Watchkeeper et la décision d’étaler à nouveau la construction des 7 sous-marins de la classe Astute. Cette dernière, explique le bureau, a encore augmenté les coûts de ce programme de 200 millions £ (234 millions €) qui viennent s’ajouter aux retards qui affectent ce programme depuis son lancement dans les années 90. Il a aussi averti que cette décision entraînerait un manque de sous-marins, et que le gouvernement pourrait devoir soit prolonger la vie des sous-marins existants, soit réduire leur activité programmée. http://www.corlobe.tk/article26621.html
-

Armée de l'air des E.A.U
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Libanais_75 dans Afrique / Proche Orient
Et les 2000-9 ils deviennent quoi si l'achat de Rafale tombe à l'eau ? -

La privatisation de la guerre
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Tancrède dans Histoire militaire
Oui, mais une démocratie (soumise à des règles et des contre-pouvoirs comme celui de la presse par exemple) est-elle apte à se battre face à un adversaire de type Zetas ou Talibans qui lui ne respecte aucune règle ? Là où une dictature peut utiliser la force brute pour réprimer un groupe criminel, une démocratie doit se battre avec les mains attachées dans le dos. La faiblesse d'une démocratie réside justement dans son obligation à contrôler (et par conséquent limiter) l'usage de la force. Sauf à utiliser des moyens parralèles comme des escadrons de la mort, paramilitaires, SMP... mais on ne règle pas un problème en en créant un autre ! -

Armée de l'air des E.A.U
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Libanais_75 dans Afrique / Proche Orient
Oui mais il y a un moment où il faut dire STOP. On fait une proposition et si elle n'est pas acceptée on arrête les frais. ça sert à rien de négocier avec un client qui demande l'impossible et se plaint en plus publiquement de ne pas l'avoir. On ne va pas voir un concessionnaire FERRARI et lui demander de baisser ces prix au niveau d'une LOGAN. -

USA
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est officiel : l'armée US s'installe en Australie. Les Etats-Unis vont renforcer leur présence militaire en Australie et comptent bien rester en Asie-Pacifique, "une région d'une importance stratégique immense", a annoncé mercredi Barack Obama, envoyant ainsi un signal clair à la Chine, qui n'a pas apprécié. Washington va déployer dans un premier temps 250 Marines dans le nord de l'Australie à partir de la mi-2012, afin de renforcer l'alliance militaire entre les deux pays, a précisé la Premier ministre australienne Julia Gillard, lors d'une conférence de presse conjointe. "Au fil des ans, nous entendons construire là-dessus, de manière planifiée", a-t-elle ajouté. Le nombre des Marines grimpera peu à peu jusqu'à 2.500. A Pékin, ce renforcement de la coopération militaire entre les deux alliés a été jugé "assez inopportun" par un porte-parole de la diplomatie chinoise. "Il est probablement assez inopportun d'intensifier et d'élargir des alliances militaires et cela ne semble pas être dans l'intérêt de cette région", a déclaré Liu Weimin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogé sur la question lors d'un point de presse régulier. "C'est tout à fait opportun", a rétorqué, à Canberra, Ben Rhodes, conseiller américain adjoint pour la sécurité nationale. Barack Obama a souligné que le développement de la coopération militaire et son voyage dans la région envoyaient un signal clair aux pays alliés de la zone Asie-Pacifique. "Nous sommes deux pays du Pacifique, et avec cette visite dans la région, je signifie clairement que les Etats-Unis renforcent leur engagement dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique", a-t-il dit. "Le second message que j'essaye de faire passer est que nous sommes là pour y rester", a-t-il encore dit. "Cette région a une importance stratégique immense pour nous. Même si nous prenons un ensemble de décisions budgétaires chez nous, (être présent en Asie-Pacifique) est tout en haut de ma liste de priorités". "Nous allons faire en sorte d'être en mesure de remplir notre rôle moteur dans la région Asie-Pacifique", a ajouté le président. Au moment où les forces américaines finissent de se retirer d'Irak et entament leur départ d'Afghanistan, les Etats-Unis veulent réorienter leur politique de sécurité vers l'Asie. Les troupes américaines seront affectées pour des périodes de six mois en Australie, sur des bases, et conduiront des exercices et des entraînements avec les soldats de ce pays. Barack Obama a souligné que son pays ne craignait pas la montée en puissance économique et militaire de la Chine et ne cherchait pas à exclure ce pays. "L'idée que nous craignons la Chine est une erreur. L'idée que nous cherchons à l'exclure est une erreur", a-t-il déclaré. Mais la Chine doit respecter les règles, a-t-il ajouté. "Nous sommes heureux de la montée en puissance d'une Chine pacifique. Ce qu'ils sont parvenus à accomplir, en sortant de la pauvreté des millions de personnes, est remarquable". "Le principal message que j'ai adressé à la Chine, en public et en privé, est que leur montée (en puissance) s'accompagne de responsabilités accrues", a-t-il ajouté. "Il est important pour eux qu'ils jouent selon les règles". -

Amérique latine : l'armée en guerre contre les cartels de drogue
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Mexique : les zones d'ombres de la lutte contre le narcotrafic : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/mexique-les-zones-d-ombres-de-la-lutte-contre-le-narcotrafic_1051385.html#xtor=AL-447- 635 réponses
-
- drogue
- criminalité
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-

Guerre civile en Syrie
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de maminowski dans Politique etrangère / Relations internationales
BEYROUTH (AP) — Des déserteurs de l'armée ont affirmé avoir lancé plusieurs attaques mercredi contre des bases militaires près de Damas, dont une structure des services de renseignements. Dans son communiqué, l'Armée Syrienne libre précise que sa principale offensive à l'aube a visé un complexe dirigé par les renseignements de l'armée de l'air, à Harasta, dans la banlieue de Damas. Les autres attaques étaient dirigées contre des points de contrôle militaires dans les banlieues de Damas, Douma, Qaboun et Arabeen et Saqba. Une figure de l'opposition, qui a souhaité rester anonyme, a confirmé que l'attaque à Harasta a été organisée par des déserteurs qui, répartis en trois groupes, ont attaqué le complexe avec des armes automatiques et des grenades. -

La privatisation de la guerre
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Tancrède dans Histoire militaire
Paradoxal non ? le plus grand danger d'une démocratie... c'est la liberté de la presse et des médias. La peur d'avoir les médias sur le dos et d'agir en public paralyse les gouvernements, ce qui accentue d'autant plus leur chute face à ceux qui, au contraire, revendique leur inhumanité. -

Un peu d'humour en images et vidéos !
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Mani dans Vidéos et Photos
Humour noir. Choississez la (les) cibles, le type d'arme nucléaire, votre ville.... http://www.wouldisurviveanuke.com/ -

[Afghanistan]
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de g4lly dans Politique etrangère / Relations internationales
Les « 27″ se sont entendus aujourd’hui (lundi 14 novembre) pour prolonger le mandat de la mission européenne de police en Afghanistan « jusqu’à la fin de 2014 ». Il s’agit d’un « accord de principe » ; il faudra ensuite le formaliser et définir éventuellement la modification du format de la mission. Les 27 ont également indiqué que l’UE avait la volonté de coopérer avec l’Afghanistan « au-delà de 2014 afin de soutenir les efforts déployés par ce pays pour renforcer le maintien de l’ordre et l’État de droit ». Mais les 27 ont aussi mis une condition, demandant au gouvernement afghan « d’assurer à la présence de l’UE (y compris EUPOL) en Afghanistan des conditions adéquates de sécurité ». Outre la mission EUPOL, l’UE mettra sur la table de la conférence de Bonn, le 5 décembre, une série de propositions et est prête à s’engager sur différents projets, « le cas échéant en coordination et en coopération avec les Nations unies et l’OTAN et d’autres enceintes internationales concernées », pour assurer « le renforcement des institutions de gouvernance afghanes ». - favoriser une meilleure surveillance de la part des organismes élus au niveau tant national qu’infranational, notamment en ce qui concerne les flux et l’utilisation des fonds publics; - aider l’Afghanistan à faire en sorte que les institutions au niveau provincial et national travaillent de concert, de manière efficace et transparente; - renforcer le rôle du parlement, du système judiciaire et des autorités chargées du contrôle des comptes; - œuvrer en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une attention particulière étant accordée aux femmes; - accroître l’aide qu’elle apporte au renforcement des capacités, entres autres dans les domaines de la gouvernance au niveau infranational, de la formation de fonctionnaires et de forces civiles de maintien de l’ordre, de la réforme du secteur de la justice et de la réforme électorale; - poursuivre la coopération au développement menée avec l’Afghanistan, en vue de favoriser le développement économique et social et de lutter contre la pauvreté. Il s’agit aussi « d’améliorer le cadre légal régissant les activités du secteur privé et notamment les investissements directs, en vue d’améliorer le climat général des investissements et, partant, de réduire autant que faire se peut les risques politiques ». Les 27 ont marqué leur accord pour préparer un accord de coopération « en matière de partenariat et de développement » avec l’Afghanistan. La Haute représentante, Catherine Ashton, a été mandatée pour ce faire. Le mandat qui lui est confié mentionne spécifiquement plusieurs secteurs : la coopération dans les domaines déjà évoqués (pour la conférence de Bonn) et une série d’autres domaines : le développement, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité internationale, la migration, les échanges, l’environnement y compris le changement climatique et la coopération sur le plan économique et culturel. « L’accord mettra en place, pour la première fois, un cadre global cohérent et juridiquement contraignant pour les relations entre l’UE et l’Afghanistan — indiquent les 27 —, dans lequel seront énoncées les valeurs communes ainsi que les droits et obligations réciproques des parties, concrétisant ainsi un engagement à long terme en faveur de la coopération avec l’Afghanistan à l’horizon 2014 et au-delà. » L’UE s’engage « à ce que le financement de ses programmes de coopération et d’assistance en faveur de l’Afghanistan et de la région – tant sur le plan bilatéral qu’au titre du budget de l’UE – soit maintenu, dans les années à venir, à un niveau au moins équivalent au niveau actuel ». (bruxelles2.eu) KABOUL (AP) — Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi qu'il avait approuvé l'octroi d'un prêt de près de 134 millions de dollars (98 millions d'euros) pour l'Afghanistan, en expliquant que le gouvernement de ce pays avait fait des progrès en matière de gouvernance. Depuis plus d'un an, Kaboul ne bénéficiait plus du soutien du Fonds monétaire international. Le FMI avait suspendu son programme de crédit en raison de la mauvaise gestion de la Banque de Kaboul -la plus grande institution financière privée du pays- qui était au centre d'une affaire de corruption. Le chef de mission du FMI en Afghanistan, Axel Schimmelpfennig, a observé mardi que le gouvernement afghan avait pris des mesures pour réduire les conséquences de ce scandale, et mettre en oeuvre des réformes bancaires et économiques. -

[Union Européenne] nos projets, son futur
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
Un « papier » est actuellement à l’étude au niveau européen, notamment à l’Etat Major de l’UE, afin d’étudier la possibilité d’éléments civils en liaison avec les battlegroups militaires. Une notion qui n’est pas nouvelle. Les Suédois avaient travaillé sur cette question en leur temps. Et les Polonais, plus récemment, avaient remis à leurs homologues, ministres de la Défense, un « non paper » présentant quelques évolutions sur les battlegroups. Cette note pourrait être examinée en novembre par les ministres de la Défense, le 30 novembre qui devraient donner des indications précieuses sur la future orientation du document. Cette première discussion permettrait à la structure de planification du service diplomatique (CMPD) de préparer une série de recommandations aux Etats membres et d’étudier les meilleures voies de coopération entre moyens civils et moyens militaires. Ce qui justifie cette évolution ? Selon ce que m’en a expliqué un responsable européen, « les retours d’expérience montrent bien combien il est nécessaire de préparer, le plus tôt possible, la transition dans une situation post-conflit ». La planification, anticipée, avec les civils de cette transition ; leur association aux battlegroups apparaît donc comme une nécessité. L’Etat-Major veut ainsi examiner les moyens d’embarquer des éléments civils ou, au minimum, d’assurer une meilleure liaison entre les militaires du battlegroup et les civils. Elle entend initier la rédaction d’une ligne directrice aux Etats fournissant des Battlegroups sur les conditions et le rôle potentiel de ces « composantes » civiles. Elle veut aussi démarrer le travail sur les formes possibles de coopération. La note envisage plusieurs possibilités. Tout d’abord la création d’une petite équipe de conseillers civils au sein du battlegroup ; des experts en protection civile, en police, reconstruction développement, Etat de droit, réforme du secteur de sécurité (SSR)… Cette équipe pourrait être incorporée dans la planification du battlegroup au sein du FHQ (le quartier général déployé sur zone) ou localisée au FHQ mais de façon autonome. Ensuite, l’adjonction au battlegroup d’une unité de police intégrée (FPU/IPU), permettant d’avoir des capacités supplémentaires en matière de maintien de l’ordre, de contrôle de la foule. Nb : ce type de solutions serait facilitée par l’existence dans plusieurs pays d’unités militarisées de maintien de l’ordre (gendarmerie, carabinieri, police militaire). Enfin, des « efforts » pourraient être faits par les Etats membres pour analyser la meilleure coopération possible entre les battlegroups et des capacités civiles de l’UE – en incluant au besoin les pools d’experts, préconstitués, autour de la SSR. Cette approche entend reprendre l’idée d’une extension des battlegroups vers les civils. Mais au lieu de plancher sur les utilisations possibles des groupements militaires dans des interventions mixtes (lors de catastrophes naturelles par exemple), il se penche sur les moyens de liaison civils qui pourraient être utiles au battlegroup. Ce qui, assurément, est plus facile à accepter et mettre en place par les différents Etats membres. Comment stopper la démilitarisation de l’Europe, c’est le sens de cette note du think tank européen EFCR, rédigé par Nick Whitney, bien connu de blog. Il a été le directeur de l’agence européenne de défense après avoir officié au Foreign office et au ministère de la Défense britannique où il était en charge, justement du département OTAN et UE. Prenant appui sur les derniers mots de Robert Gates avant son départ, mettant en garde les Européens, il prône la mise en place d’une « Europe Defense Review » pour renouveler leur vision stratégique pour le 21e siècle avant qu’il ne soient trop tard. Le coupe-coupe financier est en effet à l’oeuvre dans plusieurs pays mais de façon très variable. La Lettonie ou la Bulgarie voient leur budget fondre de plus d’un quart tandis que la Pologne ou la Suède continuent d’avoir un budget croissant (légèrement). Mais les Européens continuent de dépenser plus que la Russie et la Chine combinées. Seulement personne n’a peur de l’Europe… Paradoxalement la mise en place d’un chef pour la politique étrangère et d’un service diplomatique a paradoxalement été accompagné d’un quasi-arrêt (near collapse) des efforts européens pour forger une politique de défense et de sécurité commune. Une PSDC « missing en action » durant la crise libyenne. « Ce qui est inquiétant, ce n’est pas tant les coupures budgétaires que la manière dont elle sont faites » constate Nick. C’est-à-dire : « sans aucune tentative de consultation ou de coordination au sein de l’OTAN comme de l’UE et sans un regard vers la capacité de défense génère qui pourrait résulter de la somme de ces décisions nationales ». « Un tel autisme suggère un manque profond d’analyse du contexte stratégique plus large et rappelle combien les dépenses de défense des Européens sont un gâchis entre les duplications non nécessaires ou la poursuite d’objectif qui n’ont que peu à voir avec l’équipement et l’efficacité des forces armées (comme la politique régionale ou d’emploi, les politiques industrielles… ). » Mais l’intérêt de cette note me semble être ailleurs. Nick Whitney s’attache tout d’abord à expliquer : pourquoi les Européens en sont arrivés là ; pourquoi l’engagement militaire est toujours nécessaire. Sa note est donc importante tant pour les Européens que pour les Américains qui ont parfois du mal à comprendre notre continent. Il cerne ainsi un certain pacifisme ambiant, le non-résultat des interventions en Afghanistan. Mais met surtout l’accent sur un point : l’Européen ne ressent pas de menace militaire. « Il comprend le besoin d’une police de l’air ou de la mer. Il admire ses forces spéciales. Il veut que son gouvernement ait la capacité d’extraire quelques citoyens au large d’une plage dans un conflit civil en Afrique. (…) Mais le contribuable européen n’est simplement pas préparé à accepter pour préserver un certain noyau de capacités à dépenser environ 31% des dépenses US ou garder 1,6 millions personnes sous l’uniforme ». Le manque d’appétit pour l’interventionnisme est indéniable. Il est étayé par certains exemples passés. L’intervention de l’Irak sans soutien onusien n’est pas un parfait exemple. Quant à l’intervention en Afghanistan, elle ne paraît pas avoir donné les résultats espérés, du moins dans l’opinion publique. « quatre Européens contre un seulement estiment que l’intervention en Afghanistan a rendu leur pays plus vulnérable au terrorisme et une claire majorité veut retirer ses troupes ». « Si beaucoup ont estimé que c’était « une réponse nécessaire au 11 septembre », sa prolongation « métastasique en un futile exercice de nation-building qui dure depuis 8 ans a « démontré au moins pour l’Afghanistan que ce n’était pas faisable ». (bruxelles2.eu) -

[Somalie] Piège en haute mer pour des pirates au large
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Bill dans Actualités marines
Les gardes privés sur les navires néerlandais, c’est non. De façon solennelle, et tout à fait publique, le cabinet (le gouvernement) a rappelé que « l’utilisation de la sécurité privée contre les pirates est interdite ». Ce faisant, les Pays-Bas s’inscrivent dans une option radicalement contraire à celle choisie par certains pays européens – comme le Royaume-Uni ou l’Italie – mais très proche, somme toute de la position allemande. Les Néerlandais ont en revanche décidé d’accentuer leurs efforts pour protéger leurs navires marchands les plus vulnérables. Ainsi que l’avaient souhaité plusieurs partis politiques, le débat à la 2e chambre, tenu jeudi (10 novembre), a permis d’avancer sur plusieurs pistes contre la piraterie. Le nombre d’équipes de protection embarquées (VPD) va être augmenté, passant de 20 à 50 dans le courant 2012. Un nombre fixé « en fonction du budget disponible », a précisé le ministre de la Défense Hans Hillen. Mais si plus de VPD « s’avèrent nécessaires », une réévaluation de ce nombre pourrait être effectuée. Quant à l’utilisation d’hélicoptères Apache à bord des navires de la Marine royale engagés au large de l’Océan indien, l’option n’est pas fermée. Au contraire, elle va être « examinée attentivement ». (bruxelles2.eu) -

terrorisme Somalie : Affrontements, djihad et terrorisme
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de lefoudeladefense dans Politique etrangère / Relations internationales
Plus de deux ans après les premières réflexions sur la nécessité de travailler en profondeur contre la piraterie, la mission de renforcement des capacités maritimes des pays bordant l’Océan indien pourrait connaître sa première étape officielle… bientôt. Après maintes hésitations, les ambassadeurs de l’UE se sont mis d’accord sur le format de cette mission. Lundi, les ministres des Affaires étrangères ont reconnu la nécessité de « continuer le travail » pour renforcer les capacités maritimes des Etats de la région. Cette mission, dénommée RMCB selon son nom de code abrégé, devrait être une mission civile, menée en étroite liaison avec le commandement de l’opération anti-piraterie Eunavfor Atalanta. Une issue… rationnelle. Une mission civile permet de payer les effectifs sur budget européen, une mission militaire aurait obligé les Etats membres à mettre la main à la poche. Cette mission se dirigerait dans deux directions : établir une police côtière dans les différents Etats somaliens, particulièrement au Puntland ; il ne s’agit pas de gardes-côtes en tant que tel mais de pourvoir les Somaliens en formation, moyens et outils, pour agir « à terre » contre les pirates. La deuxième piste est de permettre de renforcer les capacités maritimes des autres Etats du pourtour de l’Océan indien et du bassin somalien. Un concept de gestion de crises (CMC) pourrait être soumis aux Ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion du 1er décembre. Ce qui permettrait de lancer le processus de planification plus complet (Conops, etc.) jusqu’au lancement de la mission qui pourrait avoir lieu – si tout va bien – au cours du 1er semestre 2012. Silencieusement, la mission européenne de formation des soldats somaliens (EUTM) déployée continue son travail. Une formation de 626 soldats et 40 sous-offs somaliens démarre en Ouganda le 21 novembre. Ils sont tous arrivés – ou en voie de l’être – au camp de Bihanga à l’ouest de l’Ouganda. Objectif des Européens : former et entraîner 4 compagnies, avec des spécialités bien identifiées (soutien médical, déminage, transmissions…) qui pourront être à pied d’oeuvre dans la 2e partie de 2012. Pour la première fois, se réjouit-on au commandement d’EUTM, il y a des hommes venus du Puntland et du Galmudug, et non pas seulement de Mogadiscio, ce qui est encourageant pour le futur. En revanche, point ou très peu d’hommes venus du Somaliland. Cette région du nord de la Somalie choisit, de plus en plus, la voie d’une indépendance vis-à-vis du gouvernement central. (bruxelles2.eu) -

Frappes sur la Libye, le sujet officiel!
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de Fenrir dans Politique etrangère / Relations internationales
Alors que l’opération de l’Otan a officiellement pris fin le 31 octobre dernier, on commence à y voir plus clair sur l’ampleur de la dispersion de l’arsenal d’armes accumulé par le régime Kadhafi. On se souvient que, lors d’une récente conférence de presse, l’amiral Giampaolo di Paola, à la tête du Comité militaire de l’Otan, avait appelé le CNT à lutter contre cette prolifération et exprimé sa préoccupation quant à la perte de près de 10 000 missiles sol-air et leur éventuelle utilisation au profit d’AQMI. La revue de détail du matériel disparu est éloquente et particulièrement préoccupante, bien que l’absence d’un recensement centralisé entre les différentes factions libyennes incite à la prudence. Par ailleurs, des sources bien informées estiment que peu de systèmes parmi les plus sophistiqués seraient encore opérationnels, du fait des intempéries et du manque d’entretien. Tout d’abord, cinq missiles Scuds, qui devaient être transférés vers le nord du pays par le CNT après avoir été «refuellés» (remplissage du réservoir de propulsion liquide), auraient disparu. L’un d’entre eux a été abandonné sur une piste, suite à une panne du porteur. D’autre part, les dépôts de la région d’Ajdabiya (proche de Benghazi) ont été partiellement vidés quelques jours avant l’attaque finale. Ce sont ainsi plus de 80 tonnes de munitions qui auraient été chargées sur quatre gros porteurs vers une destination inconnue. Pour ce qui est des systèmes sol-air, plusieurs missiles SA-24S Igla (Manpads) ont disparu aux abords de l’aéroport de Syrte, lors de sa libération ces derniers jours. Plusieurs dizaines de caisses vides de SA-7 sont, par ailleurs, empilées dans les bunkers à Zintan (proche de la frontière tunisienne). Des tonnes de munitions, dont des missiles S75 Dvina de SA-2, et des munitions d’artillerie sont à l’abandon dans plusieurs dépôts inspectés par les Nations unies, mais non gardés par le CNT. Quant aux armes autrefois fournies par la France, notamment entre 1979 et 1982, là aussi plusieurs auraient disparu : des postes de tir de Milan F3 (marquages français et allemands), des obus de 90 mm pour AML 90, des roquettes sol-air de 57 mm, des roquettes antichars de 89 mm. Plus inquiétant encore, on évoque également l’évanouissement dans la nature de munitions d’artillerie HE de 155 mm, et plus étonnant, la découverte de véhicules d’artillerie autoportée US M109 du même calibre. Sur le plan naval, des dizaines de torpilles air-mer italiennes ainsi que des mines marines Manta et leurs copies iraniennes ont été découvertes puis dispersées. La résolution 2017 de l’Onu, proposée par la Russie et adoptée le 1er novembre dernier, vise d’ailleurs à inciter les autorités libyennes à empêcher la prolifération d’armes, en particulier les missiles sol-air portables (Manpads) dans la région du Sahel et au-delà. Pas sûr que cela suffise. La crainte se porte particulièrement sur la sécurité des aéroports africains, d’une importance stratégique dans certains pays enclavés. Des pilotes de certaines compagnies aériennes auraient déjà manifesté leur inquiétude, que l’arrivée de matériel destiné à la protection aéroportuaire aurait calmée. L’enjeu sous-jacent est évidemment une éventuelle course à l’armement dans la sous-région, conséquence de l’utilisation de ces matériels par les mouvements rebelles en guerre contre les pouvoirs centraux au Mali et au Niger, notamment les Touaregs, dont beaucoup ont soutenu jusqu’au bout le régime Kadhafi. Certains craignent, aujourd’hui, que le désert du sud libyen se transforme en “supermarché”, en attirant des groupes venus des régions environnantes, auxquels les anciens mercenaires de Kadhafi tenteraient de vendre les stocks d’armes redescendus de Libye. A cela s’ajoutent les rumeurs autour d’un éventuel “trésor” (essentiellement de l’or) appartenant au leader libyen déchu, que ses hommes auraient déplacé dans le désert. http://www.ttu.fr/le-%e2%80%9csupermarche%e2%80%9d-sahelien -

Guerre civile en Syrie
alexandreVBCI a répondu à un(e) sujet de maminowski dans Politique etrangère / Relations internationales
Avant c'était l'armée qui attaquait les déserteurs, maintenant c'est les déserteurs qui attaquent l'armée... on fait des progrès ! :lol: Le régime peut-il tenir encore espérer reprendre le contrôle du pays ou la situation est-elle allée trop loin pour ne pas finir par la chûte de Bachar al-Assad ? votre avis ?