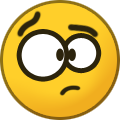-
Compteur de contenus
25 566 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Wallaby a gagné pour la dernière fois le 29 novembre 2025
Wallaby a eu le contenu le plus aimé !
Réputation sur la communauté
23 665 ExcellentÀ propos de Wallaby
- Actuellement Regarde le sujet « Danemark »
Profile Information
-
Gender
Not Telling
-
Pays
France
Visiteurs récents du profil
-

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.economist.com/europe/2026/01/22/europes-five-stages-of-grief-for-the-transatlantic-alliance Les cinq étapes du deuil européen pour l'alliance transatlantique Du déni à la négociation, puis à l'acceptation que le monde a changé En 2025, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la question était de savoir si l'Europe pouvait se défendre sans l'Amérique, une perspective effrayante compte tenu des ambitions de la Russie sur le continent. Aujourd'hui, en 2026, une question autrefois hérétique préoccupe les Européens : que devront-ils faire un jour pour se défendre contre l'Amérique ? En juillet, l'UE a signé un accord commercial déséquilibré avec les États-Unis, acceptant de payer des droits de douane sans en imposer à son tour. Pour de nombreux Européens, cela ressemblait davantage à une capitulation qu'à une négociation. Ce qui a peut-être été le plus déprimant pour beaucoup d'Européens, c'est de réaliser que les Français avaient eu raison depuis le début. Depuis Charles de Gaulle, leurs présidents ont dénoncé la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Emmanuel Macron a déclaré la « mort cérébrale » de l'OTAN en 2019. La plupart des Européens ont ricané plutôt que de prendre cela au sérieux. -

Groenland: l'enjeu Europe - Etats-Unis
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Janus dans Politique etrangère / Relations internationales
Oui les Américains sont une plus grande menace que les Russes. Les Russes ne s'attaquent pas à des pays membres de l'OTAN. Les Russes respectent l'OTAN. Pas les Américains. Mark Galeotti : En fait, je pense qu'ils [les Russes] considèrent l'OTAN comme une alliance défensive très puissante, à juste titre : il convient de noter qu'après tout, l'OTAN européenne a plus de troupes que les Russes, même sans inclure les Canadiens et les Américains, et la plupart de ces troupes sont plutôt de meilleure qualité. -

Groenland: l'enjeu Europe - Etats-Unis
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Janus dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.france24.com/fr/europe/20260122-espionnage-bluetooth-danemark-tensions-etats-unis-services-securite-trump-groenland Le service de renseignement danois a conseillé, lundi 19 janvier, aux autorités et à la police du Danemark de désactiver le Bluetooth sur leurs smartphones, tablettes et tous les autres périphériques. Les failles de sécurité de cette très populaire technologie de communication sans fil les inquiètent, surtout dans le contexte des tensions avec le président américain Donald Trump au sujet du Groenland. Mais il y aura probablement des collaborations qui n’auront plus lieu. Ainsi, au début des années 2010, les services de renseignement danois avaient aidé les Américains à espionner la chancelière allemande Angela Merkel. -

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html (19 septembre 2000) Ambrose Evans-Pritchard à Bruxelles Des documents déclassifiés du gouvernement américain révèlent que les services de renseignement américains ont mené une campagne dans les années 50 et 60 afin de créer une dynamique en faveur d'une Europe unie. Ils ont financé et dirigé le mouvement fédéraliste européen. Ces documents confirment les soupçons exprimés à l'époque selon lesquels les États-Unis œuvraient activement en coulisses pour pousser la Grande-Bretagne à rejoindre un État européen. Un mémorandum daté du 26 juillet 1950 donne des instructions pour mener une campagne visant à promouvoir un parlement européen à part entière. Il est signé par le général William J. Donovan, chef de l'Office of Strategic Services américain pendant la guerre, précurseur de la CIA. Ces documents ont été découverts par Joshua Paul, chercheur à l'université de Georgetown à Washington. Ils comprennent des dossiers rendus publics par les Archives nationales américaines. Le principal outil utilisé par Washington pour façonner l'agenda européen était l'American Committee for a United Europe (ACUE, Comité américain pour une Europe unie), créé en 1948. Son président était Donovan, qui était alors officiellement avocat privé. Le vice-président était Allen Dulles, directeur de la CIA dans les années 50. Le conseil d'administration comprenait Walter Bedell Smith, premier directeur de la CIA, ainsi qu'une liste d'anciens membres et responsables de l'OSS qui ont rejoint puis quitté la CIA. Les documents montrent que l'ACUE a financé le Mouvement européen, la plus importante organisation fédéraliste de l'après-guerre. En 1958, par exemple, il a fourni 53,5 % des fonds du mouvement. La Campagne européenne de la jeunesse, une branche du Mouvement européen, était entièrement financée et contrôlée par Washington. Le directeur belge, le baron Boel, recevait des versements mensuels sur un compte spécial. Lorsque le chef du Mouvement européen, Joseph Retinger, d'origine polonaise, s'est insurgé contre ce degré de contrôle américain et a tenté de lever des fonds en Europe, il a été rapidement réprimandé. Les dirigeants du Mouvement européen – Retinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak – étaient tous considérés comme des mercenaires par leurs sponsors américains. Le rôle des États-Unis était mené comme une opération secrète. Le financement de l'ACUE provenait des fondations Ford et Rockefeller ainsi que de groupes d'entreprises étroitement liés au gouvernement américain. Le directeur de la Fondation Ford, l'ancien officier de l'OSS Paul Hoffman, a également occupé le poste de directeur de l'ACUE à la fin des années 50. Le département d'État a également joué un rôle. Une note de service de la section européenne, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre secrètement l'union monétaire. Il recommande de suspendre le débat jusqu'à ce que « l'adoption de telles propositions devienne pratiquement inévitable ». -

Le Conseil de la Paix ( Board of Peace ) de Donald.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de ksimodo dans Politique etrangère / Relations internationales
Tout à fait. Pour les gens qui n'auraient pas déjà vu cette référence, c'est la théorie de Goddard et Newman partagée ici : https://forum.air-defense.net/topic/20791-politique-%C3%A9trang%C3%A8re-des-usa/page/39/#comment-1867584 -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est formidable. Bravo! Et cela donne à la France, mais pas seulement : à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce ou au Portugal, et pourquoi pas à l'Allemagne, la liberté de penser qu'elle a peut-être d'autres priorités que l'Ukraine. Cela débloque les blocages de la pensée. Au moins Zelensky est pas bloqué, lui. Il n'est pas dans la logique : "on ne peut rien faire tant que le Groenland n'est pas réglé". Il va de l'avant, il fait des trucs. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/live/2026/01/22/en-direct-guerre-en-ukraine-volodymyr-zelensky-reproche-a-une-europe-fragmentee-son-manque-de-volonte-politique-a-l-egard-de-la-russie_6663004_3210.html EN DIRECT, guerre en Ukraine : Zelensky dit avoir un accord avec Trump sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine, mais la question des territoires de l’Est n’est « pas encore résolue » Donc Zelensky n'en a rien à faire du Groenland, ça ne l'empêche pas de signer des deals avec Trump. -

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
Est-ce que l'euro numérique ne pourrait pas nous offrir l'équivalent de ce qu'ont les Brésiliens avec Pix ? -

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Kashiwazaki-Kariwa : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/01/22/au-japon-le-redemarrage-de-la-plus-grande-centrale-nucleaire-du-monde-suspendu-quelques-heures-apres-le-debut-du-processus_6663626_3244.html « une alarme du système de surveillance liée aux barres de contrôle s’est déclenchée pendant les procédures de démarrage du réacteur » -

Le Conseil de la Paix ( Board of Peace ) de Donald.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de ksimodo dans Politique etrangère / Relations internationales
À propos de Tony Blair, je rappellerai juste ceci : -
https://edition.cnn.com/2026/01/21/business/davos-two-problems-nightcap (21 janvier 2026) Il existe une autre force, bien plus complexe, qui menace de déstabiliser l'ordre mondial : l'économie en forme de K. Ce terme, popularisé par l'économiste Peter Atwater [1], fait référence à la fracture croissante, apparue en 2020, entre les nantis et les démunis. Si la pandémie a touché tout le monde en même temps, la reprise après ce choc s'est déroulée selon deux voies divergentes, les riches s'enrichissant et les pauvres s'appauvrissant. Près de six ans plus tard, l'écart entre le haut et le bas du K continue de se creuser. Le marché boursier, bien que volatil, se négocie à des niveaux proches de ses records historiques. Les réservations dans les hôtels de luxe restent solides, même si moins d'Américains prennent des vacances. Ce qui ressemble à une crise de l'accessibilité au logement à un bout de l'économie semble être une aubaine à l'autre bout, car la rareté a fait grimper la valeur des maisons. Si les participants au Forum de Davos semblaient déjà déconnectés de la réalité avant la pandémie, la crise de l'accessibilité au logement qui a contribué à la réélection de Trump n'a fait qu'accentuer le contraste entre les participants à Davos et le reste de la population. « Ceux qui se trouvent au bas de l'échelle sont bien conscients de l'abondance qui existe au-dessus d'eux », m'a confié Atwater, professeur adjoint d'économie à William & Mary. « Mais je pense que l'une des conséquences de la Covid a été de créer une cécité au sommet... À part le livreur qui se présente à la porte, les interactions entre ceux qui se trouvent au sommet et ceux qui se trouvent au bas de l'échelle ont vraiment diminué, voire disparu. » Il est certain que les participants au forum de Davos comprennent intellectuellement qu'ils ont un problème avec leurs « jets privés pour discuter du changement climatique ». Larry Fink, PDG de BlackRock et « maire » de facto du sommet, a diagnostiqué ce problème fondamental dans son discours d'ouverture lundi. « La plupart des personnes les plus touchées par les sujets dont nous discutons ici ne viendront jamais à cette conférence », a déclaré M. Fink dans son discours d'ouverture lundi. « C'est là tout le paradoxe de ce forum. Davos est un rassemblement d'élites qui tentent de façonner un monde qui appartient à tous. » « Davos s'est systématiquement trompé sur la direction que prenait le monde », a écrit mardi Liz Hoffman, rédactrice en chef adjointe de Semafor. « Au milieu des années 2010, les participants ont ignoré le Brexit, le mouvement MAGA et la vague populiste qui a suivi. En 2020, les délégués ont plongé leurs fourchettes dans des fontaines à fondue communes alors que le COVID-19 circulait à quelques mètres de là, à la vue de tous. Davos s'est brièvement lancé à fond dans le métaverse. » Les inégalités importantes sont intrinsèquement déstabilisantes. L'histoire regorge d'exemples, mais il suffit de jeter un œil aux gros titres sur l'Iran ces dernières semaines pour voir les risques se concrétiser en temps réel. Des années d'inflation élevée et de mauvaise gestion financière ont érodé la richesse de la classe moyenne, tandis que la corruption à haut niveau a permis à une poignée d'hommes d'affaires de s'enrichir. La colère suscitée par cette disparité a éclaté fin décembre, lorsque la monnaie nationale a atteint son plus bas niveau historique, déclenchant des manifestations de masse et une répression violente de la part de Téhéran. « On ne peut pas maintenir un tel niveau de richesse ostentatoire sans en subir les conséquences », note Atwater. « Ce que les dirigeants ne semblent pas comprendre, c'est que toute vulnérabilité supplémentaire pourrait facilement faire pencher la balance... Nous sommes à deux doigts d'un déclenchement irréversible. » [1] https://finance.yahoo.com/news/economist-popularized-k-shaped-economy-174257576.html (Fortune, 13 novembre 2025) Peter Atwater, professeur adjoint d'économie à William & Mary [2] et président de Financial Insyghts « Ils passent à côté de l'aspect émotionnel », a déclaré M. Atwater à Fortune. « Ils ne comprennent pas que ce qui nous motive à agir, ce n'est pas l'économie, mais nos sentiments à l'égard de l'économie. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est d'un côté un petit groupe d'individus qui éprouvent une certitude intense associée à un contrôle implacable du pouvoir, et de l'autre, un océan de désespoir », a-t-il poursuivi. « Et c'est cet aspect dont on ne parle jamais. » Les données de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta montrent que la croissance des salaires des Américains appartenant au quartile inférieur des revenus a atteint son niveau le plus bas depuis environ dix ans, tandis que celle des Américains appartenant au quartile supérieur des revenus est la plus forte de tous les groupes de revenus. Ces personnes réagissent selon ce que l'économiste appelle les « cinq F » : « fight, flight, freeze, follow and f-ck it » (se battre, fuir, se figer, suivre et tout envoyer balader). Les cols bleus ou les cols blancs gratte-papier peuvent non seulement commencer à réduire leurs dépenses, comme le constatent les PDG du secteur de la vente au détail, mais ils peuvent également commencer à saboter leur lieu de travail, a déclaré M. Atwell [?] [Atwater]. Un marché du travail caractérisé par un faible taux d'embauche et de licenciement peut engendrer du ressentiment chez les employés qui se sentent coincés. Cela peut entraîner un désengagement, une perte de productivité et une reprise de la Grande Démission. Dans le même temps, la moitié supérieure du K est susceptible d'adopter des comportements tout aussi risqués, a averti M. Atwater : « Les gens sont aveugles au risque lorsqu'ils sont trop confiants et lorsqu'ils se sentent invulnérables. » Non seulement l'effet de richesse incite les Américains les plus fortunés à investir davantage dans le marché boursier, en particulier dans l'IA, alors même que les craintes d'une bulle s'intensifient, mais les personnes à hauts revenus ont aujourd'hui le sentiment que leur richesse est permanente, a déclaré M. Atwater. « Les économistes aiment dire, tout comme les professionnels du marketing, que le marché boursier n'est pas l'économie », a déclaré M. Atwater. « Mais je pense qu'on peut affirmer sans risque de se tromper qu'à l'heure actuelle, l'économie est le marché boursier. » Atwater a cité une étude réalisée en 2011 par le New England Complex Systems Institute établissant un lien entre les troubles sociaux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pendant le Printemps arabe et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires. Il a suggéré que les Américains à faibles revenus continueraient à se montrer de plus en plus critiques envers les plus riches. « Il s'agit d'une crise de confiance », a déclaré Atwater. « Malheureusement, ceux qui sont les mieux placés pour y remédier semblent au mieux indifférents, ce qui ne passe pas inaperçu auprès des plus démunis. » [2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Collège_de_William_et_Mary
-
C'est un procès injuste fait aux "contemporains", j'entends par là les électeurs. C'est un procès injuste fait à la démocratie. Car ce ne sont pas les électeurs qui choisissent qui va être sur le bulletin de vote. C'est les donateurs. Parce que les dons sont dérégulés à la suite de décisions de la Cour Suprême comme Citizens vs. United, Jimmy Carter a qualifié le système politique américain « d'oligarchie » : https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_United_v._FEC#Opposition Dans une interview accordée à Thom Hartmann où il discutait de l'arrêt et de ses développements connexes, l'ancien président Jimmy Carter a qualifié les États-Unis d'« oligarchie où la corruption politique est illimitée » Faire le procès du régime politique américain actuel, ce n'est pas faire le procès de la démocratie. C'est faire le procès de l'oligarchie. William Dormhoff qui est un spécialiste des relations de pouvoir aux États-Unis actualise fréquemment son ouvrage de référence dont la 8e édition est parue en 2022 : Who Rules America ? The Corporate Rich, White Nationalist Republicans, and Inclusionary Democrats in the 2020s. Il conclut de façon peu étonnante que le vrai pouvoir est aux mains d’une élite de pouvoir qui ne compte que 0,5 % de la population. Un article de David Dayen publié en janvier 2024 dans The American Prospect dit clairement les choses : « America is not a Democracy ». En 2002 Emmanuel Todd a publié un ouvrage intitulé Après l’empire, Essai sur la décomposition du système américain. Aujourd’hui, la décomposition est plus avancée et la présidence Biden ne l’a pas enrayée. De façon étrange et fortuite, le déclin mental de Biden est une illustration analogique du déclin des États-Unis eux-mêmes. Le déclin des empires est un processus long et lent et, si sur de nombreux plans les États-Unis restent une grande puissance, le processus du déclin paraît bien enclenché et irréversible. Martin Gilens et Benjamin Page qui ont prouvé que : Plus l’élite économique soutenait une idée, plus elle avait de chances d’être adoptée. (...) Mais pour l’électeur moyen, le pourcentage de la population qui soutient une idée ne change en réalité rien aux chances de cette idée de devenir une loi ! Bref, ce n'est pas l'Ukraine qui s'américanise et se démocratise, c'est l'Amérique qui s'ukrainise et s'oligarchise. Michael Lind parlait en 1995 de "brésilianisation" des États-Unis : https://forum.air-defense.net/topic/11243-usa/page/585/#comment-1248026 La "brésilianisation", écrit Lind, se caractérise par le "retrait croissant de la surclasse blanche américaine dans son... monde de quartiers privés, d'écoles privées, de services de police privés, de soins de santé privés et même de routes privées, à l'écart de la misère qui s'étend au-delà. Comme une oligarchie latino-américaine, les membres riches et bien branchés de la classe surabondante peuvent prospérer dans une Amérique décadente avec des niveaux d'inégalité et de criminalité du tiers monde".
-

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.globaltimes.cn/page/202601/1353853.shtml (21 janvier 2026) « Ce forum [Davos] envoie un signal politique clair quant à la prise de conscience stratégique croissante de l'Europe », a déclaré mercredi Zhao Junjie, chercheur principal à l'Institut d'études européennes de l'Académie chinoise des sciences sociales, au Global Times. La pression maximale exercée par les États-Unis sur la question du Groenland a ébranlé le consensus de longue date entre l'Europe et les États-Unis sur les valeurs. Ses actions unilatérales et intimidantes ont suscité une forte crainte et une grande inquiétude dans toute l'Europe, ce qui explique en grande partie les émotions exacerbées et les réactions intenses des représentants européens à l'égard des États-Unis lors du forum de cette année. Comme l'ont fait remarquer des banquiers et des dirigeants d'entreprise de haut rang à Davos, ils estiment que les réactions actuelles des dirigeants européens à l'égard des États-Unis sont plus émotionnelles que pragmatiques. De plus, en raison de contraintes structurelles de longue date - son profond enchevêtrement avec les États-Unis dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et des affaires économiques - la réponse de l'Europe est faible et limitée. M. Zhao a en outre fait remarquer que l'Europe manque encore de mesures systématiques pour contrer efficacement l'unilatéralisme américain, les efforts actuels se limitant largement à des mécanismes multilatéraux souples. La réponse de l'Europe aux pressions unilatérales des États-Unis a été lente et manque de coordination interne. Les pays de l'UE ne sont pas parvenus à un consensus sur l'activation de l'instrument anti-coercition. Pendant ce temps, l'Europe continue de se débattre avec le « double standard » dans ses engagements multilatéraux. Malgré les appels des dirigeants en faveur de la diversification commerciale, les politiques restrictives d'accès au marché à l'égard de certains produits étrangers ont alimenté les tensions commerciales actuelles. Cette contradiction est illustrée par l'appel de Macron en faveur des investissements chinois dans des secteurs clés, alors même que l'UE s'apprête à supprimer progressivement les composants et équipements provenant de fournisseurs technologiques tels que Huawei dans certains secteurs - une politique qui soulève inévitablement des questions sur la cohérence et la sincérité de l'Europe dans la poursuite de partenariats coopératifs. Le Canada a déjà pris des mesures. Le premier ministre Mark Carney a déclaré que les puissances moyennes ne sont pas « impuissantes » face à « une rupture de l'ordre mondial ». Il a appelé à « l'honnêteté sur le monde tel qu'il est » et à la construction de « quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus fort et de plus juste ». Récemment, le Canada a établi des partenariats stratégiques avec la Chine et le Qatar afin de promouvoir la diversification de ses relations étrangères. Une telle sobriété stratégique pourrait inspirer l'Europe. Confrontée à des pressions extérieures, l'Europe ne peut véritablement préserver ses propres intérêts et défendre l'ordre multilatéral international qu'en renforçant la solidarité interne, en menant des actions pragmatiques et en élargissant la coopération multilatérale. C'est seulement ainsi qu'elle pourra réellement protéger ses intérêts dans un contexte de profonds changements. L'histoire n'attend pas les indécis : il est temps pour l'Europe d'agir. -

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
Or le problème, c'est que l'Europe est américaine. Jean Monnet est un "américain". p.,543 De Gaulle : Cela se fera plus facilement lorsque les pays d'Europe seront indépendants et qu'ils seront décidés - en particulier et surtout l'Angleterre - à se rendre maîtres de leur propre destin. (...) Or l'Angleterre n'a pas renoncé à maintenir des liens particuliers avec l'Amérique, ni l'Allemagne pour de tout autres raisons. Aussi lorsqu'on parle au Chancelier ou à M. Macmillan de faire quelque chose d'européen, on n'aboutit à aucun résultat, car tous les deux en réfèrent toujours aux États-Unis, et l'on se retrouve à l'OTAN. Ce n'est pas un reproche que de constater cet état de fait qui a été imposé par la dernière guerre. Pour gagner celle-ci, l'Angleterre a dû accepter le leadership de l'Amérique, puis elle est restée liée à celle-ci pour des raisons d'ordre politique aussi bien que militaire. L'Allemagne, elle, a peur de l'URSS. Elle a donc besoin d'être protégée par les États-Unis. Ni l'Angleterre, ni l'Allemagne n'ont encore fait assez de chemin en direction d'une Europe indépendante. p.,543 De Gaulle : Je ne vois pour l'instant que la Russie et les États-Unis qui soient réellement indépendants. Un jour peut-être verrons nous l'Europe le devenir. Pour l'instant elle ne peut pas se faire, car les pays qui la composent n'y sont pas résolus. S'il y a des gens en Allemagne, en Belgique et en France même pour réclamer une fédération, à la suite de M Jean Monnet, c'est précisément pour se dispenser d'avoir une politique nationale et, au moyen d'une Commission de sages, faire celle que souhaitent les États-Unis. Quand les Anglais seront redevenus assez anglais pour n'être que cela, les Français français, et les Allemands allemands, on pourra faire beaucoup de choses, mais on n'en est pas encore là. -

US vs EUROPE
Wallaby a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.20minutes.fr/economie/4197070-20260122-guerre-economique-si-etats-unis-coupaient-acces-visa-mastercard-comment-europe-sortirait Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les États‑Unis ont multiplié les sanctions individuelles, principalement via l’Office for Foreign Assets Control (OFAC), une agence du département du Trésor des États-Unis. Visé par ces sanctions, le juge français de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou, impliqué dans le dossier du mandat d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a témoigné en octobre des difficultés auxquelles il était confronté dans sa vie quotidienne. « Ces sanctions […] interdisent à toute personne physique ou morale américaine, y compris leurs filiales à l’étranger, de fournir des services à une personne sous sanctions, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit », expliquait-il. Ainsi, les comptes de ce juge auprès d'« entreprises américaines sont fermés », comme « Airbnb, Amazon, Paypal », et « les paiements sont la plupart du temps supprimés ». La raison tient en ce que les entreprises américaines Visa et MasterCard représentent 69 % des transactions par carte en zone euro, selon la Banque de France. Quant aux solutions de paiements Apple pay et Google Pay, elles sont aussi américaines. En cas de rétorsion contre les Européens, les Etats-Unis pourraient-ils décider de couper les services de Visa et MasterCard aux Européens, comme cela a pu être fait pour Nicolas Guillou ? « Non seulement c’est techniquement possible, mais c’est aussi très simple, rapporte Joël‑Alexis Bialkiewicz, président de DeluPay et expert des infrastructures de paiement en France. Visa et Mastercard étant soumises au droit américain, si demain l’OFAC décide de sanctionner un pays ou toute l’Union européenne, ces réseaux devront obéir. On l’a vu notamment avec l’Iran. Des entreprises européennes parfaitement légales au regard du droit européen ont été coupées des réseaux de paiement américains, du jour au lendemain ». « Ce serait économiquement douloureux pour les États-Unis, mais sans commune mesure avec le coût pour l’Europe », selon Joël‑Alexis Bialkiewicz, qui évoque une « asymétrie totale » dans les relations transatlantiques, au profit des Etats-Unis. Si le scénario d’une coupure est aujourd’hui hypothétique, il illustre la dépendance européenne aux systèmes de paiements américains. Car 25 ans après l’introduction de la monnaie unique, une solution numérique de paiement paneuropéenne et souveraine reste à construire. L’alternative la plus avancée, aujourd’hui, est Wero, un portefeuille de paiement numérique paneuropéen basé sur les virements instantanés SEPA développé par l’European Payments Initiative (EPI), un consortium de banques européennes. Utilisable en magasin, en ligne et entre particuliers, elle fonctionne dans l’Union européenne et est indépendante de Visa et MasterCard. Selon Martina Weimert, la patronne de la société chargée du développement de Wero, European Payments Initiative (EPI), Wero comptait à la mi-2025 en France « 15,9 millions » d’utilisateurs actifs, c’est-à-dire ayant déjà utilisé le service, « 2,3 millions » de clients en Allemagne et « proche de 7 millions » en Belgique. Reste que son déploiement est lent à l’échelle européenne, et l’acceptation des commerçants est encore limitée. « Wero n’est pas encore au point pour les paiements, contrairement à DeluPay », indique Joël‑Alexis Bialkiewicz [président de DeluPay, donc son avis est peut-être un tout petit peu biaisé ?] Quant à l’euro numérique, soutenu par la Banque centrale européenne, le cadre législatif de la version dématérialisée des pièces et des billets fait actuellement l’objet d’un débat au Conseil et au Parlement européen. La mise en circulation de l’euro numérique n’interviendrait pas avant 2028. Un temps infini, au regard des déclarations menaçantes quasi quotidiennes des Etats-Unis.