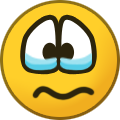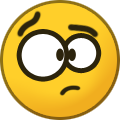-
Compteur de contenus
25 512 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
Les Suédois font partie des États qui ont poussé à la politique dite "partenariat oriental" visant à faire basculer l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie, et j'en oublie peut-être, dans le camp occidental : https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_oriental Le partenariat oriental est une politique de voisinage de l'Union européenne (UE) visant à conclure des accords avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie, inauguré à Prague le 7 mai 2009. Il a été présenté par le ministre des Affaires étrangères de Pologne Radosław Sikorski avec l'assistance de la Suède. Les Suédois ne sont pas "victimes" dans cette histoire. C'est le jeu ma pauvre Lucette ! -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Cela dit, une énorme liberté de ton reste présente dans les médias. Par exemple ceci : https://malijet.com/actualite-politique-au-mali/editorial-journaux-mali/266831-edito-les-sanctions-de-la-cedeao-pesent-sur-les-menages.html (14 février 2022) Youssouf Sissoko - L'Alternance Oui la France à sa grande part de responsabilité dans notre crise, voir dans le sous-développement du Mali, il est tout à fait clair que les sanctions sont illégales et illégitimes, oui les Maliens sont des descendants de Soundiata Keita, de Babemba, de Firhoun, mais de grâce ceux-ci ne vont pas se relever de leurs tombes pour venir résoudre les problèmes quotidiens des maliens qui broient aujourd'hui du noir. Le gouvernement doit faire preuve de réalisme en proposant un chronogramme pas celui à polémique inutile, mais un chronogramme raisonnable et acceptable par la communauté internationale, afin que les maliens puissent retrouver le sourire avec la levée des sanctions inhumaines dues par la CEDEAO. Un peuple ne vit pas que de l'histoire, il a aussi besoin de pain et de l'eau, donc les discours à relent historique et populiste doivent céder la place à celui plus pragmatique prenant en compte les aspirations profondes du peuple et qui va dans le sens de l'atténuation des souffrances des maliens. Quant à Boubou Cissé, je me demande s'il est toujours "en lieu sûr", voire exilé à l'étranger (ce qui permettrait de faire l'hypothèse qu'il est lui-même à l'origine de la fuite) : https://www.jeuneafrique.com/1130077/politique/mali-la-procedure-contre-boubou-cisse-et-ras-bath-annulee/ (2 mars 2021) L’ex-Premier ministre Boubou Cissé, lui, se cache « en lieu sûr », selon ses avocats, depuis que, le 24 décembre dernier, des hommes « armés et encagoulés » se sont présenté à son domicile. https://www.jeuneafrique.com/1188077/politique/mali-boubou-cisse-si-je-peux-apporter-mon-aide-je-le-ferai/ (16 juin 2021) C’est désormais un homme libre et blanchi par la justice malienne que nous rencontrons, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
https://afrique.le360.ma/mali/politique/2022/02/15/37022-mali-un-ministre-demande-le-retrait-dune-depeche-de-lagence-officielle-iranienne-37022 Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a démenti des propos que lui a attribués l'agence iranienne Irna sur les sanctions internationales à la suite d'une visite à Téhéran, et demandé le retrait de la dépêche. Une dépêche publiée dimanche en français par l'agence officielle iranienne rapportait que lors d'une rencontre avec le ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie Mohammad Ali Zolfigol le même jour, Diop avait présenté l'Iran comme « un modèle pour les pays qui veulent s'opposer à l'arrogance mondiale et à leurs sanctions oppressives ». -

terrorisme Opération Barkhane
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Scarabé dans Politique etrangère / Relations internationales
https://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/266851-mali-4-soldats-tues-dans-une-attaque-a-l-engin-explosif-improvis.html (15 février 2022) Au moins 4 soldats maliens ont trouvé la mort et 3 autres blessés, dimanche, dans une attaque à l'engin explosif improvisé contre une patrouille de l'Opération Kélétigui 2, suivie de tirs dans le cercle de Kignan, région Sikasso, au sud du pays. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Pour dissuader tout citoyen de s'exprimer aussi librement que ce qui transparaît dans la transcription. Ce qui permet que les seuls citoyens qui sont libres de s'exprimer sont ceux qui font les louanges du régime comme par exemple le responsable syndical des étudiants maliens en France. -

Le Canada et sa place sur la scène internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Hornet62 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.journaldequebec.com/2022/02/10/une-microbrasserie-intimidee-par-rambo-un-geste-qui-ne-passe-pas-a-lassemblee-nationale Bernard « Rambo » Gauthier portait une tuque promotionnelle de la brasserie Le Malbord, lors de la grande manifestation contre les restrictions sanitaires, il y a quelques jours, à Québec. Dans un message publié sur Facebook, les propriétaires de la microbrasserie ont tenté rapidement de se dissocier de cette «démarche» et des «propos» du syndicaliste après avoir reçu plusieurs appels. M. Gauthier a répondu en publiant sur Facebook des images de la fameuse tuque de la microbrasserie découpée et jetée à la poubelle. Dans la foulée, plusieurs internautes ont invité les gens à boycotter leurs produits. https://www.journaldemontreal.com/2022/02/15/rambo-fait-exploser-les-ventes-des-bieres-du-malbord L’attention dont a fait l’objet la microbrasserie Le Malbord la semaine dernière aura finalement entraîné une forte augmentation de ses ventes partout au Québec. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.letemps.ch/monde/lontario-va-abandonner-pass-sanitaire-suede-vante-une-4eme-dose-nouvelles-14-fevrier La politique de Hongkong consistant à envoyer les cas, même asymptomatiques, dans les hôpitaux et les lieux de quarantaine a entraîné un engorgement des lits et une augmentation des temps d’attente. La vague de contaminations au variant Omicron du Covid-19 a porté un « coup dur » au système de santé de la ville, qui s’accroche à sa stratégie « zéro-Covid ». https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/a-hong-kong-le-systeme-de-sante-depasse-par-la-vague-d-infections-liees-au-variant-omicron-98552c46-8d60-11ec-8bdb-e762c05259aa L’assaut du variant très contagieux Omicron a fait exploser le nombre de contaminations au Covid-19, a porté un coup dur à Hong Kong et a dépassé la capacité de gestion de la ville, a reconnu dimanche soir la cheffe du gouvernement Carrie Lam. La semaine dernière, la ville a enregistré ses premiers décès en cinq mois. Environ 50 % de la population hongkongaise âgée de plus de 70 ans n’est pas vaccinée. https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3167028/coronavirus-hong-kong-fresh-food-supply-shocks-set?module=hard_link&pgtype=article Les perturbations de l'approvisionnement en denrées alimentaires fraîches vont se poursuivre, car plus de 100 chauffeurs transfrontaliers de Chine continentale transportant des légumes à Hong Kong ont été placés en quarantaine, ce qui a provoqué une grave pénurie de camionneurs et bloqué le transport de marchandises vers la ville. Dans le cadre des efforts de confinement, les conducteurs de Hong Kong se sont vu interdire le chargement de marchandises sur le continent et ont été contraints de s'en remettre au personnel des lieux d'échange désignés pour effectuer cette tâche. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt du régime malien de faire fuiter dans la presse l'idée qu'il est aux abois. -

terrorisme Opération Barkhane
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Scarabé dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pellerin_afrique_ouest_djihadisme_sahel_2022_0.pdf (11 février 2022, 28 pages) Les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. Nouvelle terre d’expansion des groupes djihadistes sahéliens ? Les régions de l’Est et des Cascades au Burkina Faso ou celles de Sikasso et de Kayes au Mali constituent des bases arrière permettant aux groupes djihadistes – et principalement à la Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) pour l’instant – de s’étendre au Bénin, en Côte d’Ivoire, et dans une moindre mesure au Togo, au Ghana, au Sénégal et en Guinée. Cette excroissance territoriale djihadiste va progressivement donner naissance à des foyers djihadistes de plus en plus endogènes dans ces États, composés de recrues locales et qui se nourrissent des fragilités propres aux territoires où ils se développent : tensions d’accès aux ressources, stigmatisation communautaire potentiellement exacerbée par des groupes d’autodéfense, existence de réseaux criminels prompts à se « djihadiser ». La propagation de l’idéologie djihadiste depuis le Sahel central au-delà des frontières sud constitue le moteur permettant d’exploiter et de transformer les frustrations et les injustices qui découlent de ces situations de fragilité. La pression exercée dans ces trois régions (Sikasso, Kayes, Koulikoro) augure d’une menace nouvelle pour le Mali, celle d’un encerclement progressif de Bamako. La circulation accrue des groupes djihadistes autour de Bamako semble préfigurer cette évolution et la survenue de certains incidents témoigne de la capacité de ces groupes à atteindre cet objectif. L’attaque du poste de gendarmerie de Nèguèla, à 36 kilomètres de Kati, fin mars 2021, en est une illustration. Nombre d’observateurs à Bamako s’inquiètent des conséquences d’un tel encerclement, dans l’immédiat moins liées à une éventuelle prise de Bamako rendue imaginable par le scénario afghan d’août 2021, qu’à un embargo qui plongerait la capitale et sa population dans une situation économique (et donc sociopolitique) intenable. Durant le second semestre 2021, en particulier depuis septembre 2021, [la commune de] Mangodara [au Burkina] connaît un regain de violence qui traduit à nouveau l’ancrage territorial de la katiba qui, en dépit de nombreuses frappes aériennes conduites par les forces burkinabées, parvient à étendre son influence. Plus de 3 000 réfugiés sont enregistrés en Côte d’Ivoire et plusieurs centaines de déplacés internes dans le périmètre de la commune au Burkina Faso. Au Niger, là encore, l’extension des activités djihadistes, cette fois-ci tant de l’EIGS que de JNIM vers le sud des régions de Tahoua, Dosso et Tillabéri, est une dynamique à l’œuvre depuis plusieurs années mais qui s’intensifie actuellement. Le JNIM a par exemple revendiqué sa plus importante attaque jamais enregistrée dans le département de Torodi le 31 juillet 2021, causant la mort de 15 militaires nigériens. Cet espace transfrontalier, appelé WAPO du nom des parcs W, Arly, Pendjari et Oti, qui traversent les frontières du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo, constitue le second fief de JNIM au Sahel après le Delta intérieur du Niger [situé quant à lui au Mali]. À ce jour, [parmi les États côtiers,] c’est la Côte d’Ivoire qui a enregistré le nombre le plus important d’attaques sur son territoire, toutes dans l’extrême nord-est de la région du Tchologo, à Kafolo (département de Kong), formant un triangle avec les localités du Bounkani, Tougbo (département de Bouna) et Tehini (département de Tehini). L’ensemble des attaques sont l’œuvre du JNIM, en particulier de sa katiba opérant à Alidougou, ville proche de Kafolo de l’autre côté de la frontière au Burkina Faso. Le troisième pays côtier d’Afrique de l’Ouest visé par les groupes djihadistes est le Togo. Pour la première fois le 9 novembre 2021, une attaque a ciblé les forces de défense et de sécurité à Sanloaga (Kpendjal). Elle a été repoussée par les forces togolaises, mais elle fait probablement basculer le Togo du statut de zone d’approvisionnement logistique à celui de territoire d’opération. De fait, le Togo, au même titre que le Ghana ou le Bénin, est présenté comme un pays utilisé pour l’approvisionnement à motos, en produits de première nécessité et en armes pour les djihadistes opérant dans l’est du Burkina. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
https://malijet.com/a_la_une_du_mali/266799-presume_entretien_telephonique_entre_boubou_cisse_alassane_ouatt.html (14 février 2022) L’audio fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans les conversations, on entend les voix( trafiquées ?) de l’ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, qui fait le bilan de la situation socio-économique du Mali au Président ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux protagonistes semblent se réjouir des retombées des sanctions économiques de la CEDEAO sur le Mali. « Malgré tout ce qu’il veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux …ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois à quatre semaines financièrement. Donc la tension est là, elle est réelle et monte », explique Boubou Cissé au Président ivoirien. Ce dernier, dans sa réponse, traite tout de go les autorités maliennes de « naïfs », « d’idiots » et « d’ignorants ». « La Russie est la 11e puissance économique aujourd’hui, c’est pas la Russie qui va régler leurs problèmes…Je ne comprends pas, on dirait qu’ils sont tombés sur la tête…Ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer de vieux matériels », précise Ouattara. Les voix des deux responsables ont -elles été trafiquées ? Sommes nous en présence d’une deep fake ? L’authenticité de la conversation reste encore à prouver. Mais en entendant, la justice malienne s’est saisie de l’affaire. En effet, le parquet du tribunal de la commune 4 de Bamako a annoncé, sur les réseaux sociaux, « l’ouverture d’une enquête préliminaire pour atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ». -

AFRIQUE : politiques internes et relations internationales
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.spiegel.de/kultur/koeln-will-benin-bronzen-an-nigeria-zurueckgeben-a-63a31cc1-1a66-47ad-b12b-6e6c5c8a7152 (4 février 2022) Le Nigeria réclame depuis longtemps la restitution des bronzes béninois volés pendant la période coloniale. La ville de Cologne a maintenant décidé de restituer 96 œuvres d'art de la cour du Bénin appartenant au Rautenstrauch-Joest-Museum. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.morgenpost.de/kolumne/meine-woche/article234557419/Gefaehrlicher-Ungehorsam.html (13 février 2022) Blocage d'une autoroute à Berlin Le dialogue devient alors difficile : les activistes climatiques du groupe "Die letzte Generation" veulent poursuivre leurs blocages de rues à Berlin jusqu'à ce que le gouvernement fédéral ait promulgué une loi sur l'utilisation durable des denrées alimentaires. Cette loi doit obliger les supermarchés allemands à faire don des aliments périmés. C'est par exemple l'avis exprimé il y a quelques jours par la nouvelle ministre de l'Environnement du gouvernement fédéral, Steffi Lemke (Verts). "Il est tout à fait légitime de manifester pour défendre ses intérêts et d'utiliser pour cela des formes de désobéissance civile", a déclaré cette native d'Allemagne de l'Est - s'attirant ainsi de vives critiques. Heureusement. Et aussi de la part des représentants du gouvernement de coalition tricolore, comme le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP). "Dans le droit allemand, la désobéissance civile n'est ni un motif de justification ni un motif d'excuse. Les manifestations non déclarées sur les autoroutes sont et restent illégales", a tweeté Buschmann. "Je pensais jusqu'à présent qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer cela dans un cabinet fédéral. Apparemment, si". -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Il est beaucoup plus puissant que cela. Cf son intervention pour détricoter le nouveau code de la famille trop libéral à son goût. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
En tout cas l'Imam Dicko a beaucoup méprisé la France : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/16/au-mali-l-imam-dicko-part-en-campagne-contre-les-homosexuels_4833188_3212.html Lors d’un meeting organisé par le HCIM à la grande mosquée de Bamako, le 12 décembre [2015], l’imam est allé plus loin dans la diatribe, dénonçant pêle-mêle une forme d’occupation de son pays par les casques bleus de la Minusma et de la force française « Barkhane », ainsi qu’un « djihadisme » créé de toute pièce « par les Occidentaux » pour « recoloniser le Mali ». Pour situer un peu le personnage : - - - - -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
https://carnegiemoscow.org/commentary/86326 (1er février 2022) Un autre atout important dont dispose Poutine est la résilience du peuple russe, dont la plupart se souviennent de temps plus difficiles, même s'ils préféreraient bien sûr ne pas les voir revenir. Avec les nouvelles sanctions dont il menace, l'Occident est capable de détériorer le niveau de vie actuel des Russes ordinaires, mais jusqu'à présent, rien de ce qu'il a proposé ne pourrait rendre la vie des Russes plus difficile qu'elle ne l'était dans les années 1990, lorsque l'Occident était considéré comme un ami de leur pays. En d'autres termes, la Russie est mieux préparée à être coupée du système de paiement international SWIFT que l'Europe ne l'est à être coupée des approvisionnements en gaz russe. -

co² Economie et climat. CO2 or not CO2?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Economie et défense
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/09/16/l-enfer-numerique-la-face-cachee-de-nos-e-mails_6094839_1698637.html L’industrie numérique mondiale consomme tant d’eau, de matériaux et d’énergie que son empreinte est le triple de celle d’un pays comme la France ou l’Angleterre. Les technologies numériques mobilisent aujourd’hui 10 % de l’électricité produite dans le monde et rejetteraient près de 4 % des émissions globales de CO2, soit un peu moins du double du secteur civil aérien mondial. La jeune pousse a déjà déployé 13 modules un peu partout dans le monde, dont un dédié à la production d’e-kérozène installé en Basse Saxe (Allemagne). "e-" ça veut dire "électricité" ? Eh bien si c'est en Basse-Saxe c'est du charbon. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
Khadafi me fait une transition toute trouvée. Le proverbe qui vient en tête est "be careful what you wish for". Méfiez-vous que vos rêves les plus fous ne s'accomplissent. Les Occidentaux surtout anglo-saxons et Polonais souhaitent l'effondrement de la Russie et l'élimination de Poutine, comme naguère ils ont souhaité l'effondrement de la Libye et l'élimination de Khadafi. Mais l'Afrique est-elle plus et mieux gérable aujourd'hui qu'elle ne le serait si Khadafi ou son clan étaient toujours au pouvoir ? La question qui se pose derrière la Russie, c'est l'Asie avec la Chine et l'Inde. L'Indopacifique comme on dit de nos jours pour faire chic. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
Le retrait du personnel de l'ambassade américaine pourrait être le signal - ce n'est pas un scoop - un signe d'accompagnement du fait que Biden et Poutine sont en train de négocier. On peut imaginer le scénario suivant : Biden dit : voilà, c'est ma dernière offre, je ne ferai pas plus de concessions que celles que Blinken a transmises à Lavrov la dernière fois. Poutine veut envoyer à Biden un message subliminal comme quoi ce n'est pas une très bonne idée, et qu'il ferait mieux de relancer la négociation avec des propositions un peu plus appétissantes. Que fait Poutine ? il fait dire à ses généraux sur un canal qu'ils savent espionnés par les Américains que l'offensive est déclenchée pour le 16. Les Américains tombent dans le panneau, et évacuent leur personnel de l'ambassade. Du coup tout le monde se met à paniquer, et les Allemands, certains Ukrainiens, des gens qui ont des choses à perdre en cas de conflit, se mettent à faire une pression supplémentaire sur Biden pour qu'il lâche du lest. Autre version : les Américains ne tombent pas dans le panneau mais disent à Poutine : chiche, fais-la ta guerre on t'a prévenu de toute la misère qu'on va te faire avec des sanctions si tu la fais. La preuve que cela ne nous émeut pas plus que ça c'est qu'on retire notre personnel de l'ambassade. On vit ça très bien. C'est des Russes et des Ukrainiens, accessoirement des Allemands qui souffriront. On s'en lave les mains. -

Le Canada et sa place sur la scène internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Hornet62 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ledevoir.com/politique/canada/671295/joel-lightbound-demande-un-plan-a-son-gouvernement-pour-vivre-avec-la-covid-19 (9 février 2022) La sortie en règle du député libéral fédéral Joël Lightbound contre les mesures sanitaires imposées par son propre gouvernement, qu’il accuse d’avoir politisé la pandémie de COVID-19 et divisé les citoyens, lui a coûté son poste de président du caucus du Québec en plus d’avoir monopolisé les questions de l’opposition aux Communes mardi. Selon M. Lightbound, la population ressent inégalement les effets des mesures sanitaires, puisque « ce n’est pas tout le monde qui peut gagner sa vie sur un MacBook au chalet ». Les membres du gouvernement fédéral rappellent constamment que 90 % de la population canadienne adhère à la vaccination, un énoncé qui aggrave les divisions dans la population, dit-il. « J’ai beaucoup de misère avec le discours 90-10. Ça contribue à la stigmatisation. » Même s’il dénonce les dérapages de groupes extrémistes observés lors de l’occupation associée au convoi de camionneurs, il appelle à éviter les généralisations. Il illustre son propos en parlant de l’entrevue d’une « grand-mère qui avait l’air toute douce » présente à la manifestation, qui « n’avait pas l’air d’une suprémaciste blanche, pas plus que les Canadiens noirs […] ou les membres des Premières Nations que j’ai vus manifester ces derniers jours ». https://www.ledroit.com/2022/02/11/joel-lightbound-le-canari-dans-la-mine-liberale-ab3fc6aede794b8087f382e49f01b75b Qu’a dit Joël Lightbound, au juste? Que Justin Trudeau, qui s’était jusqu’alors opposé à la vaccination obligatoire, a reviré sa veste juste avant l’élection parce qu’il y a vu une façon de coincer le Parti conservateur. Et tant pis si sa victoire se fait au prix de contraintes supplémentaires sur une population déjà excédée, pour un gain sanitaire à peu près nul. Le discours rigide de M. Trudeau explique son incapacité actuelle à trouver une solution aux blocages de camionneurs qui se multiplient. Ayant empoisonné le puits, il ne peut accorder aucun crédit aux arguments des manifestants. Alors il s’enfonce dans la même voie et attise la colère. Joël Lightbound nous rappelle donc que non, la polarisation n’est pas que l’affaire de Pierre Poilievre ou de la droite conservatrice. La gauche s’y adonne aussi. «J’ai beaucoup de misère avec le discours 90-10», a-t-il dit très justement. «Quand on réduit les êtres qui nous entourent à une seule identité, c’est toujours le premier pas vers la déshumanisation. J’ai été alarmé de voir [dans un sondage] que 27% des Canadiens considéraient que ce serait juste de mettre les non-vaccinés en prison.» -

Le Canada et sa place sur la scène internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Hornet62 dans Politique etrangère / Relations internationales
Ils font des contrôles tatillons sur la teneur en produits chimiques dans le sirop d'érable. -

terrorisme Opération Barkhane
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Scarabé dans Politique etrangère / Relations internationales
http://www.opex360.com/2022/02/10/un-formateur-francais-travaillant-pour-les-gardes-forestiers-beninois-a-ete-tue-lors-dune-attaque-presumee-jihadiste/ Un formateur français travaillant pour les gardes forestiers béninois a été tué lors d’une attaque présumée jihadiste -

Australie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Philippe Top-Force dans Politique etrangère / Relations internationales
-

ressource Les terres rares, commencent a se faire vraiment rares !
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alpacks dans Economie et défense
Les terres rares en Australie : https://www.diploweb.com/Diversification-des-chaines-de-valeur-de-terres-rares-hors-de-Chine-Strategies-politiques-et.html (6 février 2022) L’industrie australienne est en effet la première productrice de terres rares raffinées hors de Chine et s’emploie au développement du secteur en se positionnant comme fournisseur de choix pour ses alliés proches. En témoigne un contrat signé entre l’entreprise australienne Lynas Rare Earths et le Département de la Défense américain en 2020 afin d’implanter une usine de traitement au Texas. Ainsi, les États-Unis exportent par exemple la totalité de leur production de terres rares brutes vers la Chine pour traitement, alors qu’un avion de chasse américain F-35 contient 400 kg de terres rares et que la Chine a déjà brandi la menace de couper leur exportation en cas de différend. En avril 2020, le ministre du Trésor Josh Frydenberg, a rejeté l’investissement de l’entreprise publique chinoise Baogang qui aurait détenu 11,1 % de l’australien Northern Minerals, producteur de terres rares lourdes en Australie Occidentale. Déjà en 2009 le Trésor avait refusé l’investissement du chinois Non-Ferrous Metal Mining Group qui aurait détenu 51,6 % des capitaux de Lynas, alors en plein développement, jugeant que cela allait « à l’encontre de l’intérêt national de l’Australie » [9]. Ce sont finalement des investissements japonais qui ont été privilégiés. Lynas est une des seules entreprises capables de traiter des terres rares hors de Chine grâce à la mine de Mount Weld en Australie Occidentale, d’où elle extrait ses ressources minières, qui sont ensuite traitées dans leur usine en Malaisie. Une nouvelle usine de traitement localisée dans la ville australienne de Kalgoorlie va par ailleurs augmenter les capacités de traitement de l’entreprise d’ici 2023. Toutes les entreprises ne jouent pas le jeu de cette diversification, notamment l’australien RareX qui a conclu un accord de principe avec un des leaders chinois du traitement des terres rares (Shenghe). Leur but est de créer une entreprise jointe pour se procurer des concentrés de terres rares hors de Chine et alimenter les opérations de raffinage existantes et futures de Shenghe en Chine. En collaboration avec ses partenaires coréens, ASM est aussi parvenue à développer une technologie de traitement moins polluante et moins consommatrice en énergie dans une usine pilote, qui doit laisser place à une usine de grande échelle en Corée. Étant donné que beaucoup d’entreprises souhaitent produire de façon plus soutenable, l’Australie se présente comme un acteur plus fiable avec des produits plus durables, pouvant également justifier d’un coût plus élevé. Dans cet esprit, une des entreprises (Arafura Ressources) projette d’utiliser la technologie « Blockchain » afin de tracer la provenance de ses terres rares sur toute la chaîne de production jusqu’au consommateur final. Le faible investissement de la part d’acteurs australiens laisse la place à ceux en provenance d’Europe, des États-Unis et des démocraties asiatiques (Japon et Corée du Sud) mais aussi de la Chine. Ainsi, le discours sur la diversification des chaînes de valeur - porté par le gouvernement et beaucoup d’entreprises australiennes - entre en contradiction avec la réalité et le pragmatisme économique. Ces entreprises ont en effet des investisseurs chinois et des accords d’exportation avec des entreprises chinoises en bout de chaîne de valeur : fabricants de composants, d’aimants, de véhicules électriques ou encore d’éoliennes. L’étude des documents commerciaux révèle que ces accords de principe sont majoritairement signés avec des entreprises chinoises, puis européennes. Les partenaires chinois restent de fait un débouché majeur dans un secteur quasi-monopolistique et représentent autour de 50 % de la valeur des exportations futures des entreprises australiennes. Même Lynas est concernée par cette aspiration vers le marché chinois qui représente encore 20 à 25 % de ses ventes en 2020, bien qu’en baisse (50 % dans le milieu des années 2010). En 2021, il reste donc très difficile de développer les activités liées aux terres rares sans la Chine, qui concentre les débouchés, savoir-faire et industries sur son territoire. Le positionnement politique et commercial des acteurs australiens se retrouve ainsi confronté à la réalité économique. Par exemple l’État d’Australie Occidentale cherche à diversifier ses partenaires économiques dans le secteur des terres rares sans avoir l’intention d’être indépendants de la Chine. « L’Australie Occidentale entretient d’excellentes relations avec la Chine, et elles sont réciproques » affirme une représentante du Département des mines, de la réglementation industrielle et de la sécurité de cet État dans un entretien mené en février 2021. -

Australie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Philippe Top-Force dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/getting-ready-for-trump-as-president-47 Les Australiens n'ont pas de plan B au cas où les Américains ne seraient pas l'allié fiable dont ils rêvent. -
https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/jan-6-global-democracy.html Francis Fukuyama : Le monde est donc très différent de ce qu'il était il y a environ 30 ans, lorsque l'ancienne Union soviétique s'est effondrée. À l'époque, j'ai sous-estimé deux facteurs clés : premièrement, la difficulté de créer non seulement une démocratie, mais aussi un État moderne, impartial et non corrompu ; et deuxièmement, la possibilité d'une décomposition politique dans les démocraties avancées. Le modèle américain est en train de se dégrader depuis un certain temps. Depuis le milieu des années 1990, la politique du pays est devenue de plus en plus polarisée et sujette à un blocage permanent, ce qui l'a empêchée de remplir les fonctions gouvernementales de base comme l'adoption des budgets. Les institutions américaines présentaient des problèmes évidents - l'influence de l'argent en politique, les effets d'un système de vote de moins en moins aligné sur le choix démocratique - mais le pays semblait incapable de se réformer. Les périodes de crise précédentes, telles que la guerre de Sécession et la Grande Dépression, ont produit des dirigeants clairvoyants, capables de mettre en place des institutions ; ce n'est pas le cas des premières décennies du XXIe siècle, qui ont vu les responsables politiques américains présider à deux catastrophes - la guerre en Irak et la crise financière des subprimes - et ont ensuite assisté à l'émergence d'un démagogue à courte vue qui a encouragé un mouvement populiste en colère. Ce qui a fait du 6 janvier une tache (et une tension) particulièrement alarmante pour la démocratie américaine, c'est le fait que le parti républicain, loin de répudier ceux qui ont initié et participé au soulèvement, a cherché à le normaliser et à purger de ses propres rangs ceux qui étaient prêts à dire la vérité sur l'élection de 2020, alors qu'il se projette vers 2024, lorsque M. Trump pourrait chercher à se faire restaurer. https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/jan-6-jimmy-carter.html Jimmy Carter : Selon le Survey Center on American Life, 36 % des Américains - soit près de 100 millions d'adultes de tous bords politiques - sont d'accord pour dire que "le mode de vie traditionnel américain disparaît si rapidement que nous devrons peut-être recourir à la force pour le sauver". Le Washington Post a récemment rapporté qu'environ 40 % des républicains pensent qu'une action violente contre le gouvernement est parfois justifiée. Je crains maintenant que ce pour quoi nous nous sommes battus si durement au niveau mondial - le droit à des élections libres et équitables, sans être gênés par des hommes politiques forts qui ne cherchent rien d'autre qu'à accroître leur propre pouvoir - soit devenu dangereusement fragile chez nous.