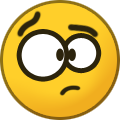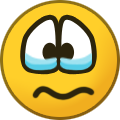-
Compteur de contenus
16 481 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
306
Tout ce qui a été posté par Picdelamirand-oil
-

armée de l'air égyptienne
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Chris. dans Afrique / Proche Orient
Je crois qu'on ne fera pas de publicité si jamais on devait livrer des SCALP ITAR Free, (ou si on les a déjà livré). Pourquoi se mettre les US à dos? -

Prochain client du Rafale ... réponse EAU
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de pascal dans Europe
On peut voir deux aspects : Sachant les hésitations des US pour livrer des F35 et avec quelles performances, les EAU ont tout intérêt à leur mettre la pression en "discutant sur le Rafale". Sachant que le F35 n'est pas spécialisé en supériorité aérienne et que, avec un faible rayon d'action, il n'est pas plus spécialisé en intervention Air/Sol à distance, il est logique qu'ils cherchent un complément au f35. -
Non c'est les 28 qui restent de la tranche 4 qui seront upgradé en F4.2. Pour les autres ils sont tous upgradables en théorie mais ça coûte beaucoup plus cher et on a décidé de ne pas le faire. Avec les 12 supplémentaires on passe de 58 F4.2 à 70 et si la Croatie se fait on passera à 82. Il faudrait proposer des Rafale M d'occasion à l'Inde!
-

Prochain client du Rafale ... réponse EAU
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de pascal dans Europe
Tactical Report est spécialisé dans les serpents de mer payants. -

[France] Armée de l'Air et de l'Espace
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Henri K. dans Europe
L'Australie? -

FRANCE : 5° puissance économique?
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SPARTAN dans Economie et défense
6. Que nous apprend l'IPC sur l'inégalité mondiale ? L'ICP ne peut pas nous informer sur la répartition des revenus entre les ménages au sein des pays, mais il aborde deux autres aspects clés de la distribution mondiale. Tout d'abord, l'ICP joue un rôle essentiel dans la la construction des estimations de la Banque mondiale sur l'extrême pauvreté qui donnent une idée du nombre et la répartition géographique des plus pauvres dans le monde (Atamanov et al 2020). Deuxièmement, par la comptabilité pour les différences de niveau de prix entre pays, l'ICP nous fournit des mesures appropriées l'inégalité entre les pays de consommation moyenne mesurée à des prix communs. La figure 5 parle de ce point. Figure 5 : Les distributions entre pays sont plus égales en PPA qu'en taux de change Source : Calculs des auteurs, basés sur le Programme de comparaison internationale (2020). L'inégalité mondiale entre les pays serait considérablement exagérée si les mesures de répartition devaient être basées sur les taux de change du marché, avec un coefficient de Gini de 0,49 contre 0,29, une différence énorme. Le prix de la consommation est plus faible dans les pays pauvres, de sorte que nous exagérons grossièrement l'inégalité mondiale si nous utilisons les taux de change du marché. Et ce n'est pas pour dire que les taux de change évoluent parfois rapidement et avec de grandes fluctuations, d'une manière qui n'a rien à voir avec la répartition mondiale des niveaux de vie. En effet, la répartition internationale de la consommation par habitant telle qu'elle est mesurée ici a à peine bougé entre 2011 et 2017, bien que cette dernière répartition soit un peu plus égale, avec un gini de 0,29 contre 0,30. Ces estimations utilisent des poids de population pour chaque pays, de sorte que les courbes de Lorenz et les coefficients de gini seraient précis pour le monde entier si chacun dans chaque pays avait la consommation moyenne du pays. Bien entendu, chaque personne dans chaque pays n'a pas la même consommation, de sorte que, si nous nous intéressons à la répartition mondiale des revenus entre les individus, ou les ménages, ces données doivent être complétées par des données provenant d'enquêtes auprès des ménages, comme le fait, par exemple, Milanovic (2016). Lorsque nous réfléchissons à la répartition, nous devons reconnaître certaines des difficultés auxquelles le PCI est confronté pour établir des tableaux pour l'ensemble du monde. La manière dont ces difficultés sont traitées est à l'origine de certains changements déconcertants entre les cycles de l'ICP, en particulier entre l'ICP1993, l'ICP2005, l'ICP2011 et l'ICP2017, l'année 2005 ayant été quelque peu aberrante. Les défis méthodologiques sont nombreux, mais l'un des plus importants est de savoir comment établir des comparaisons précises et significatives entre des pays très différents, des pays à des niveaux de développement différents ou des pays ayant des modèles très différents de prix relatifs, de consommation, de dépenses publiques et d'investissement. L'autorité statistique européenne, EUROSTAT, calcule les PPA pour les pays de l'UE, et ces chiffres sont utilisés pour fixer les transferts financiers entre les pays, de sorte que leur importance dépasse la curiosité des chercheurs universitaires. Les pays participant aux comparaisons de l'UE sont tous relativement avancés et présentent des schémas de PIB et de prix relatifs relativement similaires. Le coefficient de Gini non pondéré qui considère chaque pays comme un seul ménage serait beaucoup plus important. Ce n'est certainement pas le cas lorsque nous nous déplaçons vers des pays beaucoup plus pauvres, par exemple en Afrique, ou lorsque nous essayons de comparer les prix au Japon, en Bolivie, au Yémen et au Tchad, pour ne prendre que quatre pays très différents. L'ICP fonctionne à un niveau régional, de sorte qu'Eurostat et l'OCDE recueillent des données pour l'UE et l'OCDE, la Banque africaine de développement pour l'Afrique, la Banque asiatique de développement pour l'Asie, etc. Une fois que chaque région a collecté ses données, les bureaux régionaux calculent un ensemble de PPA (et les comptes associés basés sur les PPA) pour leur région. Ces estimations permettent d'éviter au moins certains des problèmes extrêmes que pose la comparaison de lieux très différents. Mais si nous voulons connaître les inégalités mondiales, ou les niveaux de vie en Inde ou au Pérou par rapport aux États-Unis, qui entrent dans les estimations de la pauvreté mondiale, toutes les régions doivent être en quelque sorte collées ensemble dans un seul tableau de comptes mondiaux, et ce sont ces chiffres, dans les Indicateurs du développement dans le monde, ou dans les versions successives des Penn World Tables, qui servent de point de départ à la plupart des utilisateurs. Pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire, et pour les utilisateurs intéressés par une région, les chiffres régionaux du tableau mondial sont probablement préférables. L'étape de "collage" de la construction de l'ICP laisse les comptes intra-régionaux seuls, mais calcule les prix pour chaque bloc régional qui sont utilisés pour les regrouper dans un ensemble commun d'unités ; considérez ces prix comme des changeurs "tectoniques" qui déplacent des continents entiers vers le haut ou vers le bas pour les regrouper dans un seul ensemble de comptes. Le calcul de ces facteurs tectoniques n'est pas simple et il existe plusieurs façons de le faire. Les estimations de l'inégalité mondiale, comme celles de la figure 4, sont sensibles aux détails, car nous rapprochons ou éloignons tous les pays d'Afrique ou tous les pays d'Asie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La plupart des commentateurs avertis s'accordent maintenant à dire que la procédure tectonique utilisée pour le cycle de 2005 - qui utilisait quelques pays de chaque région pour donner les prix continentaux - était inférieure à la procédure utilisée en 2011 et 2017 - qui utilisait les informations de tous les pays de toutes les régions. Il en résulte que le monde a été artificiellement inégalitaire en 2005 par rapport aux estimations précédentes, une inégalité qui s'est nettement réduite en 2011 et qui s'est maintenue en 2017, comme le montre la figure 5. Comme nous l'avons noté au début, cette stabilité est susceptible de se maintenir à l'avenir, en partie en raison d'une décision délibérée de limiter les changements méthodologiques à l'avenir, mais aussi en raison d'un engagement à passer à un programme d'estimations annuelles dans le monde post-COVID. 7. Conclusion À l'époque de Covid-19, comme à d'autres moments, le PIB est surveillé de près - les décideurs politiques doivent savoir où va l'activité du marché et ce qu'il advient des emplois et des revenus. Mais les limites du PIB valent également la peine d'être répétées, de peur que nous n'oubliions les parties vulnérables de la population, le fait qu'il y a parfois des éléments importants du PIB qui ne sont pas pertinents pour le consommateur médian (ou parfois même pour n'importe quel consommateur) et que le PIB ne tient pas compte de beaucoup de choses qui intéressent les gens, les résultats en matière de santé en étant un exemple frappant. Il est peu probable et même inutile de transformer le PIB en une mesure du bien-être. Nous devons également comprendre comment le PIB est mesuré, les difficultés rencontrées pour le faire et combien d'autres mesures utiles sont incluses dans les comptes nationaux. Mais des indicateurs supplémentaires solides sont nécessaires, tout comme une vision cohérente du bien-être matériel dans le monde entier. La prochaine révision du système de comptabilité nationale a relevé le défi de s'engager dans cette voie. Et l'ICP continue à fournir un grand service aux analystes, aux décideurs politiques et au public. -

FRANCE : 5° puissance économique?
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SPARTAN dans Economie et défense
Le PIB est le produit intérieur brut, ce qui signifie qu'il a été produit dans le pays, mais qu'il n'appartient pas nécessairement à ses résidents. Nous l'avons déjà vu dans le cas de l'Irlande. Un autre point est que le produit intérieur compte les travailleurs là où ils produisent, et non là où ils vivent. Environ 180 000 personnes travaillent au Luxembourg, mais vivent en France, en Allemagne ou en Belgique ; ces travailleurs qui font la navette entre le Luxembourg et l'Irlande ne sont pas comptés parmi les quelque 600 000 résidents du pays, bien qu'ils fassent partie de sa main-d'œuvre, dont ils constituent environ 40 % (Eurostat 2018). Si l'on ajoutait les travailleurs frontaliers à la population résidente, le PIB global par habitant serait inférieur de quelque 20 %. Le RNB par personne résidente donne une image plus précise des revenus de la population résidente. En 2017, il était inférieur de 36 % au PIB par habitant au Luxembourg (bien qu'il soit toujours parmi les plus élevés de l'OCDE). Figure 4. The relationship between consumption and GDP, 2017 Source: Authors’ calculations, based on International Comparison Program (2020). Les pays riches en ressources naturelles soulignent un autre problème concernant le PIB, à savoir qu'il est mesuré en brut et non en net, car il ne tient compte ni de l'épuisement ou de la détérioration ni des découvertes de biens naturels. En effet, pour avoir une image plus complète de la durabilité de l'activité économique, il faut tenir compte des stocks de richesse - naturelle, produite, financière - et de leur évolution dans le temps qui reflète les ajouts (tels que les investissements ou les nouvelles découvertes) ainsi que les déductions (telles que la dépréciation, la détérioration ou l'épuisement). Le classement des 12 premiers illustre un autre point général. Le rapport entre la consommation et le PIB dans les centres d'investissement et les pays riches en ressources se situe systématiquement en dessous de la moyenne ; la figure 4 l'illustre. Le ratio est plus faible, et le phénomène plus évident, lorsque les parts de consommation sont calculées à l'aide des PPA, car le prix de la consommation - avec de nombreux biens non échangeables - est inférieur au prix du PIB, ce qui n'est pas reconnu lorsque les taux de change du marché sont appliqués à la fois au PIB et à la consommation. Il convient de noter qu'un faible ratio consommation/PIB reflète à la fois une réalité économique (probablement déclenchée par des bénéfices relativement élevés par opposition aux salaires et traitements) ainsi que les effets du déplacement des bénéfices, qui peut accroître le PIB dans les pôles d'investissement par rapport à d'autres juridictions. Quoi qu'il en soit, lorsque nous nous intéressons au bien-être matériel, nous devons mettre davantage l'accent sur les mesures relatives à la situation économique des ménages. Heureusement, de telles données se trouvent dans les comptes nationaux de pratiquement tous les pays et peuvent être comparées au niveau international à l'aide des PPA, bien qu'elles doivent être enrichies par des informations sur la répartition, car les moyennes ignorent à quels ménages elles se rapportent. 5. Peut-on vérifier les numéros ICP en utilisant des proxies, comme la lumière émise et vue depuis l'espace ? La discussion de la section précédente montre clairement qu'il existe de nombreux animaux différents dans la ménagerie de la comptabilité nationale, chacun différent des autres, chacun avec ses propres utilisations, chacun avec ses propres forces et faiblesses de mesure, ce qui est même vrai lorsque les concepts sous-jacents semblent être très similaires. Il n'existe pas de mesure unique du revenu national, de l'activité économique nationale ou de la croissance économique nationale. Le RNB est différent du PIB, et le RNN (revenu national net) est différent de l'un ou l'autre. Comme le montre l'exemple irlandais, si nous nous intéressons aux ressources disponibles pour la consommation des gens, nous pouvons vouloir travailler avec le revenu disponible ou avec la consommation réelle. Si nous voulons exclure la consommation fournie par le secteur public, nous avons besoin de la consommation finale des ménages. Si nous nous intéressons à la production, nous devons mesurer la production brute, y compris la production intermédiaire, qui est exclue du PIB, car le PIB mesure la valeur ajoutée et non la production. Au-delà de ces différences conceptuelles, il existe également des différences entre le réel et le nominal et, ce qui est plus pertinent pour l'ICP, entre l'utilisation des prix du marché intérieur ou l'une des nombreuses constructions disponibles des prix internationaux. Tous ces concepts peuvent être utilisés pour mesurer la croissance, ce qui est souvent le principal centre d'intérêt. Il n'existe pas de PIB réel, de revenu national réel, d'activité économique réelle ou de croissance économique réelle. Les différents concepts existent tous pour une raison, généralement parce qu'ils mesurent des choses différentes, qui peuvent toutes nous intéresser à certaines fins. Dire que l'un d'eux, ou un hybride, est le véritable revenu national, c'est comme dire qu'un poney Shetland est le véritable cheval, ou que le loup gris est le véritable chien, ou que le nombre de pics à bec d'ivoire dans une forêt est la véritable mesure de la faune de la forêt. Tout cela ne mérite guère d'être répété, mais il existe une littérature récente de plus en plus abondante qui travaille avec des mesures de substitution qui, selon certains, sont utiles pour recouper les mesures des comptes nationaux, y compris celles de l'ICP. Cette littérature est motivée par les difficultés évidentes de la mesure des comptes nationaux, en particulier dans les pays pauvres qui manquent d'offices statistiques bien financés ou d'infrastructures de données sur lesquelles reposent des offices bien financés. Dans ces circonstances, il y a un rôle pour les substituts qui peuvent nous donner des aperçus nouveaux ou différents ou qui peuvent aider à effectuer des imputations souvent nécessaires. L'une d'entre elles, qui a une longue histoire, consiste à utiliser la part de l'alimentation dans le revenu disponible des ménages comme un indicateur du niveau de vie des ménages, une suggestion qui remonte à Engel au 19e siècle, voir Ålmas (2012) pour un exemple récent. Un indicateur plus récent de l'activité économique est une mesure de l'intensité lumineuse, recueillie par des satellites dans l'espace. L'intensité lumineuse a l'avantage d'être mesurée de la même manière pour tous les pays. Sa mesure est très probablement indépendante de la façon dont les pays mesurent leurs comptes nationaux, ce qui est utile pour toute vérification croisée. Henderson, Storeygard et Weil (2012) montrent comment les données sur l'éclairage peuvent "éclairer" diverses questions, tout en reconnaissant que l'éclairage varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que le nombre d'heures de lumière du jour, la température locale, la fraction de l'éclairage qui provient de l'électricité et les parts de consommation et d'investissement dans le PIB. En effet, l'éclairage pourrait facilement être plus étroitement lié à la production brute dupliquée - la production intermédiaire utilise également de l'électricité - qu'au PIB, ce qui exclut la duplication. C'est un problème sérieux pour la mesure de l'éclairage, car nous ne savons pas quel concept ou ensemble de concepts il est censé représenter. En outre, comme il n'existe pas de mesure "réelle" du revenu national ou de l'activité économique nationale, la lumière (ou la part de la nourriture) ne peut pas être une mesure correcte pour déterminer si le revenu "réel" est mieux mesuré par le PIB aux prix du marché ou aux prix internationaux, comme dans Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2020), même si les corrélations statistiques peuvent être utiles pour imputer ou prévoir les valeurs manquantes. Le PIB aux prix du marché et le PIB aux prix internationaux sont deux choses différentes qui sont utilisées à des fins différentes. Nous avons beaucoup de sympathie pour ceux qui ont été frustrés par les changements de mesures dans les éditions successives du Programme de comparaison internationale, mais nous ne pouvons pas utiliser de variables de substitution pour évaluer leur fiabilité sans comprendre comment les variables de substitution sont liées aux nombreux concepts différents des comptes nationaux. -

scaf FCAS SCAF et connexes (NGWS, drone FCAS - DP etc.)
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de prof.566 dans Europe
C'est sûr que la mise en réseau avec des sémaphores serait plus difficile qu'avec des Datalinks. -

FRANCE : 5° puissance économique?
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SPARTAN dans Economie et défense
Outre la santé, il existe de nombreux autres aspects de la qualité de vie que le PIB ne prend pas en compte : interaction sociale, air pur, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, démocratie, sécurité, bonheur. Ces aspects n'ont jamais été conçus pour être pris en compte par le PIB, comme cela a été constaté depuis la création des comptes nationaux (Kuznets 1934). En fait, de nombreux suppléments au PIB ont été proposés pour donner une perspective sur ces dimensions plus larges, allant de la mesure du bien-être économique de Nordhaus et Tobin en 1972 à l'indice de développement humain du PNUD . Le président français Nicolas Sarkozy a porté le choix, l'utilisation et la communication des indicateurs sociétaux clés à un nouveau niveau politique en commandant le rapport Stiglitz-SenFitoussi (2009) qui a donné un nouvel élan au programme "Au-delà du PIB", y compris l'initiative "Une vie meilleure" de l'OCDE. En bref, l'utilisation judicieuse du PIB et de toutes les mesures de PPA doit partir du constat que des aspects importants du bien-être ne passent pas par le marché et que des indicateurs supplémentaires sont nécessaires. 4. Le PIB, même en dollars internationaux, peut être trompeur Si notre principale préoccupation est le bien-être matériel, la consommation par habitant est un meilleur choix que le PIB par habitant. Si les deux mesures sont en corrélation, elles le sont imparfaitement, et les différences peuvent parfois être d'une grande importance. Certaines de ces différences sont bien connues, par exemple le fait que la part de la consommation dans le PIB est beaucoup plus faible en Chine qu'en Amérique. Un cas moins connu est celui de la figure 3, qui montre les 12 premiers pays classés en fonction de leur PIB par habitant dans le cadre du cycle 2017 de l'ICP. Figure 3 : Les douze premiers pays selon le PIB par habitant dans le cadre du ICP 2017 Source : Programme de comparaison internationale (2020). Les États-Unis mis à part, ils se répartissent tous en deux catégories : ce sont soit des centres d'investissement (définis comme des économies où le stock d'investissements directs étrangers est de 150 % du PIB ou plus), soit des pays basés sur les ressources (définis comme des économies où les rentes de ressources représentent 10 % du PIB ou plus). Dans les deux cas, la consommation représente une part relativement faible du PIB total, généralement parce que les bénéfices représentent une part beaucoup plus importante du revenu national que les salaires et traitements. Avec le temps, les bénéfices contribueront au revenu d'au moins certains ménages du pays et, par conséquent, à leur consommation. Mais à un moment donné, le PIB par habitant comprend des montants qui ne font pas partie du bien-être matériel actuel des gens. De façon encore plus marquée, les revenus provenant des stocks de capitaux étrangers font partie du produit intérieur brut, car ils proviennent du pays, mais ils ne font pas partie du revenu national brut car ils ne sont pas détenus par des nationaux. L'Irlande fournit un exemple intéressant. Attirées en grande partie par les faibles taux d'imposition des sociétés, plusieurs grandes multinationales ont délocalisé leurs activités économiques, y compris les actifs de propriété intellectuelle, en Irlande, de sorte que les revenus générés par l'utilisation de la propriété intellectuelle contribuent désormais au PIB irlandais. En 2015, il y a eu un exemple spectaculaire où le PIB réel irlandais a augmenté de 26 % en une seule année, principalement grâce au transfert d'actifs de propriété intellectuelle des multinationales en Irlande. En revanche, le revenu disponible par habitant des ménages irlandais n'a augmenté "que" de 4,6 % en termes réels et le RNB aux prix constants du marché de 13,6 %9 . La mondialisation, la numérisation, une main-d'œuvre bien formée et un régime fiscal attrayant sont tous à l'œuvre dans le cas de l'Irlande. Il existe également des preuves substantielles que le transfert des bénéfices par divers canaux, tels que la fixation erronée des prix de transfert, peut entraîner des taux de profit très élevés, et le PIB, dans les centres d'investissement. La différence exacte entre le PIB et le RNB peut être d'une complexité déconcertante ; les personnes peu enthousiastes voudront peut-être sauter le reste de ce paragraphe. Par exemple, cela dépend de l'implantation ou non du siège dans le pays. Si une société affiliée est établie dans un centre d'investissement mais que le siège social reste à l'étranger, le RNB ne devrait pas être affecté par un comportement de déplacement des bénéfices : supposons que la société affiliée fournisse des services surévalués au siège social, les bénéfices apparaîtront alors dans le PIB du centre d'investissement mais pas dans son RNB car le système de comptabilité nationale impute un flux de revenus au pays du siège social même si les bénéfices sont réinvestis dans la société affiliée et ne sont pas réellement transférés en retour. En revanche, si le siège social est établi dans le centre d'investissement dont les bénéfices sont artificiellement gonflés, une telle imputation n'a pas lieu. Le RNB restera élevé, en ligne avec le PIB, à moins que les bénéfices ne soient effectivement transférés à l'étranger sous forme de dividendes - le RNB serait alors réduit -

FRANCE : 5° puissance économique?
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SPARTAN dans Economie et défense
Nous pensons que la cohérence entre ICP 2017 et ICP2011 marque une nouvelle maturité et stabilité du programme. Lors des prochains cycles, l'ICP prévoit de passer à un programme de données continu, où de nouvelles données sont collectées et incorporées en permanence, ce qui devrait garantir davantage la cohérence dans le temps que les utilisateurs exigent et attendent. 3. Un élément important qui n'est pas inclus : les résultats en matière de santé Le PIB inclut les dépenses de santé, mais il ne nous dit rien sur les résultats de santé, un exemple notable d'une composante importante du bien-être qui est omise et qui est d'une importance évidente pendant une pandémie. Les États-Unis dépensent deux fois plus que les autres pays pour les soins de santé, mais ont l'espérance de vie la plus faible de tous les pays riches ; voir la figure 2 ci-dessous. Au-delà, Covid-19 a montré que presque tous les pays, riches et pauvres, sont prêts à sauver des vies en renonçant à leur PIB afin de réduire l'infection et la mortalité. Cela est vrai à court terme en acceptant le verrouillage des marchés et peut-être aussi à plus long terme : la mise en place de systèmes de soins de santé plus résistants et d'économies à l'épreuve des infections impliquera de renoncer à une certaine croissance de la productivité et du PIB en échange de la sécurité et du bien-être à long terme. Quelque peu paradoxalement, la prévention des infections - une dépense défensive pour nous ramener à la situation d'avant - sera comptabilisée dans le PIB, et comme les réparations après un ouragan, fera augmenter le PIB au-delà de ce qu'il aurait été autrement. La production a augmenté, mais notre capacité à consommer et à investir a été ramenée à ce qu'elle était dans un monde sans pandémie. Il existe une forte association entre la mortalité, la morbidité et le PIB par habitant (Preston, 1975, Deaton 2003, 2013, Mackenbach et Looman 2013, Shkolnikov et al 2019), de sorte que les habitants des pays pauvres vivent moins longtemps que ceux des pays riches (principalement en raison d'une mortalité infantile et juvénile plus élevée), tandis que les pays les plus riches du monde jouissent d'une espérance de vie à la naissance qui atteint aujourd'hui près de 80 ans en moyenne dans la région de l'OCDE (figure 2). Bien sûr, il y a de nombreuses exceptions, aussi bien des pays pauvres avec une espérance de vie relativement élevée (Rwanda, Bangladesh) que des pays riches avec une espérance de vie relativement faible (Guinée équatoriale, États-Unis). Un PIB par habitant élevé ne garantit pas une morbidité et une mortalité faibles : les plus riches ne sont pas automatiquement en meilleure santé. Figure 2. Espérance de vie à la naissance et consommation individuelle réelle par habitant, 2017 Source : Programme de comparaison internationale (2020), Indicateurs du développement dans le monde (2020) : les surfaces des cercles sont proportionnelles à la population de chaque pays. Le virus COVID-19 et la mortalité qui lui est associée modifient encore la relation entre le PIB par habitant et la mortalité. Les pays riches disposent de nombreux avantages - de meilleurs systèmes de santé, une plus grande capacité à remplacer le contact physique par l'électronique et une plus grande richesse qui se réduit lorsque les revenus diminuent - mais, au moins jusqu'à la date de rédaction du présent rapport (novembre 2020) et compte tenu des problèmes de mesure dans les pays à faible revenu, il semble exister une forte relation positive entre les pays, ainsi qu'entre les régions au sein des pays, entre le PIB par habitant et le nombre de décès dus au COVID par million d'habitants. (Il convient de noter que cela contraste fortement avec ce qui se passe au sein des pays ou des régions, où les pauvres risquent davantage que les riches de mourir du virus). Un facteur qui favorise véritablement les pays pauvres est leur structure d'âge plus jeune, étant donné que les taux de mortalité par COVID sont plus élevés chez les personnes âgées. Le COVID semble s'être d'abord propagé le long des routes commerciales (Wuhan, Milan, Paris, Londres, New York), amenant la maladie dans certaines des villes les plus riches du monde en premier, des villes où les gens vivent à proximité les uns des autres et ont beaucoup de contacts entre eux. La corrélation entre le PIB par habitant et la mortalité par habitant diminue au fil du temps, à mesure que les pays riches maîtrisent la maladie, que la maladie se propage dans les pays pauvres et que l'impact de la pandémie se fait pleinement sentir dans les pays où la notification de la mortalité est faible. En fin de compte, le modèle familier de santé et de richesse peut se réaffirmer, mais il est trop tôt pour en être sûr et la pandémie peut laisser une marque permanente sur la relation mondiale entre la santé et la richesse, ainsi que sur les inégalités mondiales. Ce serait certainement une erreur de mettre en avant la corrélation positive à long terme entre le PIB et l'espérance de vie et de prétendre qu'avec le rétablissement de la croissance économique, la santé s'occupera d'elle-même. Le PIB par habitant n'est pas une mesure abrégée de l'état de santé de la population. Et des niveaux élevés de PIB par habitant n'ont rien fait pour protéger les pays contre les décès dus à la pandémie, et il se peut qu'ils ne protègent pas les pays contre d'importantes pertes de revenus dues à la pandémie, soit directement parce que les gens ne peuvent pas travailler, soit en raison des réponses des gouvernements sous la forme de verrouillages. Le FMI, dans son rapport d'octobre 2000, prévoit une croissance positive de 1,9 % en 2020 pour la Chine, contre une baisse de 4,3 % pour les États-Unis et de 9,8 % pour le Royaume-Uni. Le PIB par habitant de l'Afrique devrait se contracter de 2,6 %, contre 5,8 % pour les "pays avancés" et 8,3 % pour la zone euro. Ces prévisions, si elles se réalisent, ou des chiffres similaires, entraîneront une forte réduction des inégalités dans le monde. -

FRANCE : 5° puissance économique?
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SPARTAN dans Economie et défense
LE PIB, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ : RÉFLEXIONS SUR LE CYCLE 2017 DU PROGRAMME DE COMPARAISON INTERNATIONALE RÉSUMÉ En mars 2020, le Projet de comparaison internationale a publié ses derniers résultats, pour l'année civile 2017. Ce cycle présente des données sur le produit intérieur brut et ses composantes pour 137 pays, en unité commune ou en parité de pouvoir d'achat. Nous passons en revue un certain nombre de questions importantes, ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas et ce que les nouvelles données peuvent et ne peuvent pas faire. Il est très important de noter que les résultats sont globalement conformes aux résultats antérieurs de 2011. Nous examinons la relation entre les mesures de comptabilité nationale et la santé, en particulier à la lumière de l'épidémie COVID-19 qui pourrait réduire les inégalités mondiales, même si elle accroît les inégalités au sein des pays. Nous soulignons des choses que le PIB ne peut pas faire, certaines familières - comme son silence sur la distribution - et d'autres moins - comme son détachement croissant du bien-être matériel national dans un monde globalisé où les transferts internationaux de capitaux et de droits de propriété peuvent avoir des effets énormes sur le PIB, comme l'augmentation de 26 % du PIB de l'Irlande en 2015. 1. Introduction Début mars 2020, alors que le monde s'enfermait face à la pandémie COVID-19, le Programme de comparaison internationale (ICP) a achevé sa dernière série de résultats, pour 2017. L'ICP est l'une des plus grandes initiatives statistiques au monde, que ce soit en termes de coût, de couverture géographique (176 pays en 2017), d'implication institutionnelle ou de longévité (il a débuté en 1968). Dès son lancement, l'ICP a eu pour objectif de produire des comparaisons unitaires communes et comparables au niveau international du produit intérieur brut (PIB) et de ses principales composantes. Il n'est pas surprenant que les nouveaux résultats aient reçu moins d'attention que la normale, rappelant à point nommé, si besoin était, que le bien-être matériel vient en second lieu lorsqu'il y a une menace pour la santé. Le PIB omet beaucoup de choses qui sont essentielles au bien-être des personnes. Pourtant, le PIB reste l'une de nos mesures les plus importantes et les plus utiles et toute mesure plus complète du bien-être est impossible sans les comptes nationaux, correctement interprétés et ajustés. Les mesures du PIB s'ajoutent à d'autres mesures - actuellement liées à la santé - pour évaluer les conséquences de la pandémie et, comme le montrent les offices statistiques de l'OCDE, la demande d'informations sur le PIB et ses composantes a augmenté de façon spectaculaire depuis mars 2020. L'ICP se distingue par le fait qu'il se concentre sur des mesures comparables au niveau international, en supprimant les distorsions grossières qui peuvent résulter de l'utilisation des taux de change du marché pour convertir les comptes nationaux. Sans lui, il serait impossible d'établir des comparaisons internationales similaires des niveaux de vie matériels et des taux de pauvreté. Pourtant, le PIB laisse beaucoup à désirer, même au-delà de la santé. Si nous voulons utiliser L'ICP pour examiner la répartition, pour savoir qui reçoit quoi, pour évaluer la pauvreté ou les inégalités, il doit être combiné avec d'autres données, généralement issues d'enquêtes sur les ménages. De manière moins évidente peut-être, le PIB laisse non seulement beaucoup de choses en suspens, mais il inclut des transactions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bien-être matériel, ce qui rend dangereux l'établissement de comparaisons internationales non critiques entre les pays. Dans ce bref compte-rendu, nous mettons en évidence les nouveaux résultats les plus importants, ainsi que l'utilisation des nouvelles estimations pour mettre en évidence ce que les chiffres ne nous disent pas, ainsi que certains domaines dans lesquels, en l'absence d'une interprétation prudente, ils peuvent être gravement trompeurs. 2. Nouvelles découvertes importantes La figure 1 montre ce qui est sans doute le résultat principal de l'ICP2017, à savoir que l'économie chinoise est désormais aussi importante ou un peu plus importante que celle des États-Unis. En termes de taux de change du marché, qui ne tiennent pas compte du fait que les prix sont plus bas en Chine, la Chine est beaucoup plus petite que les États-Unis. Le nouveau résultat confirme la même constatation de l'ICP2011, le premier cycle à documenter les tailles comparables des deux économies. En effet, les niveaux de prix dans la plupart des pays sont inférieurs à ceux des États-Unis, de sorte que pour tous les pays de la figure 1, leurs PIB sont plus importants en dollars de parité de pouvoir d'achat qu'en dollars du marché. Les PIB mondiaux sont plus proches l'un de l'autre lorsqu'ils sont mesurés en unités communes. L'une des principales conclusions des résultats de 2017 est qu'ils ne sont pas très différents de ce à quoi nous nous serions attendus si nous avions extrapolé les résultats de 2011 en utilisant les taux de croissance du PIB national et les indices de prix nationaux pertinents, tels que les ICP et les déflateurs des prix du PIB. Cela peut sembler être un non-résultat, et une chose étrange à souligner, mais c'est en contraste flagrant avec les résultats des années précédentes. Les résultats de 2011 pour la consommation et les revenus ne correspondent pas aux niveaux qui auraient été attendus en appliquant les taux de croissance aux résultats du cycle précédent en 2005. Les résultats de l'ICP 2005 ne correspondent pas non plus aux extrapolations du cycle précédent de 1993. Nous reviendrons sur les conséquences de ces divergences ci-dessous lorsque nous aborderons les questions de répartition. Figure 1 : Dimensionnement de certaines économies Source : Programme de comparaison internationale (2020) Cette stabilité de l'ICP est importante si l'on veut que les économistes et les commentateurs fassent confiance à son résultats et l'instabilité des deux cycles précédents a été une cause de grande consternation et de une interprétation erronée, par exemple sur l'évolution de la pauvreté dans le monde. Les procédures statistiques en 2017 a suivi de près les procédures utilisées en 2011, une décision délibérée qui a été prise au début de la la préparation du cycle de 2017. Cette situation contraste avec les cycles précédents où de nouvelles méthodes - souvent des méthodes améliorées ont été introduites à chaque tour. Bien sûr, le monde change, et il y a de nouveaux défis statistiques à chaque cycle - COVID-19 en apportera sans doute d'autres pour le prochain et a déjà repoussé la collecte de données - il y a donc toujours une tension entre l'utilisation de meilleures méthodes et en garantissant des résultats stables. -

scaf FCAS SCAF et connexes (NGWS, drone FCAS - DP etc.)
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de prof.566 dans Europe
Les systèmes les plus courants prévoient une méthodologie différente, qui est fixée à la technologie plutôt qu'à l'époque. En particulier, le modèle publié par l'American Air Force Magazine en 2009 est largement utilisé (voir figure 2). Il divise cinq générations existantes en fonction de jalons technologiques. Ce système envisage une sixième génération comme la prochaine étape de développement et lui attribue, entre autres, des caractéristiques telles que l'effectif optionnel. Le Tornado et l'Eurofighter sont classés respectivement comme Génération 4 (Tornado) et 4+ (Eurofighter), ce qui est également le consensus dans la discussion allemande. Le Rafale (4+) et le Mirage 2000 (4) français sont sur le même spectre. L'attribution d'un type d'avion à une certaine génération peut donc être très controversée et fait finalement toujours partie des efforts de marketing des entreprises de fabrication. Pour chacun des niveaux de génération, plusieurs critères ont été définis qui doivent être remplis pour la classification. Il n'est pas clair s'ils peuvent être mis en balance. Par exemple, une meilleure technologie radar permet-elle de compenser le manque de vitesse ? Si le terme de génération est utilisé, il doit être classé et expliqué et ne doit pas se suffire à lui-même. L'étiquette "Next Generation", telle qu'elle est utilisée dans les composants du FCAS, fait référence à la systématique décrite (voir figure 2), mais permet également d'autres interprétations. Si l'on suit l'affirmation selon laquelle le NGF devrait être un chasseur de sixième génération, on utilise le F-35 comme référence technologique. Cela implique en outre qu'il faut sauter une génération si l'on veut passer de l'Eurofighter à la sixième génération de NGF sans étape intermédiaire. Cela ne sera guère possible, principalement parce que les caractéristiques de la cinquième et de la sixième génération, comme la technologie de la furtivité, n'ont encore été construites par aucune des entreprises concernées et sont considérées comme très exigeantes. D'autre part, l'expression "prochaine génération" peut également s'appliquer aux avions qui existent aujourd'hui. Cela relativiserait quelque peu le NGF, car il ne devrait alors "plus" être plus moderne que l'Eurofighter et le Rafale et ne devrait plus explicitement former la sixième génération. Du point de vue allemand, il est logique que le développement du NGF se base sur le statut technologique de l'Eurofighter. Dans ce cas, la poursuite de l'évolution en direction du FNG devrait se faire principalement dans les domaines qui ne sont pas actuellement couverts par l'Eurofighter, c'est-à-dire principalement dans la guerre électronique en tant que technologie nationale clé. La dimension nucléaire d'un futur système aérien de combat Les questions de souveraineté technologique et d'affectation générationnelle du FNG jouent également un rôle crucial en ce qui concerne la capacité nucléaire d'un FCAS. La France considère la dissuasion nucléaire comme une pierre angulaire essentielle de sa propre souveraineté et de celle de l'Europe, et lui a consacré 37 milliards d'euros dans son budget militaire jusqu'en 2025. Le potentiel nucléaire de la France est le quatrième au monde, avec environ 300 ogives. En plus des sous-marins équipés de missiles balistiques, la France possède des missiles de croisière nucléaires transportés par le chasseur Rafale, y compris à partir de porte-avions. D'un point de vue français, le FNG, en tant que successeur du Rafale, doit nécessairement être capable de remplir cette tâche. Il en résulte deux exigences de capacité : premièrement, le transport de l'arme nucléaire de combat ASMP, et deuxièmement, la capacité d'atterrir sur des porte-avions. Du côté allemand, le lien entre le FCAS et le rôle nucléaire est plus indirect. Aujourd'hui, la Bundeswehr participe au partage nucléaire de l'OTAN avec sa flotte Tornado. Des bombes nucléaires en chute libre sont stationnées en Allemagne à cette fin. L'avenir de ce rôle est politiquement controversé. Les critiques réclament notamment la fin du partage nucléaire, car il garantit l'absence d'influence sur la stratégie nucléaire américaine et l'utilisation d'armes nucléaires est injustifiable sur le plan éthique et en vertu du droit international. Ce débat s'est cristallisé sur la question du successeur du Tornado. Du point de vue du gouvernement fédéral, la poursuite du partage nucléaire est une exigence de capacité élémentaire dans la sélection des avions de combat. L'opposition, en revanche, a présenté une motion au Bundestag allemand pour mettre fin au partage opérationnel du nucléaire et ne plus certifier un avion de combat à cette fin. En avril 2020, le ministère fédéral allemand de la défense (BMVg) a proposé une solution dans laquelle il souhaite remplacer les Tornados de l'armée de l'air par des modèles de F-18 américains (génération 4+). Pour cela, elle utilise le terme de "solution de transition", car l'objectif est d'assurer la disponibilité opérationnelle pendant la période entre l'élimination prochaine de Tornade et du NGF, qui ne sera probablement pas disponible avant 2040. Cependant, il n'y a aucune indication concrète sur la manière dont le rôle du nucléaire sera pris en compte à l'avenir. Si l'on suit la logique de l'image d'un pont, le F-18 américain serait initialement envisagé comme le porteur d'armes nucléaires dans ce scénario. Cependant, il ne dispose pas actuellement de la certification nécessaire des États-Unis pour l'utilisation nucléaire. Plus tard, le NGF devra reprendre ce rôle, pour lequel il aura également besoin d'une certification nucléaire. Cette circonstance en particulier semble problématique dans la perspective d'aujourd'hui : il faudrait tout d'abord trouver une solution technique à l'exigence selon laquelle les armes américaines et françaises devraient pouvoir être déployées avec cet avion. Une telle combinaison n'existe pas actuellement. Cela rendrait le projet encore plus complexe, car il faudrait non seulement clarifier les aspects techniques (arme à chute libre contre missile de croisière), mais aussi les aspects liés au secret. Deuxièmement, la question de savoir si l'Eurofighter pourrait être certifié nucléaire a déjà montré que cela impliquerait des obstacles importants. À cette fin, la documentation technique de l'avion de combat et de tous les autres équipements impliqués dans la mission doit être régulièrement divulguée. Tous les États utilisateurs doivent donner leur consentement, la question est donc très sensible pour des raisons de secret militaire et industriel. Comme le FNG sera explicitement le transporteur d'armes nucléaires français, il fait partie de l'autonomie stratégique de la France. Par conséquent, l'approbation française requise pour la certification semble incertaine dans la perspective d'aujourd'hui - il s'agit aussi, en fin de compte, des DPI, qui constituent un fil conducteur dans l'ensemble du projet. Si l'Allemagne s'en tient à la solution du pont F-18, elle disposera peut-être d'un nouveau transporteur nucléaire, mais devra relever le défi de l'intégrer dans le système FCAS global. Il en résulterait un affaiblissement implicite de l'alliance et des coûts supplémentaires pour la gestion de la flotte. Dans le pire des cas, il pourrait même devenir évident que le FNG n'est pas un successeur viable au rôle nucléaire ; dans ce cas, il serait lié à un système de génération 4+ pendant des décennies. Des doutes sont déjà émis sur l'adéquation opérationnelle du partage nucléaire aéroporté et sont d'autant plus justifiés que les avions porteurs sont anciens. Il n'est donc pas improbable que la solution du pont devienne la solution permanente ou que, nolens volens, le partage nucléaire sous sa forme actuelle soit remis en question. L'Allemagne et la France font face à cette dimension avec des perceptions différentes de la dissuasion et de la souveraineté, ce qui se reflète dans le débat sur le développement à tous les niveaux. Il est indéniable que le FCAS est aussi un projet nucléaire. Paris l'exprime clairement ; Berlin ne doit pas fermer son esprit à cette réalité, mais doit avoir la même prétention de la façonner dans ce domaine. L'avenir du partage du nucléaire devrait être abordé concrètement au cours de la prochaine législature. Si le gouvernement allemand se contente de permettre au FCAS de continuer, il se privera de ses propres possibilités d'action, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le rôle de l'Allemagne dans l'Alliance. Perspectives et recommandations Les différences entre les cultures stratégiques de l'Allemagne et de la France se manifestent dans de nombreux domaines. Le FCAS est un autre exemple où les partenaires sont conscients de leurs différences et, en même temps, de leur interdépendance. Du point de vue français, le projet est d'une part une expression de la souveraineté européenne et d'autre part une composante essentielle de la sécurité nationale et des intérêts industriels. En Allemagne, cette importance stratégique se perd dans le fouillis de responsabilités du processus de passation des marchés. Pour la suite du projet, il est nécessaire de changer la perception du projet. Un engagement plus fort de la part de la Chancellerie fédérale peut permettre d'atteindre cet objectif. Le FCAS n'est pas seulement un autre projet de défense coûteux, c'est bien plus. Il vise à développer et à cultiver en Europe une excellence technologique capable d'avoir un impact bien au-delà du secteur militaire. Des applications telles que les services européens sécurisés dans les nuages ou les commandes de vol autonomes sans pilote sont des moteurs technologiques dont le potentiel est tout aussi pertinent pour l'utilisation civile. Le développement et la souveraineté en matière de données sont étroitement liés à la revendication d'utiliser en priorité les produits européens. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de considérer le FCAS comme un système complet. Le calendrier du projet est très ambitieux compte tenu de la complexité du projet et des nombreuses inconnues. Le premier vol du NGF en 2035 et le début du déploiement en 2040 ne seront possibles que si toutes les mesures s'imbriquent sans délai, ce qui, dans la perspective d'aujourd'hui, est peu probable. Le problème le plus urgent est la réglementation des DPI. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y aura bien sûr des retards. Il faut cependant éviter les retards supplémentaires dus aux ambiguïtés politiques, au manque de sécurité financière et aux incohérences de procédure. Du côté allemand, il y a certainement un plus grand besoin de rattrapage ici. Une réforme fondamentale du processus de passation des marchés constitue un moyen nécessaire d'améliorer la situation. Une hiérarchisation politique du projet serait opportune et réalisable à court terme. Compte tenu de l'explosivité politique et de l'importance militaire du projet, un futur gouvernement allemand devrait désigner le FCAS comme un projet prioritaire et phare européen dans l'accord de coalition. Dans le cadre d'une loi sur les plans de défense faisant partie d'une réforme du processus d'armement, les prochaines phases du projet pourraient être définies et financées sur une base annuelle. D'une part, cela aurait un effet de signal fort vis-à-vis de Paris et, d'autre part, offrirait une sécurité de planification à la Bundeswehr et à l'industrie. En outre, la perspective européenne du projet doit être élargie. Cela implique également de considérer le projet, probablement avant tout la composante FNG, comme un produit d'exportation et de s'assurer que les réglementations appropriées sont en place. La tâche des futurs gouvernements fédéraux consistera d'abord à intégrer pleinement l'Espagne et à gagner d'autres partenaires à moyen terme, mais plutôt en tant que clients qu'en tant que promoteurs. Plus une entrée en tant que promoteur est tardive, plus elle sera complexe, car il faudrait rouvrir des sites de construction déjà fermés. La part des NGWS en particulier est plus avancée que celle d'autres projets comparables en Europe, par exemple le projet britannique Tempest ; la poursuite des efforts d'intégration ne devrait pas compromettre cette avance. La France, l'Espagne et l'Allemagne ne disposent pas actuellement d'un avion de combat de cinquième génération, contrairement au Royaume-Uni ou à l'Italie, par exemple. Pour les trois nations du FCAS, la NGF est un élément irremplaçable des plans futurs de leurs forces aériennes. Sur le plan technologique, cependant, l'idée de passer directement de la quatrième à la sixième génération et de la définir est extrêmement difficile. Les attentes excessives doivent être tempérées, en dépit de toute ambition justifiée. L'objectif doit être de développer une plate-forme qui représente une avancée significative à la fois sur l'Eurofighter et le Rafale et qui, de plus, est capable de concurrencer le F-35 sur le marché. Définir une génération 5+, avec l'avion à réaction devenant la norme européenne, serait mieux qu'une solution coûteuse qui imite la "vraie" sixième génération et ne peut être pleinement utilisée par aucun État. Quant au calendrier, la question de savoir s'il faut mettre davantage l'accent sur l'achèvement de la partie du FNG peut se poser. L'intérêt de la France pour cette question devrait être très élevé, ne serait-ce qu'en raison de son rôle de leader dans ce segment et du manque d'alternatives dans le secteur des chasseurs. Bien que l'idée générale doive être de voir un système total dans le FCAS, cette priorisation en faveur de la part la plus tangible peut devenir raisonnable dans certaines circonstances. Si ce projet n'est pas réalisé dans un cadre européen, il est de plus en plus improbable que des efforts conjoints importants en matière d'armement soient déployés en Europe. Les efforts visant à consolider les efforts européens en matière d'armement seraient contrariés et les dépendances vis-à-vis des fabricants américains continueraient de s'accroître. C'est avant tout cette responsabilité paneuropéenne dont les partenaires doivent toujours être conscients. Dominic Vogel est chercheur au sein du groupe de recherche sur la politique de sécurité. Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, 2020 Tous droits réservés Le Courant reflète les vues de l'auteur. -

scaf FCAS SCAF et connexes (NGWS, drone FCAS - DP etc.)
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de prof.566 dans Europe
Le futur système aérien de combat : trop grand pour échouer Des perceptions différentes et une grande complexité mettent en danger le succès du projet d'armement stratégique SWP Update 2020/A 98, décembre 2020, 8 pp. Sujets : Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), Bundeswehr, politique de défense allemande, technologie militaire, politique d'armement, industrie de l'armement, politique de sécurité et de défense / forces armées et armée, politique de sécurité et de défense / armée d'un pays / d'une région, politique technologique Le développement du Future Combat Air System (FCAS) est le plus important projet d'armement européen. Tant sur le plan technologique que militaire, le projet a le potentiel d'établir de nouvelles normes et de révolutionner l'utilisation de la puissance aérienne. Politiquement, le projet multinational est un test décisif de la capacité de l'Europe à coopérer en matière de politique de sécurité, à développer ses propres capacités et à mettre les intérêts nationaux à l'arrière-plan à cette fin. Berlin et Paris portent une responsabilité particulière dans la réussite du projet. Cependant, leurs différentes perspectives et procédures la compromettent - un échec aurait de graves inconvénients pour toutes les parties concernées. Les origines du Future Combat Air System remontent à 2001, lorsque les premières études sur le développement de nouveaux avions de combat dans le cadre d'une alliance européenne ont débuté. Le projet global FCAS devrait être prêt à être déployé d'ici 2040. Le terme "Future Combat Air System" ou son acronyme FCAS est souvent utilisé de manière trompeuse. Bien qu'il y ait bien sûr des liens avec la solution qui succédera aux jets Tornado, le FCAS est bien plus qu'un projet d'avion de combat. La stratégie de l'aviation militaire parle d'un système de systèmes qui doit constituer l'épine dorsale de l'armée de l'air à long terme. En conséquence, le FCAS n'est pas une plate-forme de vol unique, mais plutôt un réseau de systèmes composé de systèmes existants (par exemple, les Eurofighters ou les hélicoptères de combat Tigre), mais aussi de nouveaux développements tels que l'Eurodrone et un système d'armes de nouvelle génération (NGWS). Le système d'armes de nouvelle génération est le noyau novateur tangible du projet FCAS. Il se compose d'un nouvel avion de combat, le Next Generation Fighter (NGF), et dans une certaine mesure de plateformes autonomes (Remote Carrier, RC), tous interconnectés dans un système d'échange de données protégé appelé Air Combat Cloud (ACC). FCAS et NGWS ne sont pas synonymes, mais le second fait partie intégrante du premier. Le système FCAS global peut être considéré comme un arrangement de cercles concentriques : Au centre se trouve le NGF en tant que chasseur de la prochaine génération. Dans le cercle intérieur, cela forme le système d'armes de nouvelle génération avec les téléporteurs, qui est connecté et contrôlé via le nuage de combat aérien. Dans le cercle extérieur, le NGWS est mis en réseau avec d'autres systèmes. Il s'agit d'avions de chasse comme l'Eurofighter ou le Rafale français, mais aussi de ravitailleurs, de navires de guerre, de satellites et de moyens des autres forces armées intégrées. Ce composite est le Future Combat Air System, dans lequel tous les éléments doivent constamment communiquer entre eux pour former une équipe. Ainsi, la valeur militaire sera moins dans les plates-formes individuelles et plus dans la façon dont elles sont combinées. Si nous transférons cette architecture aux systèmes existants de la Bundeswehr, cela signifie que l'Eurofighter sera développé plus avant et continuera à fonctionner au sein du FCAS, tandis que le Tornado sera remplacé par un autre système qui devra être intégré au FCAS. La complexité conceptuelle rend difficile un débat axé sur les faits. Certaines publications tournent autour du FCAS, mais ne concernent en fait que la composante avion de combat. Il en résulte une perte de clarté et de profondeur des détails. Si le FCAS est réduit à la composante FNG, la complexité et la portée du projet sont sous-estimées et les sous-composantes pertinentes telles que le développement de téléporteurs sont ignorées, c'est-à-dire le développement d'une technologie pour des drones armés au moins semi-autonomes. La forme concrète d'un FCAS peut varier dans chaque pays partenaire, et les plateformes intégrées seront différentes. Peut-être qu'à l'avenir, les nations individuelles n'utiliseront que le cercle intérieur avec le NGWS ou ne déploieront que le NGF ou des transporteurs individuels à distance dans leurs forces armées. Malgré toutes ces possibilités, il est important que le FCAS soit toujours compris comme un système total. L'architecture du projet tient compte de cette conception. Le FCAS est divisé en un total de sept domaines de développement (piliers), avec une entreprise qui prend la tête de chacun d'entre eux (voir diagramme 1). A suivre Le développement de ces piliers distincts se fait à des rythmes différents et sur la base de contrats distincts. Elle suit une approche progressive. L'intention est explicitement de ne pas attendre que toutes les composantes soient pleinement développées, mais plutôt de mettre à disposition des résultats intermédiaires afin de rassembler des connaissances pratiques pour la suite du processus. L'Allemagne et la France jouent les rôles clés dans les domaines du développement ; l'Espagne a rejoint tardivement cette organisation. Les possibilités de participation des entreprises espagnoles découlent, d'une part, des lacunes qui se font encore jour et qui doivent être comblées de manière significative et, d'autre part, des intérêts de la politique industrielle. Bien qu'il soit souligné que les sept piliers apporteront des contributions significatives, les résultats les plus tangibles et les plus formateurs sont certainement à attendre dans les domaines des aéronefs, y compris les moteurs et les drones (transporteurs à distance). La perception du FCAS comme un projet franco-allemand est en fait devenue obsolète avec l'adhésion de l'Espagne. Compte tenu de la répartition des paquets de développement entre l'Allemagne et la France et de l'avancement du projet, cela est néanmoins valable. L'un des principaux domaines d'action pour la poursuite du développement est la pleine intégration de l'Espagne, qui peut également servir de modèle pour l'inclusion ultérieure d'autres partenaires. Il est important ici de permettre à l'Espagne de participer le plus rapidement possible à l'avancement du projet et de créer ainsi un point d'accueil commun aux trois pays parrains. Différences culturelles et structurelles entre Paris et Berlin L'Allemagne s'est appuyée sur la coopération multinationale européenne plus tôt, pour Tornado et Eurofighter. La France, en revanche, a opté pour des approches nationales de développement. Berlin et Paris sont des partenaires inégaux réunis dans un projet d'armement ambitieux, parfois visionnaire. Cependant, leurs différentes cultures politiques et stratégiques déteignent également sur des projets communs tels que le FCAS. Le système présidentiel centraliste de la France contraste avec le fort parlementarisme de l'Allemagne, tandis que la prétention de la France à être capable d'une action militaire unilatérale contraste avec l'orientation de l'Allemagne vers des structures multilatérales. Le FCAS est donc un projet politique à part entière - les différences mentionnées ci-dessus peuvent en effet toujours donner lieu à des malentendus et donc à des risques qui doivent être traités au niveau gouvernemental. Compte tenu de la complexité et des multiples implications du projet, les participants allemands doivent être clairs quant à leurs propres intérêts, à ceux de la France et de l'Europe. Le FCAS suit le principe du "meilleur athlète" : Chaque entreprise doit être responsable du domaine pour lequel elle a déjà démontré ses capacités. Dans chaque cas, la nation leader est soutenue dans son pilier par un partenaire principal. Cette division concerne principalement les phases de démonstration du projet (phases 1B et 2), qui sont maintenant imminentes. Une question cruciale qui se pose à ce stade concerne la protection de la propriété intellectuelle émergente ou existante : dans quelle mesure les entreprises doivent-elles divulguer leurs procédés et leur savoir-faire, dans quelle mesure les spécifications techniques seront-elles ultérieurement mises à disposition entre les partenaires ? Un accord sur la manière de traiter les droits de propriété intellectuelle (DPI) est élémentaire pour la poursuite du projet et a un impact sur de nombreuses questions individuelles. Par exemple, il déterminera en fin de compte la manière dont l'utilisation des différents composants est organisée. L'entretien et la réparation ne peuvent-ils être effectués que de manière industrielle par le fabricant principal, ou l'accès à la documentation est-il garanti à un point tel que cela peut être fait en grande partie dans les forces armées avec l'aide de la coopération industrielle nationale ? Si seul le fabricant peut et est autorisé à effectuer certaines parties de la maintenance, cela peut affecter l'état de préparation opérationnelle. Ces questions juridiques sont également pertinentes pour les adaptations et les développements ultérieurs tels que l'intégration de nouveaux systèmes d'armes ou d'avionique. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France utilisent pour leurs avions des systèmes d'armement différents, en partie purement nationaux. Si certaines parties de la documentation technique restent sous clé, un goulot d'étranglement pourrait également se former ici. Outre ces effets très pratiques, les aspects de la politique industrielle jouent un rôle primordial. Les intérêts allemands sous forme de technologies nationales clés (par exemple, la technologie des capteurs et la guerre électronique) et les intérêts français relatifs à l'autonomie stratégique industrielle nationale (par exemple, la capacité de développer un avion de combat entièrement en interne) sont opposés. L'objectif d'une solution européenne doit être de minimiser, voire d'éviter complètement, les boîtes noires en matière de technologie, comme c'est souvent le cas aujourd'hui avec les importations américaines. Avant que le FCAS puisse passer à la phase 1B et donc au développement des démonstrateurs, ces questions doivent être résolues et fixées contractuellement dans les différents piliers du projet. Berlin et Paris poursuivent chacun leurs propres intérêts (économiques) nationaux en matière de politique industrielle. Le secteur français de la défense est cependant structuré de manière fondamentalement différente de son homologue allemand. L'industrie française de la défense est étroitement liée à l'État et apparaît comme un complexe cohérent. La Direction générale de l'armement (DGA) est le coordinateur suprême de tous les projets d'armement et le point de contact central pour toutes les questions relatives à l'équipement. Cependant, c'est plus qu'un bureau d'achat français. Par exemple, la DGA est responsable d'un pool national d'ingénieurs militaires (corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, IETA), qui sont spécifiquement formés par des missions dans l'armée, mais aussi par des échanges avec l'industrie. Il existe donc un degré de perméabilité beaucoup plus élevé entre l'armée et l'industrie, ainsi que des liens culturels et personnels intensifs. Au contraire, le flux d'informations entre le gouvernement et l'industrie est formalisé et fait naturellement partie de la politique de défense nationale. Non seulement la partie allemande n'a pas de contrepartie institutionnelle à la DGA, mais l'industrie allemande est également beaucoup moins homogène. Ce déséquilibre culturel institutionnel et technique entraîne des malentendus des deux côtés. Alors qu'en France, la DGA, en tant que point de contact, contrôle tout de manière centralisée, de la conclusion des contrats aux questions de développement et d'utilisation, en Allemagne, divers acteurs agissent à la fois sur le plan interne et externe : le gouvernement, représenté par le ministère de la défense et le ministère de l'économie ; la Bundeswehr, sous la forme du Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw - Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et de l'utilisation de la Bundeswehr) ; et enfin l'industrie, par le biais d'entreprises individuelles ou de ses organisations faîtières, chacune ayant des rôles et des intérêts différents. Cette différence structurelle favorise la position de la France en général et surtout dans le cas des avions de combat, où elle assure le leadership du développement. En fin de compte, cela montre également que le processus de passation des marchés publics en Allemagne doit être réformé. Sur le concept de "génération" pour les avions de combat Le Next Generation Fighter, le noyau du FCAS, est également décrit comme un chasseur de sixième génération. Elle serait ainsi formellement à la pointe du développement technologique. Les modèles américains F-22 et F-35, par exemple, forment ce qu'on appelle la cinquième génération, actuellement la plus moderne. Les avions de chasse ont longtemps été divisés en générations par les experts. Ce système permet de distinguer les modèles d'avions de chasse sans avoir à traiter à chaque fois les spécificités techniques exactes. La catégorisation est essentiellement basée sur les caractéristiques du stade de développement technique et de la période de développement. La division en générations est donc assez sommaire et devient floue aux transitions entre deux étapes. En outre, les générations en question ne sont pas définies de manière uniforme, ni ne sont des normes généralement acceptées. Il existe même plusieurs approches de la division des générations, dont certaines sont très différentes les unes des autres. En 1990, par exemple, l'historien Richard Hallion distinguait déjà six générations, les modèles alors communs, aujourd'hui obsolètes, tels que le Tornado, le Mirage 2000 ou le F-14 représentant la sixième génération, la plus moderne. -
C'est un ramassis de trucs que j'ai déjà lu avec de temps en temps une interprétation de l'auteur pour que ça ait l'air nouveau.
-

Chine - Inde : Relations bilatérales
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de leclercs dans Politique etrangère / Relations internationales
-

turquie La Turquie
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de madmax dans Politique etrangère / Relations internationales
J'espère que l'Iran va répliquer en disant: "ils ont séparé le Kurdistan..." -

turquie La Turquie
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de madmax dans Politique etrangère / Relations internationales
Si ça s'envenime entre la Turquie et l'Iran, j'achète des pop corn. -

Airborne Aircraft carrier, FiCon Project, piggyback airplane et autres Gremlins
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de BPCs dans Amérique
Sur l'A 380 on pourrait ne garder que le pont supérieur et transformer le pont inférieur et la soute en grande soute avec une ouverture comme tu l'indique. A condition que le plancher ne participe pas trop à la solidité de la structure de l'avion. Et puis il faut penser que l'ouverture en vol va dépressuriser un grand volume. -

Airborne Aircraft carrier, FiCon Project, piggyback airplane et autres Gremlins
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de BPCs dans Amérique
La soute de l'ATL2 n'est pas immense quand même: tu peux y mettre 3600 kg et pour des raisons d'encombrement seulement 2 AM 39 ou 8 torpilles -

USA
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
La cours suprême est contre les allégations de Trump alors que Trump y a nommé 3 juges. -
Le Bonaparte pour faire chier les Anglais.
-
Airbus in conversation with potential A400M buyers, as low-level tests advance Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) Airbus en conversation avec des acheteurs potentiels de l'A400M, alors que les essais à basse altitude progressent Les pilotes d'essai d'Airbus Defence & Space ont effectué un premier essai d'un avion de transport tactique A400M volant de manière autonome à 500 pieds dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), a révélé la société. Lors d'un point de presse le 9 décembre, Ioannis Papachristofilou, directeur des ventes de la société pour l'Europe et le Canada pour les avions de transport, a déclaré que le vol d'essai avait été effectué dans la région de Toulouse le 19 novembre. Il comprenait l'utilisation du pilote automatique et de l'accélérateur automatique du type quadrimoteur, ajoute-t-il. La certification pour le mode de fonctionnement IMC à bas niveau devrait être obtenue en 2021, après de nouveaux essais. L'Atlas a déjà obtenu l'autorisation de voler à 500 pieds dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC). L'Atlas a déjà approuvé le vol à basse altitude pendant les opérations VMC M. Papachristofilou s'attend à ce qu'Airbus atteigne son objectif de livrer huit A400M cette année, malgré les effets de la pandémie de coronavirus. Le 95e exemplaire du programme, sur les 180 actuellement sous contrat, a été livré début décembre, et il affirme que le premier exemplaire belge sera transféré "dans les prochains jours". Bruxelles est le dernier des huit clients actuels d'Airbus à recevoir ce type d'appareil, avec sept appareils en commande. "Ce fut une année très forte pour l'A400M - nous avons vu non seulement que la maturité de l'avion en termes de capacités, mais aussi son aptitude au service et sa disponibilité, s'améliorent", déclare M. Papachristofilou. "Cela ne passe pas inaperçu sur le marché. "Nous avons l'intérêt d'un certain nombre de clients, et nous sommes engagés dans des conversations", a-t-il déclaré le 9 décembre, tout en refusant d'identifier les nations concernées. "L'A400M est à l'ordre du jour de nos efforts dans le monde entier en matière de marketing et de vente", ajoute-t-il. En attendant, Airbus espère conclure en 2021 un accord prévu de longue date pour fournir à l'armée de l'air indienne 56 C295 de transport moyen. "Des progrès ont été réalisés cette année dans les étapes de la procédure en Inde, et nous espérons que nous aurons très bientôt le feu vert pour le projet", déclare M. Papachristofilou. La compagnie a également proposé le C295 pour répondre à un besoin d'avion de patrouille maritime malaisien, confirme-t-il.
- 7 460 réponses
-
- 3
-

-

-

-
- a400m
- airbus military
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
Non
-

USA
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
Battleground states issue blistering rebukes to Texas' lawsuit to invalidate millions of votes Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) Les États du champ de bataille font des reproches cinglants au procès du Texas pour invalider des millions de votes Par Ariane de Vogue et Paul LeBlanc, CNN Chacun des quatre États du champ de bataille ciblés par un procès au Texas visant à renverser la défaite électorale du président Donald Trump a publié jeudi des mémoires cinglants à la Cour suprême, les responsables de la Pennsylvanie allant jusqu'à qualifier cet effort d'"abus séditieux du processus judiciaire". Les documents déposés par la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin arrivent un jour après que Trump ait demandé à la Cour suprême d'intervenir dans le procès intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, visant à invalider des millions de votes dans leurs États. Ce procès constitue une demande d'intervention juridique sans précédent dans une élection, alors qu'il n'existe aucune preuve de fraude généralisée. "L'effort du Texas pour que cette Cour choisisse le prochain président n'a aucun fondement en droit ou en fait. La Cour ne devrait pas se laisser aller à cet abus séditieux du processus judiciaire, et devrait envoyer un signal clair et sans équivoque qu'un tel abus ne doit jamais être reproduit", a écrit le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro. Le procès du Texas, a déclaré Shapiro, reposait sur une "réalité alternative surréaliste". On ne sait pas quand la Cour Suprême agira sur ce procès. Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a abordé le procès avec un langage tout aussi fort, en écrivant que "l'élection au Michigan est terminée". Le Texas est étranger à cette affaire et ne devrait pas être entendu ici". "Le défi ici est sans précédent, sans fondement factuel ni base juridique valable", selon le mémoire du Michigan. Chris Carr, le procureur général de la Géorgie, a mis davantage l'accent sur les implications du fédéralisme dans le procès du Texas lors de son dépôt. "Le Texas insiste sur un grief généralisé qui n'implique pas le type de controverse directe entre États, nécessaire pour la juridiction de première instance", a-t-il écrit. "Et dans tous les cas, il existe un autre forum dans lequel les partis qui (contrairement au Texas) ont qualité pour agir peuvent contester le respect par la Géorgie de ses propres lois électorales : Les propres tribunaux de la Géorgie". Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, a également qualifié le procès d'"intrusion extraordinaire dans les élections du Wisconsin et des autres États défendeurs, une tâche que la Constitution laisse à chaque État". Les réponses énergiques -- associées au rejet par la Cour suprême d'une demande des républicains de Pennsylvanie visant à bloquer la certification des résultats des élections du Commonwealth en début de semaine -- ne sont que les dernières répudiations des théories de conspiration de plus en plus infondées du président selon lesquelles son second mandat lui serait volé. "En un mot, le président demande à la Cour suprême d'exercer sa forme la plus rare de juridiction pour renverser effectivement l'ensemble de l'élection présidentielle", a déclaré Steve Vladeck, analyste de la Cour suprême sur CNN et professeur à la faculté de droit de l'Université du Texas. Dans sa requête de mercredi, M. Trump a déclaré que la Cour suprême doit intervenir parce que le pays est divisé, bien qu'il n'y ait aucune preuve de fraude électorale généralisée. "Notre pays est profondément divisé d'une manière qui n'a pas été vue depuis l'élection de 1860", a déclaré M. Trump dans une déposition au tribunal. "Il existe un niveau élevé de méfiance entre les parties opposées, aggravé par le fait que, lors de l'élection qui vient de se tenir, les responsables électoraux des principaux États balbutiants, pour des raisons apparemment partisanes, n'ont pas mené leurs élections d'État en conformité avec la loi électorale de l'État". Les membres du Congrès de la Chambre des représentants signent Malgré la liste de revendications inexactes qui a conduit au procès, plus de 100 républicains de la Chambre ont signé un mémoire d'amicus curiae pour soutenir la motion de Paxton. Parmi les dirigeants républicains figurant sur cette liste, on trouve Steve Scalise, whip de la minorité à la Chambre, et Gary Palmer, président de la commission politique républicaine. "Les irrégularités inconstitutionnelles impliquées dans l'élection présidentielle de 2020 jettent un doute sur son résultat et sur l'intégrité du système électoral américain", dit le mémoire sans preuve. "Les amici avertissent respectueusement que la large portée et l'impact des diverses irrégularités dans les États défendeurs nécessitent un examen minutieux et opportun par cette Cour". Outre les quatre États faisant l'objet du procès au Texas, plus de 20 autres États et Washington, DC, ont également soumis un mémoire d'amicus curiae qui tourne en dérision l'effort et qui exhorte la haute cour à rejeter la requête du Texas. "Les États amici ont un intérêt essentiel à permettre aux tribunaux d'État et aux acteurs locaux d'interpréter et de mettre en œuvre la loi électorale de l'État, et à garantir que les États conservent leur capacité souveraine à accueillir les électeurs en toute sécurité dans des situations d'urgence telles que COVID-19", selon le mémoire. Le mémoire particulièrement enflammé de M. Shapiro a estimé que le procès du Texas est "juridiquement indéfendable et constitue un affront aux principes de la démocratie constitutionnelle". "Rien dans le texte, l'histoire ou la structure de la Constitution ne soutient l'opinion du Texas selon laquelle il peut dicter la manière dont quatre États frères organisent leurs élections, et le Texas n'a subi aucun préjudice parce qu'il n'aime pas les résultats de ces élections". -
Bravo!
- 6 984 réponses
-
- 8
-

-

-

-
- Force aérienne suisse
- F-18 Hornet
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :