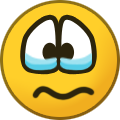-
Compteur de contenus
25 527 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-
https://www.latimes.com/world-nation/story/2023-02-10/whats-the-matter-with-portland-urban-ills-tests-citys-progressive-strain Longtemps saluée comme un modèle d'urbanisme consciencieux et d'engagement civique, Portland est confrontée à une crise de confiance. Près de trois ans après que les confinements pandémiques aient vidé le cœur de la ville et que les manifestations contre la brutalité policière aient transformé quelques pâtés de maisons du centre-ville en champ de bataille, cette ville d'environ 641 000 habitants doit faire face à une augmentation vertigineuse du nombre de sans-abri, à une montée en flèche de la criminalité et à des niveaux étonnamment élevés d'insatisfaction publique quant à ce que la ville fait à ce sujet. Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes sans logement dans la zone métropolitaine est passé d'environ 4 000 à au moins 6 600. Les fusillades dans la ville ont triplé. Les homicides sont passés de 36 en 2019 à 97 l'année dernière - un record. Les crimes de moindre importance ont également connu un pic : Plus de 11 000 véhicules ont été volés en 2022, contre 6 500 en 2019. Les overdoses mortelles de drogues ont presque doublé entre 2019 et 2021 à travers le comté de Multnomah. Des sondages réalisés l'année dernière ont montré que seuls 11 % des électeurs pensaient que Portland allait dans la bonne direction - une chute vertigineuse par rapport aux 36 % de 2020 et 76 % de 2000. Un retour de bâton est en cours. En novembre, les électeurs ont adopté une mesure visant à remanier le gouvernement de la ville et ont évincé le commissaire de gauche le plus ouvertement déclaré, qui avait mené une campagne de réduction des fonds alloués à la police en 2020. Des milliers de personnes ont déménagé. Après des décennies de croissance, la population de la ville a chuté en 2021 de 1,7 %. Une étude récente a montré que Portland se situe dans la moyenne de 40 autres villes en ce qui concerne les taux d'homicides, d'agressions et de vols. Mais la recrudescence de la criminalité a entraîné une crise d'identité. Portland n'est pas susceptible de devenir républicaine. Mais il y a des signes qui montrent que le pendule se déplace vers un type de politique plus modéré. Ils ont également éliminé Hardesty en faveur de Rene Gonzalez, un démocrate modéré qui a fait campagne sur la répression de la criminalité, le retrait des gens des trottoirs et l'équilibre entre la compassion et l'attente du respect de la loi. Hardesty a été battu dans de nombreux quartiers ouvriers et diversifiés de Portland. Mais la compétition était serrée, et Portland est toujours divisée entre différentes souches de libéralisme et de gauchisme. Selon l'historien Orloff, les dirigeants et les habitants de la ville sont fragmentés entre les générations. Les outils qui ont fait la réputation de Portland - le niveau inhabituel d'engagement des citoyens et les groupes de base qui travaillent au-delà des frontières des quartiers - sont en train de s'affaiblir. "Nous avons perdu ce sens du compromis et de la patience qui était le propre des bons Portlandais", a déclaré M. Orloff. "Reconquérir cela va prendre du temps". Pour le commissaire municipal Mapps, le statu quo est inacceptable. Certaines politiques récentes, telles que la réduction des fonds alloués à la police et la dépénalisation des drogues dures par l'État, ont eu, selon lui, des conséquences dévastatrices. Mais la réponse, a-t-il soutenu, n'est pas simplement de revenir à l'ancienne façon de faire les choses comme le suggèrent certains conservateurs. "Portland a prouvé que l'abolition de la police ne fonctionne pas", a-t-il dit. "Cela signifie-t-il que l'investissement dans la prévention est une mauvaise idée ? Non. Il doit y avoir des carottes et des bâtons."
-

Hongrie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/386 (12 février 2023) Je voudrais donc recommander Dernier jour à Budapest de Sándor Márai que l’on trouve au Livre de poche. Màrai imagine qu’un personnage réel, l’écrivain Gyula Krúdy, surnommé Sindbad, parti à la recherche de l’argent nécessaire à l’achat d’une robe pour sa fille et au règlement d’une facture d’électricité se laisse emporter par un impérieux besoin de flâner dans une ville dont chaque quartier ouvre les vannes de sa mémoire, inspire sa nostalgie et nourrit sa conviction que les Hongrois sont voués à la solitude des antihéros. « En effet, écrit Màrai, le peuple hongrois vit au milieu des grandes puissances slaves et germaniques dans la même solitude qu'une tribu bédouine dans le désert. Personne ne comprend sa langue. Ses caractéristiques ethniques et ses traditions ont plutôt tendance à être considérées comme un folklore exotique et non comme un ensemble organique faisant partie des civilisations qui l'entourent. Et tout ce qui est lié à ce peuple est comme recouvert de sable par la solitude. C’est sur cette Hongrie solitaire que Sindbad a écrit ». -

Royaume-Uni
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
La construction de l'image de l'ennemi : https://en.wikipedia.org/wiki/A_Child's_Garden_of_Verses A Child's Garden of Verses est un recueil de 64 poèmes pour enfants publié en 1885 par l'auteur écossais Robert Louis Stevenson. Il a été réimprimé de nombreuses fois, souvent dans des versions illustrées, et est considéré comme l'un des ouvrages pour enfants les plus influents du XIXe siècle. https://etc.usf.edu/lit2go/59/a-childs-garden-of-verses-selected-poems/4757/the-unseen-playmate/ Le compagnon de jeu imaginaire (the unseen playmate) : C'est lui, quand tu joues avec tes soldats de plomb, Qui se range du côté des Français et ne peut jamais gagner. -
https://theweek.com/business-news/1019932/why-its-getting-easier-to-fix-your-john-deere-tractor (12 janvier 2023) Dans le cadre d'un nouvel accord avec l'American Farm Bureau Federation, [John Deere] permettra aux agriculteurs de réparer eux-mêmes leurs engins au lieu de les obliger à utiliser des pièces ou des ateliers de réparation officiellement agréés. Cet accord est une victoire pour le "mouvement populaire en faveur du droit à la réparation qui a fait pression sur les fabricants pour qu'ils autorisent les clients et les ateliers de réparation indépendants à réparer leurs appareils". Avant le nouvel accord John Deere, par exemple, les propriétaires de tracteurs n'avaient même pas le droit de regarder le code du logiciel utilisé pour faire fonctionner les machines. En 2020, Tesla a exhorté ses clients à voter contre une mesure de droit à réparer du Massachusetts, arguant qu'"elle met potentiellement en péril la sécurité des véhicules et des données". Face à la pression publique, cependant, certains récalcitrants notables font marche arrière, ne serait-ce qu'un peu. En novembre 2021, Apple - considéré comme l'un des plus grands opposants au droit à réparer - a annoncé un nouveau "programme de réparation en libre-service" qui comprend des manuels de réparation et un accès aux pièces détachées. "Actuellement, seuls deux États - New York et le Colorado - disposent de lois actives sur le droit à la réparation, cette dernière étant hyper spécifique et ne concernant que les fauteuils roulants électriques", rapporte Gizmodo. C'est une sous-estimation de l'ampleur du mouvement. Ces dernières années, souligne New York Magazine, 41 États ont au moins envisagé une sorte de législation sur le droit à la réparation. Et les défenseurs du droit à la réparation ont un certain soutien au niveau fédéral : En 2021, le président Biden a signé une série de décrets anti-monopole comprenant une initiative visant à "garantir aux agriculteurs et aux automobilistes le droit de réparer leurs propres véhicules sans annuler les protections de garantie". La nouvelle loi new-yorkaise, par exemple, entre en vigueur le 1er juillet, mais avec des modifications qui excluent les appareils ménagers, les voitures et les dispositifs médicaux.
-

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230210-russie-afrique-la-nouvelle-tournée-fructueuse-de-sergueï-lavrov-sur-le-continent Serguei Lavrov revient notamment avec un accord, en cours de ratification, d'un centre de logistique pour la marine russe au Soudan. C'est un pas important pour la Russie qui souhaite de longue date renforcer sa présence navale en mer Rouge. -

République démocratique du Congo
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Mani dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230210-rdc-pourquoi-la-tension-monte-à-goma-pendant-que-la-pression-militaire-s-accentue-autour-de-la-ville Les combats entre les Forces armées de la RDC et la rébellion du M23 se rapprochent de Goma Les combats, cette semaine, se sont rapprochés de Saké, dernière grande localité avant Goma, côté ouest. Depuis la prise de Kitchanga par le M23, le 26 janvier dernier, le front est en effet descendu le long de la route reliant Sake à Butembo, pour se figer à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Le contingent kényan déployé à Goma comprend 903 hommes. Pour rappel, en 2013, la brigade d’intervention qui a mis en déroute le M23 avait 3 000 hommes et des moyens nettement supérieurs. Le financement de cette force n’est par ailleurs pas finalisé et elle manque d’armement face à un M23 que l’on dit bien équipé et surtout soutenu pour le Rwanda, selon l’ONU, les chancelleries occidentales, la diplomatie américaine, l’Union européenne et d’autres… -

[Iran]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de g4lly dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/l-iran-aux-racines-d-une-theocratie-1967847 (11 février 2023) Yann Richard, auteur de Le grand Satan, le Shah et l'Imam, les relations Iran/États-Unis jusqu'à la Révolution de 1979, et L'Iran de 1800 à nos jours. -

Chili
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/11/au-chili-de-gigantesques-incendies-incontrolables-les-plus-importants-apres-ceux-de-2017_6161380_3244.html De gigantesques incendies « incontrôlables », les plus importants après ceux de 2017 -
https://theweek.com/culture/sports/1008114/should-football-still-be-americas-favorite-game (15 décembre 2021) En avril [2021], Phillip Adams a tué six personnes - dont deux enfants de 9 et 5 ans - puis a retourné l'arme contre lui, mourant à l'âge de 32 ans. Mardi, nous avons appris une raison probable : Le cerveau d'Adams était gravement endommagé après avoir joué au football pendant 20 ans, notamment pour six équipes de la NFL. Il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie souvent observée chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien. C'est loin d'être la première histoire d'horreur de l'ETC liée au football. En 2012, le linebacker de Kansas City Jovan Belcher a tué sa petite amie, puis s'est tiré une balle devant l'entraîneur et le directeur général de l'équipe. La même année, Junior Seau - qui a été l'une des principales stars de la ligue pendant deux décennies - s'est suicidé. Cinq ans plus tard, l'ancien tight end des New England Patriots, Aaron Hernandez, s'est pendu en prison, où il purgeait une peine pour le meurtre d'un ami. Ce ne sont là que quelques exemples : La liste des anciens joueurs victimes de l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) qui sont morts violemment est longue et ne cesse de s'allonger. La NFL a mis en œuvre un certain nombre de changements de règles au cours des deux dernières décennies afin de protéger les joueurs contre les commotions cérébrales - bien qu'une étude réalisée l'année dernière suggère que ces changements n'ont pas réellement réduit le nombre de blessures. Il est tentant de demander l'interdiction du jeu, mais ce n'est pas réaliste : 23 des 25 émissions les plus regardées cette année sont des matchs de la NFL, et le football universitaire est comme une religion dans le Sud. Le jeu n'est pas prêt de disparaître : les Américains connaissent les problèmes et continuent à regarder. Mais on doit se demander s'il est éthique de regarder et de soutenir un jeu qui inflige tant de dommages aux hommes qui y jouent et qui peut amener ces hommes à répandre la mort et la misère sur d'autres. Peut-être devrions-nous trouver autre chose à faire le dimanche après-midi.
-
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/06/new-york-times-arbitration/ Peu de médias peuvent égaler le New York Times lorsqu'il s'agit de dénoncer les pièges de l'arbitrage forcé. Une série d'enquêtes de 2015 a documenté comment de telles clauses sont devenues de plus en plus courantes dans de nombreux types de contrats, laissant les consommateurs à la merci d'un régime d'arbitrage souvent prédisposé contre leurs intérêts. La couverture ultérieure, tant du côté des informations que de la rédaction, a maintenu un coup de projecteur sur cette pratique. Peut-être que le Times peut étendre cette attention en écrivant sur la décision de la New York Times Co. d'adopter cette tendance. "Nous avons mis à jour nos conditions d'utilisation afin d'ajouter une clause d'arbitrage couvrant tous les litiges relatifs à nos règles, à votre relation avec nous en tant qu'abonné et à votre utilisation de nos produits et services", indique une "mise à jour" de décembre du Times.
-

Hongrie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://courrierdeuropecentrale.fr/breve/un-symbole-nationaliste-hongrois-deboulonne-en-transcarpatie/ (17 octobre 2022) Une statue du Turul a été déboulonnée à Moukatchevo, une ville d’Ukraine occidentale qui compte une minorité magyarophone. Le comité exécutif du conseil municipal a chargé le directeur du musée historique du château de Moukatchevo (Munkács, en hongrois) de retirer une statue du Turul, un oiseau de la mythologie magyare souvent mobilisé comme symbole nationaliste. La statue, déboulonnée jeudi manu militari, doit être remplacée par le trident symbole de l’État ukrainien. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a convoqué le chargé d’affaires ukrainien à Budapest, rapporte Portfolio. source : https://mki.gov.hu/en/hirek-en/minden-hir-en/a-munkacsi-turul-masodik-vegzete-en https://hungarytoday.hu/new-anti-hungarian-measures-in-ukraine/ (19 janvier 2023) Les débordements anti-hongrois du soi-disant clan Baloha dans la région de Munkács (Mukachevo) se poursuivent, a déclaré György Dunda, rédacteur en chef du journal Kárpáti Igaz Szó. Il a rappelé que le maire de Mukachevo, Andriy Baloha, et son père influent, le député Viktor Baloha, ont organisé le déplacement de la statue de Munkács Turul. Dans leur dernière action, avec l'aide de la police, ils ont fait retirer les drapeaux des établissements hongrois dans les localités de Fornos et de Dercen, deux localités à majorité hongroise de la région de Mukachevo. "Selon les habitants, des policiers se sont rendus dans le village pendant la nuit, ont décroché les drapeaux, les ont pliés et les ont placés devant l'entrée du centre communautaire", a ajouté György Dunda. En outre, les panneaux en hongrois de l'académie de football de Dercen, qui est financée par des fonds hongrois, ont été retirés. Comme si cela ne suffisait pas, le directeur du lycée hongrois de Mukachevo a également été licencié, alors qu'il avait présidé l'institution pendant plus de dix ans. L'Association culturelle hongroise de Transcarpathie (KMKSZ) a exprimé sa consternation face au licenciement d'István Schink, qui est également le président de la faction KMKSZ au sein du conseil municipal de Mukachevo, déclarant que sa révocation n'est pas propice au bon fonctionnement de l'école hongroise et à la coexistence pacifique des groupes ethniques. Selon Kárpátalja.net, ils font référence à un prétendu décret selon lequel, dorénavant, aucun autre drapeau que le drapeau ukrainien ne pourra être affiché sur les bâtiments publics. Selon les informations du portail d'information, le conseil de la microrégion de Mukachevo n'a pas adopté un tel décret. Ils ont fait valoir que la loi ukrainienne n'a pas encore interdit l'utilisation de symboles nationaux, d'autant plus que les villages hongrois de Transcarpathie n'arborent pas le drapeau officiel de l'État hongrois, mais le tricolore hongrois. L'État hongrois a contribué à hauteur de plus de deux milliards et demi de forints (2,3 millions d'euros) à la construction de l'académie sportive en question en 2020, qui parraine non seulement des enfants hongrois mais aussi ukrainiens. Curieusement, dans plusieurs cas dans d'autres districts, les autorités ont explicitement empêché la destruction des symboles et inscriptions hongrois, mais dans le district de Mukachevo, ces actions ont été ordonnées par des fonctionnaires associés au député ukrainien Viktor Baloha et à son fils, le maire local, Andrij Baloha. https://hungarytoday.hu/viktor-orban-meets-volodymyr-zelensky-in-brussels/ (10 février 2023) Le Premier ministre Viktor Orbán a souligné l'importance d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible, après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du Conseil européen de Bruxelles. "Sauver des vies n'est possible qu'avec la paix et un cessez-le-feu. Nous, Hongrois, restons du côté de la paix", a souligné le Premier ministre Viktor Orbán dans une vidéo publiée jeudi sur sa page Facebook. Il a souligné que la Hongrie avait fourni l'année dernière la plus grande aide humanitaire de son histoire à l'Ukraine. "Nous avons permis à plus d'un million de réfugiés d'Ukraine de franchir nos frontières", a ajouté M. Orbán. Après avoir écouté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, M. Orbán a conclu : il est évident que cette guerre s'éternise, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle prenne fin de sitôt." M. Orbán a souligné que "les Hongrois continueront à aider les Ukrainiens en leur apportant une aide humanitaire, mais nous ne fournirons pas non plus d'armes à l'avenir." Il a déclaré que les négociations de paix, un cessez-le-feu le plus rapidement possible et un règlement menant à une paix durable restaient dans l'intérêt de la Hongrie. Le directeur politique d'Orbán, Balázs Orbán, a déclaré aux journalistes à Bruxelles que la Hongrie soutient également les efforts d'intégration de Kiev à l'UE à condition que les exigences de l'UE soient pleinement respectées. Une partie de ces exigences concerne la protection et le renforcement des droits des minorités nationales", a-t-il noté. Balázs Orbán a déclaré que la Hongrie ne soutient pas les sanctions, mais que dans l'intérêt de l'unité de l'UE, elle n'empêchera pas que certaines mesures soient prises, sauf dans des domaines d'intérêt national hongrois vital. Il s'agit notamment de l'énergie, du pétrole, du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Les autorités allemandes étaient prêtes à mettre les bouquins de la bibliothèque de l'institut au pilon. C'est les autorités françaises qui les ont sauvés, parce que les Français aiment plus l'Allemagne que les Allemands n'aiment la France. C'est comme la "special relationship" des Britanniques vis à vis de l'Amérique. C'est une relation en sens unique, un amour non partagé, un "unrequited love". -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
https://elpais.com/internacional/2023-01-19/emmanuel-macron-a-javier-cercas-nous-avons-une-crise-inedite-a-cause-de-la-guerre-la-reponse-passe-par-une-europe-puissance.html Javier Cercas : Pour moi, problème essentiel de la création d’une Europe une c’est que ça reste un projet élitiste. Il n’est pas ce qu’il devrait être : un projet populaire. Je crains que les gens aujourd’hui ne sentent pas que l’Europe c’est essentiel pour sa vie. E. M. Je peux plaider le contraire? J. C. Bien sûr. E. M. Je pense que l’Europe est un projet qui s’est structuré par des projets populaires. L’euro est un projet populaire, le fait d’aller d’un pays à l’autre et d’avoir la même monnaie et le fait que cette monnaie vous protège. Parce que si nous n’avons pas une flambée en termes d’inflation, s’il n’y a pas eu de crise, c’est parce qu’il y a l’euro. (...) Erasmus, c’est bon pour toutes les catégories de jeunes. https://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/fioraso-veut-un-erasmus-moins-elitiste-872/ (9 janvier 2013) La ministre de l’Enseignement supérieur a defendu mercredi la démocratisation et l’exstension du programme d’échange européen, qu’elle juge encore trop « bobo », lors d’un déplacement à Bruxelles. «Erasmus reste trop élitiste», juge Geneviève Fioraso, la ministre de l’Enseignement supérieur, qui defendait ce mercredi la «démocratisation» du programme d’échange universitaire à Bruxelles. « «Le profil type des Erasmus, c’est une étudiante en troisième année de licence, dont l’un des parents au moins a étudié dans le supérieur et dont la famille est plutôt aisée», selon la ministre. Un Erasmus trop «bobo» à ses yeux. E.M. Je pense que nous avons une crise inédite puisque nous avons la guerre qui revient sur le continent. Nous avons le modèle économique qui est profondément bousculé par les conséquences de cette guerre directe et indirecte et au fond, un monde économique qui se structure dans la polarité États-Unis Chine, qui dit à l’Europe : ‘As-tu ton chemin à suivre, qui est un chemin de liberté, de croyance dans le marché et en même temps d’égalité et de solidarité ? Ou est-ce que tu es qui veut devenir le vassal de l’une des deux ?’ On n’a pas encore répondu à cette question complètement. Je crois que la réponse passe par l’Europe souveraine sur le plan économique, technologique et militaire, c’est-à-dire une Europe puissance véritablement. -

Vers l'indépendance de la Catalogne et la fin de l'Espagne ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.elnacional.cat/en/politics/ada-colau-barcelona-lost-its-way-financial-times_968079_102.html (10 février 2023) "Comment Barcelone a perdu son chemin". C'est le titre d'un vaste reportage que vient de publier le Financial Times, le principal journal économique britannique, qui plonge dans la situation économique et même émotionnelle de la ville de Barcelone pour vérifier que la capitale catalane se trouve actuellement dans une situation de déliquescence causée, entre autres, par la gestion de la maire Ada Colau, mais aussi par l'instabilité politique et la fuite des entreprises provoquée, selon l'écrivain Barney Jopson, par le processus d'indépendance, avec pour principale destination, la ville de Madrid, qui a gagné la pole position économique au détriment de Barcelone. Avec des déclarations d'hommes d'affaires, de politiciens - dont la maire Colau elle-même, ainsi que Xavier Trias, candidat à la mairie pour Ensemble pour la Catalogne, et Salvador Illa, leader des socialistes catalans - et aussi de résidents, le reportage de Jopson, qui est le correspondant du Financial Times en Espagne et au Portugal et basé à Madrid, explique comment Barcelone a perdu son élan par rapport à la capitale espagnole. "Elle a perdu sa voie, elle a perdu son énergie", déclare le journaliste, affirmant que c'est l'impression de nombreux résidents, qui "regrettent que quelque chose ne tourne pas rond", et énumérant la litanie bien connue des problèmes - "vols dans les rues, avenues jonchées de détritus et trafic congestionné, ou encore manque de nouvelles infrastructures et d'attractions culturelles". En fait, il rappelle comment les propres enquêtes de la mairie révèlent que le principal problème de la ville est "l'insécurité". L'auteur lui-même note que, pour les entrepreneurs, "la cause des maux de la ville" se trouve à la fois dans le mouvement indépendantiste et dans la gestion d'Ada Colau, définie comme "une ancienne militante de gauche qui se représente aux élections cette année" et qui a la réputation d'être "une ennemie de l'entreprise et de la croissance". Et que Barcelone conserve des "avantages intrinsèques" tels que le climat, les plages, les "montagnes skiables à proximité", l'architecture médiévale et le modernisme de Gaudí, mais que ces derniers temps, elle a cessé "d'atteindre son potentiel", avec des exemples tels que le rejet de l'expansion de l'aéroport ou le "non" à l'installation d'une succursale du célèbre musée russe de l'Ermitage. Le leader de l'opposition parlementaire, Salvador Illa, des socialistes, déclare au FT qu'il y a eu une "décennie perdue" en Catalogne. La maire de Barcelone donne également son avis dans le reportage du Financial Times, affirmant que sa gestion a réussi à dompter le "capitalisme sauvage" dont elle a hérité en 2015 de Xavier Trias : "Nous ne sommes plus dans une ville qui ne mise que sur la spéculation immobilière, pleine de voitures et de pollution, avec un tourisme hors de contrôle", affirme la maire, ajoutant que son administration a "rétabli l'ordre". Le reportage, qui reprend les derniers résultats des sondages mais ne mentionne pas la dernière crise provoquée par le boycott de Tel Aviv, rappelle que Colau "occupe la deuxième ou troisième place dans la course à la mairie avec environ un cinquième des voix". Quant à Trias, il est présenté comme un "candidat pro-business" à la tête de la municipalité et l'auteur le cite en disant qu'il y a "deux Barcelone", celle des touristes étrangers qui "visitent la ville, sont ravis et repartent" et celle des locaux, qui est un "désastre". "Ils se souviennent d'une Barcelone qui suscitait l'enthousiasme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas", souligne le candidat de Junts, à l'image d'une Barcelone qui, selon cette analyse du Financial Times, "s'est perdue".- 2 413 réponses
-
- 1
-

-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/10/avant-sa-rencontre-avec-biden-lula-en-appelle-a-ses-racines-de-la-gauche-latino-americaine-et-se-reve-en-mediateur-dans-la-guerre-en-ukraine_6161300_3210.html Depuis le début du conflit, jamais Lula n’a envoyé de message de soutien au président Volodymyr Zelensky, pas plus qu’aux Ukrainiens. Tout en condamnant la violation du droit international, il n’a eu de cesse de s’attaquer à l’OTAN, accusée de « s’arroge[r] le droit d’installer des bases militaires dans les environs d’un autre pays ». La guerre pourrait facilement être résolue au Brésil « à table en prenant une bière », affirmait-il le 30 mars 2022, un mois après le début de l’invasion des troupes russes. Le point critique avait été atteint en mai 2022 dans un entretien au magazine Time. « Ce type est aussi responsable de la guerre que Poutine », déclarait alors Lula au sujet de Volodymyr Zelensky, soutenant qu’« une guerre n’a jamais un seul coupable ». Et d’ajouter : « On dirait qu’il fait partie d’un spectacle. Il est à la télé matin, midi et soir. (…) On devrait lui dire sérieusement : “Tu es un bon artiste, mais on ne va pas faire une guerre pour que tu puisses te donner en spectacle.” » Ces déclarations ont révulsé les Ukrainiens et inquiété nombre d’Occidentaux. Depuis, Lula s’est montré plus mesuré mais n’a guère changé de ligne. Recevant fin janvier le chancelier allemand, Olaf Scholz, à Brasilia, le président du Brésil a annoncé son refus de fournir des munitions pour les chars allemands en Ukraine. « Le Brésil est un pays de paix », a éludé Lula, qualifiant l’invasion russe d’« erreur » mais ajoutant que la raison à l’origine de la guerre « rest (ait) à éclaircir ». https://www.lemonde.fr/international/live/2023/02/11/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-russe-n-a-pas-les-moyens-de-lancer-une-grande-offensive-estiment-les-services-de-renseignement-ukrainiens_6161396_3210.html Lors d’une entrevue avec Joe Biden, Lula revendique sa neutralité vis-à-vis du conflit en Ukraine Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, reçu vendredi par Joe Biden, a dit lors de son échange avec la presse qu’il avait évoqué « le besoin de créer un groupe de pays qui ne soient pas impliqués, ni directement ni indirectement, dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, afin que nous ayons la possibilité de construire la paix. » -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/temoignages-au-royaume-uni-des-britanniques-malades-de-ne-plus-pouvoir-heberger-de-refugies-ukrainiens_5638424.html (8 février 2023) Royaume-Uni : Après un an de conflit, l'effort collectif pour accueillir des Ukrainiens contraints de quitter leur pays faiblit. Selon le gouvernement, plus de 3 000 familles se retrouvent aujourd'hui sans logement outre-Manche. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
10 février 2023. Jutta Bechstein, ancienne directrice de l'institut Goethe de Bordeaux. Interview soporifique, sauf - in cauda venenum - la fin : "Je voudrais terminer sur le sauvetage inoui de la bibliothèque du Goethe Institut, après la fermeture des cours de langue et de la bibliothèque pour des questions de restructuration, et de réorientation de la politique culturelle plutôt vers l'Est, qui a été sauvée par les trois collectivités territoriales : la ville, le département et la région, et par l'université". Autrement dit, c'est une sorte de "clap de fin". La France n'est plus une priorité pour la politique culturelle allemande. La priorité c'est "plutôt vers l'Est". La France ne compte plus pour l'Allemagne, ou elle est "taken for granted", ne considérant pas que l'amitié franco-allemande soit à cultiver ou à approfondir. -
Ce qu'ils appellent "football" tout court, et que nous appelons "football américain" est un sport à risque. Et le risque d'en sortir indemne est... plutôt faible : https://medicalxpress.com/news/2023-02-autopsy-nfl-players-brain-disease.html (9 février 2023) De nombreux amateurs de football se souviennent avec émotion de Rick Arrington, quarterback des Philadelphia Eagles de 1970 à 1973, mais les souvenirs de sa fille sont entachés par les années passées à regarder son père souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) à un stade avancé. Cette maladie dégénérative du cerveau, que l'on retrouve chez les athlètes, les vétérans de l'armée et d'autres personnes ayant subi des traumatismes cérébraux répétés, provoque des dépressions, des pensées suicidaires, des agressions et des sautes d'humeur. Les personnes concernées finissent par avoir des problèmes de réflexion et de mémoire, et peuvent finalement développer une démence. Les chocs répétés à la tête - même s'ils ne provoquent pas de commotions cérébrales - sont considérés comme le principal facteur de risque du TCE. Les chercheurs du CTE Center de l'université de Boston ont récemment annoncé qu'ils ont maintenant diagnostiqué le CTE dans le cerveau de 345 des 376 (91,7 %) joueurs de la NFL étudiés. Arrington était parmi eux. En revanche, une étude menée en 2018 par l'université de Boston sur 164 cerveaux donnés n'en a trouvé qu'un seul (0,6 %) atteint de CTE. Le seul cas de CTE concernait un ancien joueur de football universitaire. "Chaque fois que vous jouez au football pendant 2,6 ans, à quelque niveau que ce soit, vous doublez votre risque de TCE, et plus vous jouez longtemps et à un niveau élevé, plus votre risque est élevé", a déclaré le Dr Ann McKee, directrice du CTE Center de l'université de Boston (BU). Ces nouvelles recherches s'appuient sur les résultats d'une étude de 2017 qui a révélé la présence de l'ETC dans 99 % des cerveaux de joueurs de la NFL, 91 % des joueurs de football universitaire et 21 % des joueurs de football du secondaire dans la banque de cerveaux UNITE. 3 août 2021. Hood River est un documentaire sur l'équipe de foot - soccer, ou plutôt fútbol en langue locale - du lycée de Hood River, petite ville pittoresque que domine les blanches cîmes du mont Hood, dans l'Oregon. Le réalisateur explore comment ce sport sert de trait d'union entre des communautés - mexicains avec ou sans papiers, anglo-américains - qui autrement auraient peu d'occasions de se fréquenter et de se comprendre.
-
https://www.nytimes.com/2023/02/08/nyregion/migrants-new-york-canada.html Les autorités new-yorkaises, qui ont naguère condamné les dirigeants du Texas pour le transport par bus des migrants depuis la frontière sud, qualifiant ce traitement d'inhumain, achètent des billets de bus pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se rendre au nord et demander l'asile au Canada. Beaucoup de migrants qui se dirigent vers le Canada ne connaissent personne. Certains ont appris la possibilité de s'y rendre sur TikTok. Rosiel Ramirez et sa famille, qui viennent du Venezuela, ont d'abord envisagé cette possibilité après avoir reçu des messages d'une autre famille rencontrée dans un refuge de Brooklyn, qui s'est récemment rendue à Montréal. Comme d'autres migrants, Mme Ramirez, 26 ans, a déclaré qu'elle était attirée par le Canada parce qu'il accorde plus rapidement des permis de travail aux demandeurs d'asile que les États-Unis, où l'arriéré juridique fait que l'obtention de documents de travail peut prendre des années. Samedi soir, Mme Ramirez et sa famille - son mari, leurs trois enfants, sa mère, son frère, sa femme et leur fils - se sont rendus au Port Authority Bus Terminal. Des soldats de la Garde nationale, qui avaient aménagé une zone d'attente spéciale pour les migrants, leur ont remis des billets pour un bus de nuit à destination de Plattsburgh. Mme Ramirez était arrivée pour la première fois à Port Authority il y a cinq mois, alors que les autorités du Texas transportaient parfois des milliers de migrants par semaine vers des villes comme New York et Washington. Elle et son mari ne trouvaient pas d'emploi stable pour subvenir aux besoins de leurs enfants, Rose, 10 ans, Samara, 2 ans, et Amber, âgée de 2 mois. Lorsqu'ils ont appris que la ville payait les billets de bus pour le nord, ils ont décidé de partir pour de bon. Les responsables de l'immigration canadienne n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, mais les responsables québécois ont demandé la fermeture du passage informel du chemin Roxham. Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l'objectif du gouvernement canadien était de "réduire ces passages irréguliers et de promouvoir l'immigration légale", selon les médias canadiens. https://www.lapresse.ca/actualites/2023-02-06/new-york-paye-des-billets-de-bus-vers-plattsburgh-pres-du-chemin-roxham.php La Ville de New York offre des billets d’autocar gratuits aux demandeurs d’asile qui souhaitent quitter la mégapole, incluant vers Plattsburgh, à 45 km du célèbre chemin Roxham. Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a été stupéfait d’apprendre l’existence du stratagème. « Les Américains doivent se bidonner quand ils entendent le Canada dire qu’il négocie pour moderniser l’Entente sur les tiers pays sûrs. À quel point ils doivent rire quand on se demande pourquoi les négociations traînent depuis six ans », a-t-il raillé en Chambre. Ainsi est-il urgent de suspendre unilatéralement l’accord bilatéral, a-t-il insisté auprès du gouvernement, dont le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a récemment affirmé que l’épineux dossier ne se réglerait pas lors de la visite de Joe Biden au Canada, en mars prochain. « Je pense qu’il faut se servir de cette visite pour changer de direction », a soutenu Alexandre Boulerice, chef adjoint néo-démocrate, qui voit en ces nouvelles informations une démonstration que l’entente avec les États-Unis « ne fonctionne pas, qu’elle est bancale, qu’il y a une faille ».
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.businessinsider.com/china-warns-europe-against-pushing-for-ukraine-complete-victory-2023-2 (8 février 2023) Le gouvernement chinois a largement évité de prendre des positions publiques fortes sur la guerre de la Russie en Ukraine, mais l'ambassadeur de Pékin auprès de l'UE a exprimé mercredi son inquiétude quant au soutien occidental à Kiev. Il a également jeté de l'eau froide sur l'idée que le conflit ait un lien quelconque avec Taïwan, un point de friction pour la Chine. "Franchement, nous sommes assez préoccupés par la possible escalade de ce conflit", a déclaré Fu Cong, le principal envoyé de la Chine auprès de l'UE, lors d'un événement organisé par le European Policy Centre à Bruxelles, selon Politico. Il a ajouté que la Chine ne pense pas que "la fourniture d'armes suffira à résoudre le problème", s'en prenant apparemment à l'aide militaire que les pays occidentaux n'ont cessé de fournir à l'Ukraine tout au long de la guerre. "Nous sommes assez préoccupés par les personnes qui parlent de remporter une victoire complète sur le champ de bataille", a poursuivi Fu. "Nous pensons que le bon endroit serait à la table des négociations". Fu a repoussé les suggestions d'un lien entre les deux questions. "L'Ukraine est un État indépendant, et Taïwan fait partie de la Chine", a-t-il déclaré. "Il n'y a donc pas de comparabilité entre les deux questions". -

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
L'expression "voir la Russie pour ce qu'elle est", correspond pile poil avec ce que les experts appellent la "prémisse apologétique" qu'est la "naturalisation" de "l'image de l'ennemi" : - Je vois que tu as pris bonne note du texte de Bruno Drweski (2003) qui fait litière de cette idée que la russophobie polonaise serait "naturelle" : http://www.air-defense.net/forum/topic/19693-pologne/?do=findComment&comment=1608974 -

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
La montée en puissance de la Prusse et l'intérêt grandissant pour l'alliance de revers, surtout à partir de 1870 ? Le sentiment d'être flatté par la francophilie des classes dirigeantes russes, qui parlaient français, donc perçues comme civilisées. La correspondance entre Voltaire et Catherine. L'accueil fait aux émigrés pendant la révolution française ? Comme le duc de Richelieu, nommé gouverneur d'Odessa ? -

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.jstor.org/stable/3004165 (Raymond T. McNally, The American Slavic and East European Review, avril 1958) Les origines de la russophobie en France : 1812-1830 Dans les deux secondes décennies du dix-neuvième siècle, l'image de la Russie présentée dans les écrits journalistiques français était inspirée par la peur. En particulier, pendant les guerres napoléoniennes et, de manière encore plus prononcée après l'avènement de Nicolas Ier sur le trône, les publicistes français ont lancé des campagnes anti-russes, qui étaient destinées à culminer plus tard au milieu du XIXe siècle comme l'une des causes catalytiques de l'alignement final de la France contre la Russie pendant la guerre de Crimée. L'objectif de cet article est de retracer les origines de cette russophobie dans les pamphlets français, les récits de voyage et autres ouvrages populaires sur la Russie, ainsi que dans les rapports diplomatiques, avant 1830. Pour les années critiques des relations franco-russes, 1819-15 et 1825-26, j'ai également utilisé les comptes rendus des journaux de l'époque pour retracer les racines de la russophobie. L'opinion traditionnelle est que la peur généralisée de la Russie en Europe occidentale a été causée par l'attitude et les actions de Nicolas Ier lorsque les révolutions libérales ont éclaté en France, en Belgique et surtout en Pologne en 1830... Cependant, nous verrons qu'une étude détaillée des écrits populaires en France de 1812 à 1830 nous oblige à modifier sérieusement cette opinion supplémentaire soutenue par la plupart des historiens concernant la montée de la russophobie au début du XIXe siècle. En octobre 1812, paraît l'un des ouvrages les plus influents de toute l'histoire de la russophobie : Des progrès de la puissance russe de Charles-Louis Lesur (1770-1849), fondateur de L'annuaire historique. Dans ce livre, Lesur a publié le tristement célèbre et très mal cité "Testament de Pierre le Grand". Napoléon Ier avait donné l'ordre de publier une série d'articles pour montrer que "l'Europe est inévitablement en train de devenir un butin pour la Russie". Ce "testament" a donc été publié par les soins du ministère français des affaires étrangères. Le "testament" fut à nouveau diffusé pendant la guerre de Crimée ; Napoléon III ordonna qu'il soit affiché sur les bâtiments publics de Paris et dans toute la France.- Adolf Hitler le fit rééditer pendant la dernière guerre. Il ne fait guère de doute que le "testament" était un faux. Harry Breslau dans l'Historische Zeitschrift (1879) a été le premier à le prouver. https://tass.com/politics/1419843 (10 mars 2022) Lavrov fustige la déclaration de Mme Truss selon laquelle la Russie pourrait attaquer les États baltes Selon Sergey Lavrov, la déclaration de Liz Truss est "tout à fait exemplaire de la culture, de la politique et de la diplomatie anglaises". "C'est parce que les Britanniques ont écrit le faux testament de Pierre le Grand exactement de la même manière", a déclaré le ministre. "Cela va fondamentalement dans le même sens". Eh bien là, Lavrov est pris en flagrant délit de fake news. Le faux testament n'est pas anglais, mais français ! Bon, en fait pour départager tout le monde, il est polonais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Testament_de_Pierre_le_Grand En 1797 Michel Sokolnicki, général polonais en exil à Paris, transmet un document en quatorze points, Aperçu sur la Russie, décrivant un prétendu « plan légué par Pierre » au directoire qui demeure cependant sceptique. En 1812, Charles-Louis Lesur publie Des progrès de la puissance russe, depuis son origine jusqu'au commencement du XIXe siècle, reprenant les thèses de Sokolnicki et les prétendus plans stratégiques secrets de la Russie pour conquérir l'Europe. Le pamphlet a servi de justificatif à la propagande anti-russe tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Le Maroc est devenu protectorat français par un processus volontaire, souverain. Cela n'a pas convaincu les Allemands, du moins dans un premier temps. Si le Canada adhérait par un processus volontaire, souverain à une alliance stratégique avec la Chine, cela serait interprêté par les Etats-Unis comme une agression : "des pays qui n'ont connu que la domination soviétique pendant un demi siècle" La mémoire est sélective. La "construction de l'ennemi", cela peut se déconstruire, et quand elle est déconstruite, la russophobie, elle fait pschitt : -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Miliairement : OTAN version 2007, c'est à dire Pologne, pays baltes, Roumanie. Mais intellectuellement, c'est la frontière entre les néocons et les "restrainers". Je suis un restrainer inspiré par Andrew Bacevich. Intellectuellement, c'est Jacques Chirac qui "jette un froid à l'Est" : https://www.liberation.fr/evenement/2003/02/19/jacques-chirac-jette-un-froid-a-l-est_431400/ La violente charge du chef de l'Etat français, lundi soir, contre les anciens satellites de Moscou, ac cusés d'avoir «été à la fois pas très bien élevés et un peu inconscients du danger que comportait un trop rapide alignement sur la position américaine», a été le principal sujet de conversation des treize pays candidats à l'UE (1), hier à Bruxelles, lors de la seconde journée du sommet informel sur l'Irak.