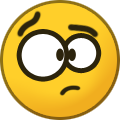-
Compteur de contenus
1 677 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
14
Tout ce qui a été posté par Manuel77
-
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Quand dit-on par-dela et quand dit-on au-dela ? Je ne trouve pas d'explication compréhensible. C'est pourquoi j'ai choisi le titre de Nietzsche. Cela sonnait plus philosophique. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
L'ennemi politique n'a pas besoin d'être moralement mauvais, il n'a pas besoin d'être esthétiquement laid ; il n'a pas besoin d'être un concurrent économique, et il peut même sembler avantageux de faire des affaires avec lui. Il est justement l'autre, l'étranger, et il suffit à son essence qu'il soit, dans un sens particulièrement intense, existentiellement quelque chose d'autre et d'étranger, de sorte que, dans le cas extrême, des conflits (i.e. mortels, j'ajoute) sont possibles avec lui, conflits qui ne peuvent être tranchés ni par une normalisation générale établie à l'avance, ni par le verdict d'un tiers 'non concerné' et donc 'impartial'. Carl Schmitt, Le concept du politique Selon ce critère, je dirais que non, le sabotage de l'énergie nucléaire n'en fait pas un ennemi. Il n'existe pas de philosophie parfaite qui ait une réponse à toutes les questions politiques. Je plaide seulement contre l'extrémisme qui ne se réfère qu'à un seul concept (légalisme, moralisme,..). Il faut tenir compte de tous les facteurs, mais ne pas être paralysé pour autant. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Et donc, ils n'ont pas d'ennemis non plus ? Quelle bonne nouvelle ce serait... Ce discours sur les intérêts n'est qu'une construction intellectuelle de la recherche académique sur les relations internationales, parce qu'ils ne veulent pas aller en profondeur sur le plan philosophique et déclarent que les États sont une boîte noire. Il n'y a pas d'intérêts objectifs. Pour que ces intérêts objectifs puissent commencer à se concrétiser, il faudrait que tu aies un État homogène qui ait détruit toutes ses contradictions internes, et donc tous ses ennemis internes. Ne penses-tu pas que Trump a des ennemis aux États-Unis ? Un État n'est aussi qu'une construction intersubjective, certes d'une grande efficacité, mais pas d'une force d'engagement absolue. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Tu trouveras autant de philosophes moraux que tu le souhaites pour expliquer qu'il est moralement impératif de donner l'argent russe à l'Ukraine. Le légalisme n'est qu'une petite sous-catégorie du moralisme. Et si tu dis ensuite que les autres sont de toute façon des connards à qui il est inutile de faire des reproches moraux, mais que tu refuses en même temps d'identifier les amis et les ennemis, il ne reste logiquement que la conséquence du nihilisme. C'est par-delà de la morale et de la politique. -
En France, c'est inclus ! Et la mayo aussi ! C'était du moins le cas en 1994, si je me souviens bien. Des petites barquettes en papier dans lesquelles on pouvait remplir à volonté.
-
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Tiré du principal journal conservateur allemand :https://archive.is/J62f8 Nouveau document de référence : les besoins en matière de défense devraient « dépasser les 500 milliards d'euros ». L'économiste Moritz Schularick a imaginé le fonds spécial de 400 milliards. Il concrétise désormais avec des top-managers la manière dont cet argent sera dépensé - et augmente les besoins de financement. Depuis plusieurs jours, des propositions pour deux nouveaux fonds spéciaux, qui pourraient être décidées à court terme par la CDU/CSU, le SPD et les Verts, font la une des journaux. Il s'agit en premier lieu d'un pot de la dette de 400 milliards d'euros pour les dépenses de défense. Par ailleurs, il est question d'un budget financé par la dette de 400 à 500 milliards d'euros pour les infrastructures. C'est ce qu'a proposé un groupe d'économistes autour de Moritz Schularick, président de l'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW). Dans un document de référence que le F.A.Z. s'est procuré, Schularick concrétise désormais les propositions pour le fonds de défense en collaboration avec des spécialistes connus de l'économie. Les signataires sont, outre Schularick, l'ancien président du conseil d'administration d'Airbus Tom Enders, l'ancien patron de Deutsche Telekom et actuel président du conseil de surveillance d'Airbus René Obermann et l'entrepreneuse de capital-risque Jeannette zu Fürstenberg (Helsing CEO). Le cœur du document est un appel à orienter de manière ciblée les milliards de la défense vers la création d'une « supériorité asymétrique » en cas de guerre. Les auteurs écrivent : « En somme, les propositions visent “l'extrémité tranchante” de la défense, c'est-à-dire la supériorité sur le champ de bataille moderne, et moins les aspects de soutien ou de logistique de la défense ». En guise d'introduction, le scientifique et les managers appellent à ce que l'Allemagne devienne maintenant l'initiateur d'un projet « SPARTA » (Strategic Protection and Advanced Resilience Technology Alliance) pour la défense européenne, compte tenu de la guerre d'agression russe et de l'affaiblissement du soutien américain. Cela signifie « la mise en place immédiate de grands programmes d'armement axés sur les nouvelles technologies et l'acquisition souveraine intra-européenne ». La guerre en Ukraine montre que la supériorité sur le champ de bataille s'obtient aujourd'hui par la masse combinée à l'excellence technologique. Les auteurs énumèrent ensuite de nombreuses mesures concrètes, qui devraient toutes pouvoir être mises en œuvre dans un délai de six mois à cinq ans maximum. « Mur de drones à grande échelle au-dessus du flanc est de l'OTAN ». A court terme, ils demandent entre autres un « mur de drones à grande échelle au-dessus du flanc est de l'OTAN ». Une telle barrière pourrait, s'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de drones de combat, dissuader efficacement un agresseur. La surveillance sous-marine dans les pays baltes doit également être rapidement développée en collaboration avec les États riverains de la mer Baltique, « afin d'empêcher la Russie de mener une guerre hybride dans le domaine des infrastructures critiques ». Plutôt à moyen terme, les auteurs estiment que des améliorations techniques sont nécessaires, par exemple un « nuage combiné européen multi-domaines pour l'utilisation décentralisée et en réseau des données sur le champ de bataille ». Sur le thème de la dissuasion nucléaire, le document recommande une coopération de l'Allemagne avec la France et la Grande-Bretagne. Le scientifique et les managers estiment qu'un débat sur le nombre de chars et d'avions n'est pas pertinent. Ils déconseillent également implicitement l'acquisition de nouveaux avions de combat américains : « L'Allemagne a déjà dépensé des sommes considérables pour des avions de combat F-35 ». Leur fonctionnement nécessite des mises à jour régulières des logiciels et une maintenance contrôlée par les Etats-Unis, « ce qui entraîne une dépendance permanente », préviennent les auteurs. Le chef de la CDU Friedrich Merz avait évoqué le F-35 comme objet d'un éventuel accord avec le président américain. C'était toutefois avant la détérioration des relations transatlantiques. L'annexe du document indique en outre clairement comment se composent les 400 milliards d'euros dont il est question - et que, selon les auteurs, plus de 500 milliards d'euros pourraient même être nécessaires. La première hypothèse des auteurs est que l'Allemagne devra à l'avenir investir entre 3 et 3,5 pour cent de son produit intérieur brut (PIB) dans la défense, ce qui correspondrait à 130 à 150 milliards d'euros par an. La deuxième hypothèse est qu'un futur gouvernement fédéral pourrait réussir à réaffecter dix milliards d'euros par an du budget régulier à la défense. « Dans ces hypothèses, le deuxième fonds spécial devrait couvrir un déficit de financement d'environ 9,5 pour cent du PIB ou 429 milliards d'euros (en prix courants) d'ici 2035 », peut-on lire. Comme les auteurs ne croient pas à des efforts d'économie correspondants de la part des politiques, ils qualifient les besoins calculés de limite inférieure. Dans le cas contraire, le déficit de financement « augmenterait encore nettement et dépasserait les 500 milliards d'euros ». -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
En termes simples : La « bonne » nouvelle, c'est que le frein à l'endettement national ne s'applique plus aux dépenses d'armement. La « mauvaise » nouvelle est que le Bundestag peut continuer à décider chaque année du budget de la défense, si la situation s'améliore, on peut dépenser aussi peu que l'on veut. Sinon, 500 milliards seront consacrés aux infrastructures et les Länder pourront également s'endetter davantage. Ce n'est que le résultat des négociations de coalition, ce n'est pas encore une loi. -
Ils dépensent certes 3,5 PIB pour l'armée (c'est beaucoup, mais ce n'est pas délirant), mais s'ils veulent vraiment faire des économies, ils doivent aussi réduire les dépenses sociales et Medicare et Medicaid. À mon avis, ils ne prélèvent pas assez d'impôts sur leurs riches.
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Ach du Scheiße! -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Cela ne m'étonne pas. Les nationalistes français ont historiquement le mérite louable de ne pas devenir aussi batshit crazy qu'on le voit chez certains autres peuples. -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Ce texte provient de l'historien « officiel » de l'Allemagne en ce qui concerne le long chemin des Allemands vers l'« Ouest ». https://archive.is/ZPNkG#selection-2835.0-2847.160 Trahison sur scène Trump divise le monde en sphères d'influence impérialistes et ne reconnaît que la Chine et la Russie comme égales. L'esclandre avec Selenskyj marque la rupture avec la communauté de valeurs occidentale. L'Europe doit former une nouvelle alliance de défense. Quelques semaines après le début de la deuxième présidence de Donald Trump, il n'y a plus guère de doute : l'année 2025 devrait être le tournant le plus profond de l'histoire mondiale depuis la chute de l'empire soviétique dans les années 1989 à 1991, et même probablement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans - le 8 mai 1945 en Europe et quatre mois plus tard, le 2 septembre, en Asie orientale. Sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt, les États-Unis avaient assumé la responsabilité politique mondiale en tant que puissance dirigeante de l'Occident transatlantique. Sous la deuxième présidence de Donald Trump, ils s'apprêtent à se défaire non seulement de cette responsabilité, mais aussi de leur lien avec l'héritage normatif de leurs pères fondateurs. L'engagement immatériel envers les idées des droits de l'homme inaliénables, de la « rule of law », des « checks and balances » et de la séparation des pouvoirs n'est plus une force qui guide l'action de Trump et de son entourage le plus proche. Le monde se divise en sphères d'influence Une raison importante de ce revirement est évidente : la Russie d'aujourd'hui, contrairement à l'Union soviétique, n'est pas un dangereux rival idéologique des Etats-Unis en quête de domination mondiale, mais une grande puissance parmi d'autres avec laquelle, selon Trump, on peut et on doit faire des « deals ». C'est ce qui explique ce que le nouveau maître de la Maison Blanche et ses acolytes considèrent comme de la « realpolitik ». Ils divisent le monde en sphères d'influence à la manière impérialiste et ne reconnaissent comme égales que la Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine. Le calcul de pouvoir contraindre la Russie, en cas de conflit militaire entre les Etats-Unis et la Chine, sinon à une alliance, du moins à une position neutre, joue manifestement un rôle. Cela équivaudrait à un « renversement des alliances » au détriment de l'Europe. Parallèlement à cette révolution des relations internationales, la nouvelle élite au pouvoir à Washington poursuit la transformation autoritaire des Etats-Unis. En ce qui concerne l'aspect international de sa politique, Trump fait actuellement ses adieux à l'ordre fondé sur des règles sous la forme de la Charte des Nations unies de juin 1945, qui est essentiellement l'œuvre des États-Unis, et à l'« ordre post-guerre froide » tricontinental sous la forme de la Charte de Paris de novembre 1990, qui déclare la démocratie comme seule forme légitime de gouvernement et garantit à tous les États membres de l'ancienne CSCE, aujourd'hui l'OSCE, le droit à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale et au libre choix des alliances. Poutine a opéré sa rupture avec les ordres fondés sur des règles de 1945 et 1990 il y a onze ans déjà et de manière bien plus brutale : avec l'annexion de la Crimée et le début de la guerre larvée dans le Donbass en 2014 (et non pas seulement, comme beaucoup le pensent, notamment en Allemagne, avec la guerre d'agression ouverte contre l'Ukraine le 24 février 2022). L'exemple de l'Ukraine montre actuellement au monde entier le caractère non contraignant de telles prescriptions normatives. Un coup de force des « grands » doit déterminer les frontières de la future Ukraine, le degré de souveraineté de l'Etat résiduel et la certitude de son existence indépendante. Une telle issue de la guerre en Ukraine ne serait rien d'autre que la reconnaissance officielle par les Etats-Unis d'Amérique des résultats de l'agression russe. Un traité sans garanties de sécurité reviendrait à un nouveau Yalta Le coup d'éclat du 28 février, l'affrontement public entre les présidents américain et ukrainien à la Maison Blanche, a apporté des éclaircissements : la « paix » pour l'Ukraine, telle que Trump aimerait la convenir avec Poutine, serait un arrangement sans garanties de sécurité pour l'Etat attaqué. Il reviendrait à un nouveau Yalta, sans que les Etats-Unis puissent invoquer une situation de contrainte militaire comme au début de 1945 : une perspective inacceptable pour l'Ukraine et pour l'Europe. La relation entre les Etats-Unis et la Russie, telle qu'elle se dessine depuis l'arrivée de Donald Trump, apparaît comme une parodie de théories qui ont eu leur heure de gloire dans les années 1960 et 1970 : les théories de la convergence, selon lesquelles les systèmes rivaux du capitalisme et du communisme, confrontés aux mêmes défis économiques et technologiques, devraient se désidéologiser et se scientifiser, perdant ainsi leur caractère antagoniste. Comme on le sait, le conflit Est-Ouest s'est ensuite déroulé de manière moins symétrique que ne l'avait prédit une partie des sciences sociales. La convergence que nous observons aujourd'hui est placée sous le signe du rejet commun par Trump et Poutine des conceptions libérales de l'ordre et des normes contraignantes. Cette politique est bien plus en accord avec les traditions politiques russes qu'américaines. On peut donc se demander si le trumpisme pourra se maintenir longtemps au pouvoir aux Etats-Unis. Mais il ne faut pas attendre du gouvernement Trump-Vance qu'il se sente lié par les obligations de contribution du traité de l'OTAN. L'un des plus proches conseillers du président, Elon Musk, réclame même le retrait des Etats-Unis de l'alliance transatlantique. Les conséquences qui en découlent pour l'Europe sont actuellement le sujet dominant de tous les contacts interétatiques au sein de ce que l'on appelait jusqu'à présent la communauté de valeurs occidentale. L'association d'États de l'Union européenne joue un rôle important dans ces discussions, mais elle ne doit pas être surestimée en tant qu'acteur collectif pour deux raisons : Premièrement, l'UE ne peut pas parler d'une seule voix sur les questions de « grande politique » face à des États membres favorables à Poutine comme la Hongrie et la Slovaquie, et deuxièmement, il ne peut pas y avoir de défense européenne autonome sans la Grande-Bretagne, seule puissance nucléaire européenne avec la France. Une nouvelle communauté européenne de défense - avec le Canada Le fait que le dernier sommet européen sur l'Ukraine se soit tenu à Londres le 1er mars est donc hautement symbolique. La participation de la Norvège, qui n'est pas plus membre de l'UE que le Royaume-Uni, est également importante d'un point de vue stratégique. Dans cette situation, il est logique de rappeler un projet qui a fait l'objet de débats passionnés en Allemagne il y a sept décennies, mais qui n'est jamais devenu réalité : la Communauté européenne de défense (CED). Il s'agissait à l'origine d'une initiative française, soutenue avec emphase par le premier chancelier fédéral, Konrad Adenauer, et approuvée par sa coalition au Bundestag malgré une résistance parlementaire et extraparlementaire massive, mais qui échoua le 30 août 1954 à l'Assemblée nationale française en raison de l'opposition des gaullistes et des communistes. En mai 1955, la contribution allemande à la défense dans le cadre de la CED fut remplacée par l'adhésion directe de la République fédérale à l'OTAN. Il serait toutefois irréaliste aujourd'hui de viser une communauté de défense purement européenne. Un projet comparable de coalition des volontaires et des capables doit d'emblée inclure le Canada, donc être pensé de manière transatlantique et, si possible, être organisé au sein de l'OTAN - tant que cela est possible, en coopération avec les Etats-Unis et seulement s'il n'est pas possible de faire autrement, sans eux. Ce qui lie les États-Unis et l'Europe, c'est l'héritage commun de l'ancien Occident ou, en d'autres termes, de l'Europe latine. L'ébauche de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel (imperium versus sacerdotium) au haut Moyen Âge, qui n'existait que dans le domaine de l'Église occidentale et pas dans celui de l'Église orientale, est devenue le germe d'autres séparations de pouvoirs et donc la condition de possibilité de l'individualisme, du pluralisme social et des Lumières : des acquis fondamentaux pour ce que nous appelons l'Occident. Les colonies de peuplement britanniques en Amérique du Nord faisaient également partie de cet Occident. C'est dans l'une d'entre elles, la Virginie, que fut adoptée, quelques semaines avant la déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776, la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire - une idée révolutionnaire qui traversa aussitôt l'Atlantique Nord et trouva son écho historique dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par l'Assemblée nationale de la France révolutionnaire le 26 août 1789. Droits de l'homme universels et inaliénables, primauté du droit, séparation des pouvoirs, souveraineté populaire et démocratie représentative : ce qui constitue l'Occident moderne sur le plan normatif est un projet commun transatlantique à l'aune duquel la politique pratique des démocraties occidentales doit être jugée à tout moment. Les Lumières ne sont pas arrivées jusqu'à la « bible belt ». A côté de ce qui rapproche, il y a ce qui sépare. Une première différence importante entre l'Europe continentale et les États-Unis a été soulignée dès 1835 par Alexis de Tocqueville dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » : L'essence de la civilisation anglo-américaine est le produit de deux éléments totalement différents qui, ailleurs, se sont souvent fait la guerre, mais qui, en Amérique, se sont mutuellement imprégnés et merveilleusement unis : l'esprit de religion et l'esprit de liberté. En Europe, et plus particulièrement en France, c'est la raison éclairée qui a donné naissance à la revendication de la liberté politique. « En Amérique, c'est la religion qui mène aux lumières ; c'est l'obéissance aux lois divines qui conduit l'homme à la liberté ». En 1952, dans son livre « The Irony of American History », le théologien américain Reinhold Niebuhr a encore nuancé le verdict de Tocqueville. Il considère que la vie spirituelle précoce de l'Amérique est marquée par deux traditions religieuses et morales : le « calvinisme de la Nouvelle-Angleterre et le déisme de la Virginie », qui s'accordent tous deux sur le fait que l'Amérique est une nation éminente, destinée par Dieu à prendre un nouveau départ avec l'humanité. Pour simplifier, on peut dire que l'Amérique pieuse et l'Amérique éclairée étaient d'accord sur leur mission historique. Formulé de manière frappante et avec un emprunt littéraire à Carlo Levi (« Le Christ n'est venu que jusqu'à Eboli ») : Voltaire n'est venu que jusqu'en Virginie (donc pas jusqu'à la Bible Belt). Le penchant de l'Amérique évangélique pour Trump a une longue histoire. Une deuxième différence fondamentale entre l'Europe et l'Amérique pourrait être résumée dans cette phrase : Max Weber n'est pas venu dans le Far West. La formule du sociologue allemand sur l'Etat qui détiendrait le « monopole de la violence physique légitime » reflète l'héritage de l'absolutisme de l'Europe continentale. En Amérique, pays de la « frontière » longtemps ouverte, cette conception de l'État n'a pu s'imposer que de manière limitée. Un droit individuel et collectif à la légitime défense armée, interprété de manière large, bénéficie d'un large soutien social bien au-delà de l'ancien Far West, sans lequel le populisme de type Trump ne serait pas concevable. Une troisième différence entre l'Europe et l'Amérique peut être résumée en une formule courte : Bismarck n'est pas venu à Buffalo. « Pourquoi le socialisme n'existe-t-il pas aux États-Unis ? Tel est le titre d'un livre écrit en 1906 par le sociologue allemand Werner Sombart. Dans sa réponse à la question qu'il s'est lui-même posée, l'absence de vestiges de classes précapitalistes et notamment d'aristocratie, en bref de féodalisme et d'absolutisme, joue un rôle décisif. Pour un pionnier de l'État de sécurité sociale allemand et européen comme le chancelier Otto von Bismarck, il était clair que « le socialisme d'État s'impose » (Bismarck à Moritz Busch, 26 juin 1881). La fin du siècle transatlantique Dans la bouche d'un président américain, une telle phrase était et reste inimaginable. Elle est totalement incompatible avec l'esprit du « rugged individualism » et l'aversion répandue pour le « big government ». En ce sens, Trump s'inscrit dans une vieille tradition américaine lorsqu'il condamne comme non-américain tout ce qu'il considère comme socialiste et qu'il mène une politique du « moins d'État possible ». L'Europe devra concevoir sa relation avec les Etats-Unis sous Donald Trump différemment que sous ses prédécesseurs. Sous l'influence de la présidence de George W. Bush, l'historienne américaine Mary Nolan parlait déjà en 2012 de la « fin du siècle transatlantique » - ce « long XXe siècle » qu'elle fait commencer par l'intensification marquante des relations entre l'Europe et les Etats-Unis au cours de la dernière décennie du XIXe siècle. Quel que soit le successeur de Trump : Une prolongation de ce siècle n'est pas en vue. Les Européens doivent maintenant concrétiser leurs annonces. Les Européens devront par conséquent développer une double stratégie : Reconnaître sobrement les rapports de force réels à Washington et coopérer de manière pragmatique avec les personnes actuellement au pouvoir, tout en insistant fermement sur les valeurs inaliénables de l'Occident, telles qu'elles ont été développées par les pères fondateurs des États-Unis et obtenues de haute lutte par le peuple américain. Ces dernières années, les Européens se sont certes engagés à plusieurs reprises à faire davantage pour leur propre défense et à s'appuyer moins unilatéralement qu'auparavant sur le parapluie américain. Mais ce qu'ils ont fait en pratique dans ce domaine est resté bien en deçà de la force de leurs paroles. « La vérité de l'intention n'est que l'acte lui-même », dit Hegel dans la “Phénoménologie de l'esprit”. A l'avenir, les Européens seront de plus en plus jugés sur l'efficacité de leurs annonces. Ce qui est valable pour l'Europe dans son ensemble l'est encore plus pour l'Allemagne. Dans les années qui ont suivi 1990, la conviction d'être entouré d'amis y était particulièrement répandue et la prise de conscience de la nécessité d'efforts propres dans le domaine de la sécurité extérieure particulièrement faible. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine a donné lieu à une véritable guerre culturelle entre les pacifistes d'opinion autour du parti « Die Linke », de l'alliance Sahra Wagenknecht et d'une partie de l'aile gauche du SPD d'une part, et la majorité des partis démocratiques prêts à se défendre d'autre part, les « pacifistes » d'Allemagne de l'Est semblant avoir entre-temps conquis l'hégémonie culturelle. Il n'est pas difficile de prédire que ce conflit va encore s'intensifier. Vouloir l'éviter serait erroné et dangereux. L'Allemagne, dont les élites se sont en grande partie opposées aux idées de 1776 et 1789 au XIXe siècle et encore dans la première moitié du XXe siècle, doit son ouverture à la culture politique de l'Occident après 1945 avant tout à l'engagement militaire, économique, politique et humanitaire de l'Amérique. Si Washington remet aujourd'hui en question les valeurs de l'Occident, les Allemands ont, plus encore que les autres Européens, l'obligation de défendre face à l'autre, l'Amérique patriotique et constitutionnelle, ce que Trump et les siens considèrent comme un poids normatif. Si le 47e président des Etats-Unis devait contraindre l'Allemagne et l'Europe à cette prise de conscience, ce serait un aspect de son choix que Hegel aurait peut-être qualifié de ruse de la raison. Heinrich August Winkler est professeur émérite de l'université Humboldt de Berlin. Cet été, son livre « Warum es so gekommen ist. Erinnerungen eines Historikers » (Souvenirs d'un historien). -
Tu ne dois pas regarder autant de pornographie financière, sinon tu deviendras un Goldbug. D'ailleurs, puisqu'on en parle : il y a le fonds d'un prestataire français qui fait actuellement l'objet d'un engouement en Allemagne, c'est le Heiliger Amumbo / Saint Amumbo. Tu ne le connais pas ? Il confère une prospérité et une virilité éternelles. C'est un ETF Amundi à effet de levier sur les actions américaines. FR0010755611 (non, ce n'est pas une recommandation d'achat)
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Oui, c'est grave chez vous, que vous puissiez même dormir la nuit... C'est le seul FRF auquel je fais confiance : -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Ah oui, tu parles des règles de la zone euro, 3 %, etc. Si je vois bien, les fonds spéciaux y sont bien sûr considérés comme des dettes indésirables. Mais là tu as quelques années de retard sur le débat allemand, ce n'est plus dans le discours public qu'on veut infliger des sanctions aux voisins (de toute façon dans le cas de la France on en parlait peu, trop puissant), mais qu'on se demande pourquoi on est le dernier idiot vertueux de la colocation à ne pas piller le frigo. Ces derniers temps, les inquiétudes concernant la dette de la France étaient plutôt perçues en Allemagne comme le fait que les marchés obligataires pourraient faire des choses désagréables. La partie austéritaire des économistes en Allemagne va désormais argumenter de la sorte : l'euro va au diable si le dernier gardien de la vertu, le dernier rempart, l'Allemagne, pille le frigo. Selon ce raisonnement, nous nous sommes pour ainsi dire sacrifiés ces dernières années pour la communauté, car nous sommes nobles. Tout le monde devra bientôt payer des intérêts plus élevés. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
En fait, c'est très simple. Imagine la Constitution allemande ainsi Article 1 : L'État fédéral ne peut pas s'endetter davantage que 0,35 pour cent du PIB par an. Les exceptions sont les catastrophes imprévisibles. Dans ce cas, le Bundestag peut dépenser plus d'argent à la majorité simple. Article 2 : L'article 1 ne s'applique pas aux 100 milliards uniques qui pourront être dépensés à l'avenir pour l'armée fédérale. C'est l'état actuel des choses. L'article 3 est maintenant ajouté : Article 3 : L'article 1 ne s'applique pas aux 400 milliards supplémentaires pour la Bundeswehr et aux 400 milliards supplémentaires pour l'infrastructure qui peuvent être dépensés une seule fois. Il est important de comprendre qu'il s'agit d'une modification de la Constitution, pour laquelle il faut non seulement deux tiers du Bundestag, mais aussi deux tiers du Bundesrat (chambre des Länder). Comme l'AfD pourrait bientôt participer au gouvernement des Länder est-allemands, elle pourrait faire obstacle à ces modifications constitutionnelles. Dans une coalition d'un gouvernement de Land, on s'abstient de voter au Bundesrat si on ne peut pas se mettre d'accord. Cela compte comme un vote contre la modification de la Constitution. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Après le théâtre avec Trump, les négociations de coalition laissent entendre que l'on veut encore décider d'un fonds spécial dans l'ancien Bundestag, c'est-à-dire dans les trois prochaines semaines : 400 milliards pour l'armement 400 milliards pour les infrastructures https://www.tagesschau.de/inland/sondervermoegen-pruefung-berichte-100.html -
Je pense que c'est là que réside la raison de nombreux malentendus. Tu ne devrais pas te donner pour mission d'expliquer les raisons du camp Trump. Tu veux nous expliquer pourquoi des gens décents élisent un gouvernement indécent, mais tu n'as pas à le faire. Ce phénomène n'est pas non plus inconnu en Europe. Nous connaissons aussi la théorie du tough love vis a vis de l'Europe de Trump, mais de plus en plus de signes montrent qu'elle ne porte pas. Il y a de l'entreprenariat politique et de la polarisation aux États-Unis et en Europe. C'est un phénomène général des démocraties occidentales, je ne vais pas rejeter la faute exclusivement sur les Etats-Unis, mais je pense que la polarisation y est plutôt de 50/50, alors qu'elle est encore de 80/20 chez nous. Je lis un peu la presse sérieuse américaine et allemande, et en aucun cas je n'y trouve qu'on parle constamment de guerre civile (ni aux USA ni en Europe). Plutôt de l'érosion des institutions.
-
Non, ce n'est pas un Russe. Je suppose qu'il essaie de rationaliser psychologiquement Trump pour faire face au fait que le gouvernement qui agit désormais en son nom est méprisé par 80% des Européens. Ce n'est pas une mince affaire.
-
Toute cette « interview » était un scandale provoqué par la Maison Blanche. La situation là-bas devant la presse est connue sous le nom de « pool spray », où un couple de journalistes pose généralement cinq questions auxquelles il est répondu par des phrases toutes faites. Ensuite, l'attaché de presse renvoie la meute chez elle. Ce n'est pas un club de débat de high school, à moins que l'attaché de presse ne le fasse délibérément. Et de toute façon, tout ce deal de minéraux, c'est du grand n'importe quoi, comment veux-tu mettre la main dans la poche d'un homme nu ? Si Trump voulait de l'argent pour ses livraisons d'armes à l'Ukraine, il se tournerait vers l'Allemagne. Trump veut que l'Ukraine perde la guerre et que l'Europe sombre dans le chaos.
-
Dissuasion nucléaire européenne, voire allemande ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Dissuasion nucléaire
Des sources apparaissent régulièrement en Allemagne, qui montrent que la France tente activement depuis des décennies de mettre le sujet des armes nucléaires à l'ordre du jour. Face à la réticence grincheuse de l'Allemagne à en parler, même en coulisses, il faut interpréter l'obstination française comme le fait que l'élite française est depuis des lustres unanimement parvenue à la conclusion que la question des armes nucléaires doit être placée au début d'une intégration plus profonde. Pas comme une conclusion. Voici une source allemande récente qui parle de 1995 : https://www.cicero.de/aussenpolitik/emmanuel-macrons-europaeische-nuklearabschreckung -
Oh si ! Pouvons-nous au moins nous mettre d'accord sur ce forum pour résilier Netflix ? De toute façon, il n'y a plus que de la merde. Et on ne m'obligera plus à regarder Emily à Paris...
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Comme vous le savez, l'Allemagne n'est pas un État strictement laïque. Il existe des accords très anciens avec les églises, qui n'ont jamais été déclarés invalides. De même, les relations entre l'État et l'Église en Allemagne sont déterminées de manière décisive au niveau des Länder, là aussi il existe des contrats très anciens, etc. Par exemple, en Hesse, il y a des cours de religion dans les écoles, dont le contenu est déterminé par les églises. De même, les Églises sont consultées par l'État dans presque tous les débats/commissions lorsqu'il s'agit de logements locatifs, d'impôts, d'aide sociale ou de SCAF (je caricature, mais juste un peu... ). Or, il se trouve que de plus en plus de personnes quittent l'Église, mais que son influence sur l'État est assez tenace. La relation a maintenant pris un coup avec la CDU : https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migrationsdebatte-union-kirchen-100.html Quand l'Union et les églises se croisent Traditionnellement, les deux églises affichent une grande proximité avec l'Union. Mais depuis une prise de position de l'Eglise sur la « loi de limitation de l'afflux » du chef de la CDU Merz, l'irritation est forte. Une liaison est-elle en train de prendre fin ? Les deux grandes églises d'Allemagne ont marqué le développement et l'histoire des partis de l'Union pendant des années. Les deux parties sont étroitement liées, même si des divergences sont apparues à plusieurs reprises au cours des dernières années. Depuis la semaine dernière, une prise de position des Eglises sur le débat migratoire a ravivé les tensions : les représentants berlinois de l'Eglise protestante d'Allemagne et de la Conférence des évêques catholiques allemands ont publié un document commun sur la « loi de limitation de l'afflux » du candidat à la chancellerie Friedrich Merz, dans lequel les deux représentants des catholiques et des protestants se démarquent sans équivoque de l'Union. Leur conclusion est la suivante : « Du point de vue des Eglises, le projet de loi (...) n'est pas apte à contribuer à la résolution des questions de politique migratoire qui se posent ». Irritations, étonnement et colère En raison de sa clarté, la lettre n'a pas seulement suscité l'irritation de la CDU et de la CSU, mais également l'étonnement et la colère au sein des Eglises. Ainsi, comme l'a déclaré plus tard Beate Gilles, la secrétaire générale de la conférence épiscopale, sa publication du côté catholique n'a pas été coordonnée entre le bureau de Berlin et les évêques. La conférence épiscopale voulait en fait se tenir à l'écart de la campagne électorale. Deux évêques ont même publiquement contredit le document de Berlin. Pour l'instant, ni les responsables des représentations ecclésiastiques à Berlin, les prélats Anne Gidion et Karl Jüsten, ni le président de la Conférence épiscopale allemande, l'évêque Georg Bätzing, ni la présidente de l'EKD, Anna-Nicole Heinrich, n'ont fait de déclaration sur le sujet. Cette dernière a simplement posté des photos sur son canal Instagram, sur lesquelles on la voit en première ligne lors de manifestations critiques envers la CDU. Tensions et désaccords Irme Stetter-Karp se montre différente. La présidente du Comité central des catholiques allemands (ZdK) continue de soutenir le document controversé auprès de la SWR et souligne sa responsabilité de « nommer » les décisions du ZdK sur les thèmes de la politique migratoire « dans les moments décisifs » et de formuler ainsi « une position claire ».Cette position semble toutefois être controversée au sein du ZdK. En effet, l'ancienne présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a renoncé en début de semaine à son affiliation au ZdK en raison de sa colère contre Stetter-Karp. La situation actuelle est particulièrement tendue pour les deux députés CDU Anja Karliczek et Thomas Rachel. Karliczek est également membre du ZdK et présidente de l'Association des femmes catholiques allemandes. Thomas Rachel est membre du Conseil de l'EKD. Les deux hommes politiques ont voté au Bundestag en faveur des propositions de leur groupe parlementaire et donc contre la position du document de l'Eglise.Il n'est donc pas étonnant que Rachel qualifie le « moment de la publication de la prise de position » d'« extrêmement inopportun ». Karliczek souligne qu'elle veut essayer, dans les semaines à venir, de « discuter et de régler les irritations qui sont apparues entre mon parti et certaines parties de l'Eglise ». Il n'est pas certain que cela se fasse sans difficultés. Le chancelier en profite La publication de l'avis de l'Eglise est particulièrement agaçante pour la CDU/CSU, car le chancelier SPD en a profité politiquement. En effet, Olaf Scholz - bien qu'en réalité éloigné de l'Église - a frotté le document et sa recommandation sous le nez du président de la CDU, Friedrich Merz, lors du débat au Bundestag, avec insistance et satisfaction : « Les Églises catholique et protestante ont adressé hier une lettre incendiaire dans laquelle elles mettent en garde avec insistance contre vos propositions, Monsieur Merz ! » Reste à savoir si cette scène est le prélude à une prise de distance désormais plus fréquente entre les Eglises et la CDU/CSU.L'évêque Kirsten Fehrs, présidente du Conseil de l'EKD, tente au moins d'ôter à cette affaire sa virulence partisane. « Quelle que soit la personne qui cite les Eglises, même s'il s'agit du chancelier fédéral, il doit être décisif que l'EKD ne fasse pas de politique partisane », explique-t-elle à la SWR, ajoutant que les Eglises doivent toujours apporter “les perspectives chrétiennes dans les débats de société”. Mais que sont exactement les perspectives chrétiennes en politique, et qui peut les revendiquer ? Le ministre-président de Hesse, Boris Rhein, de la CDU, qui a réagi avec incompréhension à la prise de position controversée de l'Eglise, les voit en tout cas dans les rangs de la CDU/CSU, qu'il a qualifiée dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung de « dernière force politique » à se réclamer clairement du christianisme. Qu'est-ce qui unit - qu'est-ce qui sépare ? La polémique autour de la prise de position des bureaux berlinois de la conférence épiscopale et de l'EKD devrait occuper les esprits plus longtemps. Car elle n'alimente pas seulement le débat récurrent sur la signification et l'actualité du « C » dans les noms des partis de l'Union. Elle met également en évidence le fait que les positions de la CDU/CSU et des Églises, ainsi que celles des catholiques et des protestants, divergent toujours considérablement, que ce soit en matière de politique migratoire, où l'Église protestante montre depuis longtemps une nette proximité avec le parti rouge-vert, ou dans les discussions sur l'interruption de grossesse et le suicide assisté. Mais le débat sur les divergences de fond entre l'Union, les catholiques et les protestants ne devrait pas être le seul à se poursuivre - la question de leurs relations mutuelles également. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Ici, tu peux voir quels groupes d'âge ont voté : Les jeunes ont surtout voté pour des partis extrêmes (parti de gauche, AfD), les vieux pour les partis populaires centristes. -
Qui est le type avec le rouge à lèvres ?
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Il y a toujours de l'entrisme de l'étranger, mais je ne tiendrai pas Poutine ou Musk pour responsables du succès de l'AfD. Si l'on attribue toute politique déplaisante à des influences étrangères, on corrompt le discours public/démocratique. On devient paranoïaque et on cherche des traîtres partout.