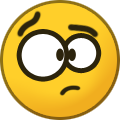-
Compteur de contenus
25 517 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Je n'ai pas dit que cela avait "à voir". J'ai dit, en reprenant ta formule que c'était "une espèce d'union", parmi d'autres. Refuser de considérer que la CEI constitue "une espèce d'union", c'est tiré par les cheveux. Je me fais une extinction de voix à force de répéter que ce n'est pas ce que je considère pour le référendum de 1991. J'exprime une divergence avec l'affirmation précédente de @Ciders , qui revenait à considérer que le référendum de 1991 exprimait un rejet culturel de la Russie. Il faut cependant interpréter ce qui s'est passé entre ces deux dates (1991 et 2022). Une interprétation assez dominante dans nos médias a été que le vote Ianoukovitch avait été un vote pour un président "pro-russe", voire "pro-Poutine", [ ce que j'ai contesté ici : http://www.air-defense.net/forum/topic/19078-ukraine-3/page/152/#comment-1472161 et là http://www.air-defense.net/forum/topic/26674-guerre-russie-ukraine-2022-répercussions-géopolitiques-et-économiques/page/61/#comment-1499796 ], avec des scores très élevés dans les régions russophones. Il y a une corrélation entre les préférences linguistiques et le vote Ianoukovitch qu'il convient d'expliquer. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est ce que je dis. Les russophones et les ukrainophones ont voté presque de la même façon, ce qui indique qu'ils ne se sont pas séparés sur des questions culturelles qui n'étaient pas l'enjeu de ce référendum. L'Ukraine a adhéré à la Communauté des Etats Indépendants dès 1991. Elle a bénéficié de tarifs préférentiels pour le gaz russe jusqu'à relativement récemment. La Russie est resté pendant de longues années après l'indépendance le premier partenaire économique de l'Ukraine. -

Ukraine 3
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.spiegel.de/politik/andrij-melnyk-israelische-botschaft-wirft-botschafter-der-ukraine-verharmlosung-des-holocausts-vor-a-d8fa72cd-0356-4364-bdfd-285260f2d781 (1er juillet 2022) Les critiques à l'encontre de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne ne faiblissent pas. La représentation diplomatique d'Israël qualifie les propos d'Andrij Melnyk de "distorsion des faits historiques". L'ambassade d'Israël en Allemagne a accusé l'ambassadeur ukrainien Andrij Melnyk de minimiser l'Holocauste après ses déclarations controversées dans une interview. Melnyk fait l'objet de critiques pour ses déclarations sur l'ancien leader nationaliste ukrainien Stepan Bandera (1909-1959). "Les déclarations de l'ambassadeur ukrainien constituent une distorsion des faits historiques, une minimisation de l'Holocauste et une insulte à ceux qui ont été assassinés par Bandera et les siens", a déclaré sur Twitter l'ambassade d'Israël à Berlin. Les déclarations de Melnyk "sapent également la lutte courageuse du peuple ukrainien pour vivre selon les valeurs démocratiques et en paix". Des partisans nationalistes de l'ouest de l'Ukraine ont été responsables en 1943 d'expulsions à caractère ethnique au cours desquelles des dizaines de milliers de civils polonais ont été assassinés. Melnyk avait pris la défense du chef Bandera dans une interview avec le journaliste Tilo Jung et avait déclaré : "Bandera n'était pas un tueur de masse de juifs et de Polonais". Selon lui, il n'existe aucune preuve à ce sujet. Melnyk a déjà fait l'objet de nombreuses critiques pour ses déclarations. Le célèbre pianiste Igor Levit a condamné l'extrait sur Twitter en le qualifiant d'"hypocrisie". L'ambassadeur ukrainien renie une partie de son histoire, argumente Levit. "Il joue à l'ignorant. Quel déni de l'histoire. Quelle déformation de l'histoire". Puis il enchaîne : "Honte à vous". Le gouvernement polonais s'est également indigné vendredi contre Melnyk. "Une telle conception et de tels propos sont absolument inacceptables", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Marcin Przydacz à la plateforme Internet Wirtualna Polska. A la question de savoir si la Pologne attendait des excuses de Melnyk, Przydacz a répondu : "Nous sommes plus intéressés par la position du gouvernement ukrainien que par celle des individus". Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a également fait une déclaration - et s'est distancié des propos de Melnyk. "L'opinion de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, Andrij Melnyk, exprimée dans une interview avec un journaliste allemand, est personnelle et ne reflète pas la position du ministère ukrainien des Affaires étrangères", a indiqué l'autorité dans la nuit de jeudi à vendredi dans un communiqué rédigé en anglais sur son site officiel. L'ambassadeur provoque depuis longtemps par son admiration pour le leader nationaliste Bandera. Juste après son entrée en fonction en 2015, il a déposé des fleurs sur sa tombe et, après le début de la guerre en Ukraine, il s'en est pris sur Twitter à tous ceux qui dénonçaient ce culte du héros. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Mon interprétation du vote de 1991 est que les Ukrainiens comme les autres soviétiques, donc comme les Russes s'étaient persuadés qu'ils devaient changer de système économique et abandonner le communisme pour passer à une économie de marché. Le plus court chemin pour y parvenir était de dissoudre l'Union. Rien de culturel là dedans. Un simple réflex de rationalité économique, un désir d'amélioration du niveau de vie, de retrouver la prospérité. Un sentiment d'incompétence des dirigeants du parti communiste de l'union soviétique. Bref, le dégagisme. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Ce n'est pas mon interprétation. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Cela ne permet pas de conclure dans un sens ou dans un autre, puisque l'expression "scène culturelle ukrainienne" peut aussi bien recouvrir la culture ukrainophone, que la culture russophone en territoire ukrainien. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
1960 et 1970 ce n'est pas "avant la guerre" dont parle le texte, à savoir la seconde guerre mondiale. C'est l'inverse : c'est Postychev qui a fait supprimer l'enseignement en ukrainien à l'université : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Postychev Avant le retour de Postychev, le parti communiste avait encouragé, ou du moins autorisé, l'utilisation de la langue ukrainienne dans les écoles, et la création de cours d'histoire et de langue ukrainiennes dans les universités. Ces cours universitaires ont été fermés en janvier 1933, et en juin, Postychev a accusé le commissaire du peuple ukrainien à l'éducation Mykola Skrypnyk de "détruire" les écoles et les universités en permettant aux " porcs " d'en prendre le contrôle - " et vous les avez souvent défendus ". Donc non, le PCUS n'a pas "toujours veillé à éliminer (...) tout soutien apporté à la langue ou à la culture ukrainienne". -

Corée du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDIATEK-INC-6495333/actualite/Les-valeurs-des-puces-chutent-alors-que-les-perspectives-de-Micron-signalent-un-relachement-de-la-de-40876656/ (1er juillet 2022) Ranjit Atwal, analyste directeur senior chez Gartner, a déclaré que la baisse des ventes de smartphones et de PC entraînera une atténuation de la pénurie de puces cette année. Atwal, qui s'attendait à ce que l'offre et la demande de puces s'équilibrent l'année prochaine, prévoit que ce cycle sera avancé à cette année. Il a déclaré que le déclin du marché des smartphones ne devrait pas être compensé par une hausse de la demande de puces de la part des constructeurs automobiles. TSMC, le plus grand fabricant de puces à façon au monde, a vu ses principaux clients réduire leurs commandes de puces pour le reste de l'année 2022. Tesla, qui utilise des centaines de puces dans ses voitures électriques, a fermé un bureau en Californie et licencié environ 200 travailleurs. Le PDG Elon Musk a précédemment déclaré qu'il avait un "super mauvais" pressentiment concernant l'économie et que l'entreprise devait réduire son personnel salarié d'environ 10 %. Plus tôt cette semaine, Volkswagen a déclaré que la pénurie de puces s'atténuait et commençait à compenser les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Et donc comment interprêtes-tu la version de Natascha Wodin ? http://www.air-defense.net/forum/topic/26674-guerre-russie-ukraine-2022-répercussions-géopolitiques-et-économiques/page/45/#comment-1498030 La sœur de ma mère, qui a étudié à Odessa avant la guerre et qui a finalement été déportée au goulag en tant que contre-révolutionnaire, décrit dans son journal qu'il était alors interdit de parler russe à l'université. Seul l'ukrainien était autorisé. Plus tard, en Union soviétique, on ne faisait plus guère de différence entre les Russes et les Ukrainiens, c'était pratiquement un seul peuple avec une longue histoire commune. Odessa, avant la guerre, c'était l'Union Soviétique. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/06/in-ukraine-russian-is-now-the-language-of-the-enemy (9 juin 2022) Andrïy Kourkov, écrivain : Jusqu'en 2014, Rafeenko a vécu à Donetsk, dans la région du Donbas, dans l'est de l'Ukraine. Son œuvre a été publiée principalement en Russie, où il a reçu trois prestigieux prix littéraires. Il ne parlait pas ukrainien, mais il était alors facile de vivre à Donetsk sans cette langue. Cependant, lorsque la guerre dans le Donbas a éclaté au printemps 2014, lui et sa femme ont quitté leurs deux appartements et leurs emplois à Donetsk et sont partis vers l'ouest. Là, Andriy Bondar, un écrivain et traducteur ukrainophone, les a installés dans sa datcha près de Boutcha. Rafeenko est ainsi devenu un habitant de la région de Kiev. Il a appris l'ukrainien et a même commencé à écrire en ukrainien. Son premier roman dans sa nouvelle langue, Mondengrin, a nécessité une sérieuse révision, et une fois de plus Bondar est intervenu pour l'aider. Après la sortie du roman en 2019, Rafeenko a promis d'écrire ses futurs romans en russe et en ukrainien, en alternant entre les deux langues. Cependant, le 31 mai, après avoir survécu un mois sous l'occupation russe de Boutcha, il a publiquement renoncé à la langue russe et a déclaré qu'il n'écrirait plus jamais de texte en russe - et qu'il ne parlerait même plus jamais russe. "Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette langue", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision ukrainienne. Pendant mon enfance, dans les années 1960, Kiev était presque entièrement russophone. La plupart des écoles enseignaient également en russe. Si quelqu'un dans la rue parlait ukrainien, les gens pensaient qu'il venait du village, ou qu'il était un intellectuel étrange, ou peut-être même un nationaliste ukrainien. En grandissant, je lisais des livres en russe, et la moitié de mes écrivains préférés appartenaient à la littérature russe : Andrei Platonov, Daniil Kharms, Boris Pilnyak, Maxim Gorky. L'écrivain ukrainien russophone Nikolaï Gogol était et reste l'un de mes auteurs préférés. À cette époque, avoir l'ukrainien comme première langue était considéré par beaucoup comme un handicap. La politique de l'État soviétique était d'empêcher l'ukrainien de surmonter l'impression d'être une langue paysanne [1]. [1] À comparer avec la version de Natascha Wodin : http://www.air-defense.net/forum/topic/26674-guerre-russie-ukraine-2022-répercussions-géopolitiques-et-économiques/page/45/#comment-1498030 La sœur de ma mère, qui a étudié à Odessa avant la guerre et qui a finalement été déportée au goulag en tant que contre-révolutionnaire, décrit dans son journal qu'il était alors interdit de parler russe à l'université. Seul l'ukrainien était autorisé. Plus tard, en Union soviétique, on ne faisait plus guère de différence entre les Russes et les Ukrainiens, c'était pratiquement un seul peuple avec une longue histoire commune. La migration linguistique du russe vers l'ukrainien a pris une nouvelle urgence depuis le 24 février, mais elle a commencé au début des années 1990, dans les premières années de l'indépendance de l'Ukraine. À cette époque, la célèbre romancière Irène Razdobudko a quitté Donetsk pour Kiev et a commencé à travailler en ukrainien. Elle connaissait déjà la langue, la transition n'a donc pas été si difficile pour elle. De plus, à cette époque, la Russie n'avait pas encore commencé à "défendre" la langue russe et les russophones en Ukraine. Les livres en russe se vendaient mieux que les livres en ukrainien. Les magazines et journaux de luxe publiaient des critiques portant principalement sur des livres en langue russe (qui étaient pour la plupart publiés en Russie). En fait, à cette époque, jusqu'à 80 % des livres vendus dans n'importe quelle librairie étaient écrits en russe. L'avenir de la littérature ukrainienne était définitivement incertain. Peu à peu, la tendance s'est accélérée, mais elle s'est déroulée discrètement, avec peu de commentaires dans la presse et encore moins de réactions de la part des lecteurs et du public en général. Pour la plupart des jeunes écrivains en herbe, le choix de la langue n'était plus un problème - ils ont immédiatement commencé à écrire en ukrainien. Ce mouvement a été soutenu par des fondations de la diaspora au Canada et aux États-Unis qui ont accordé des subventions aux maisons d'édition qui publiaient des livres en ukrainien. Pourtant, sur le plan économique, la publication de livres en ukrainien est restée peu rentable pendant les dix à quinze premières années de l'indépendance. Dans ces années-là, de nombreux intellectuels et critiques supposaient que les auteurs qui continuaient à écrire en russe étaient orientés vers le marché du livre russe et qu'ils n'étaient donc pas considérés comme des écrivains ukrainiens. À l'époque, beaucoup me considéraient comme l'un de ces écrivains "non ukrainiens". À la fin des années 1990, mes romans avaient plus de succès en Russie qu'en Ukraine et je recevais même des demandes d'éditeurs russes pour que mes livres soient situés en Russie et non en Ukraine. J'ai ignoré ces demandes. Pourtant, les lecteurs russophones d'Ukraine n'ont jamais eu beaucoup de respect pour la littérature en langue russe produite localement. Ils avaient tendance à préférer la "véritable" littérature russe qui sortait de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Si un auteur ukrainien était publié en Russie, c'était un signe de qualité - un sceau d'approbation du "gardien de la littérature russe", comme la Russie se considérait elle-même. Néanmoins, les auteurs russophones de l'étranger étaient généralement traités avec une certaine condescendance en Russie, même par leurs éditeurs. Ces projets étaient souvent décrits comme un acte d'aide humanitaire plutôt que comme une reconnaissance du talent de l'auteur. Les écrivains pensaient a priori qu'un auteur russophone qui voulait connaître le succès et la reconnaissance devait s'installer en Russie. Après l'indépendance, certains écrivains de langue russe bien connus ont fait le déplacement en quête de gloire et de fortune. Par exemple, les auteurs ukrainiens de romans fantastiques les plus connus, Marina et feu Sergiy Dyachenko, ont été parmi les premiers "migrants littéraires". Ils n'aimaient pas Moscou, et ils s'attendaient probablement à un succès bien plus grand. Très vite, ils sont partis pour New York. Pour beaucoup de ceux qui sont restés en Ukraine, cependant, Moscou est restée une sorte de point d'appui culturel jusqu'à très récemment. Même après l'annexion de la Crimée en 2014 et le début de la guerre dans le Donbas, certains auteurs ukrainiens ont continué à publier leurs livres à Moscou et à participer à des événements littéraires dans cette ville. Au début de cette année - juste avant la nouvelle phase de l'agression russe - l'un des poètes ukrainiens russophones les plus connus, Oleksandr Kabanov, a publié deux livres à Moscou et a participé à des présentations en ligne de ses livres pour les lecteurs russes. Il est difficile d'imaginer que ce serait si facile à faire maintenant. En ligne et dans les conversations informelles, les patriotes ukrainiens qualifient de plus en plus souvent le russe de "langue de l'ennemi". Ceux qui approuvent cette rhétorique préféreraient ignorer le fait que jusqu'à 40 % des Ukrainiens ont le russe comme langue maternelle. Cependant, si certains d'entre eux ne veulent plus parler russe, beaucoup d'autres ne veulent plus en parler. Ils se sont tus - non pas que les Ukrainiens russophones aient jamais fait beaucoup de bruit pour le droit de parler leur langue maternelle, malgré ce que dit la propagande du Kremlin. Bien que la prétendue suppression de la langue russe ait été utilisée par Moscou pour justifier en partie la guerre dans le Donbas, c'est un non-sens ; il s'agit d'une région où la ville ukrainophone de Kremenna a coexisté pacifiquement pendant des décennies avec Rubizhne russophone. Chaque fois que l'Ukraine a dû s'opposer à l'agression de Vladimir Poutine, l'idée de perdre le russe - l'idée que la langue disparaisse du paysage culturel - est devenue plus acceptable pour un plus grand nombre d'Ukrainiens russophones. Nous avons assisté à un changement après la Révolution orange en 2006, après la Révolution de la dignité en 2014 et de nombreuses autres fois par la suite, alors que la Russie annexait la Crimée et orchestrait la poussée séparatiste dans l'est du pays. Le meurtre de dizaines de milliers d'Ukrainiens par la Russie depuis l'invasion est un argument de poids contre la présence de la langue et de la culture russes en Ukraine. Le nombre d'écrivains et de lecteurs russophones est appelé à diminuer considérablement. J'ai commencé à utiliser l'ukrainien pour écrire des ouvrages non fictionnels il y a quelques années, mais je continue à écrire des ouvrages de fiction en russe. Mes livres sont publiés en russe et dans des traductions ukrainiennes, mais je sais que mes livres en ukrainien se vendent mieux. Les ukrainophones lisent beaucoup plus que les russophones en Ukraine. C'est une nouvelle réalité que personne ne peut ignorer. Et l'État n'achète que des livres en ukrainien pour les bibliothèques. Tout cela remet en question la rationalité de la publication de livres en russe en Ukraine. Ils continueront à être publiés, mais les tirages en russe seront moins importants. Et dernièrement, je me suis dit que je ne devrais pas publier de livres en russe du tout, du moins pas avant la fin de la guerre. Plus tard, lorsque la Russie aura laissé l'Ukraine en paix et que celle-ci pourra suivre la voie européenne qu'elle a choisie, nous pourrons réfléchir à nouveau à la question de la langue et prendre une décision définitive. Cela fait longtemps que je n'ai plus de lectorat en Russie ; mes livres n'y ont pas été publiés depuis près de 15 ans. Pendant un certain temps, les lecteurs ukrainophones ont été plus importants pour moi que les lecteurs russophones. Pourtant, la langue russe peut s'avérer être ma langue "interne", la langue de mes rêves et de mes pensées, ma langue de travail. Une langue interne n'a pas besoin d'un statut officiel. Et bien sûr, la langue maternelle est un statut qui ne peut être annulé, même si les gens autour de vous continuent à l'appeler "la langue de l'ennemi". Oui, c'est la langue de mon ennemi, mais cette langue n'est pas un ennemi pour moi. -

Corée du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/06/30/business/tech/Korea-Samsung-Electronics-LG-Electronics/20220630183125355.html Samsung Electronics et LG Electronics sont confrontés à des niveaux de stocks historiquement élevés, alors que la demande d'appareils électroniques faiblit et que le monde se retrouve inondé de tout, des smartphones aux appareils ménagers. Le passage de la pénurie à la surabondance pourrait avoir un impact de grande ampleur. Les entreprises réduisent leurs commandes auprès des fournisseurs de pièces détachées. Les travailleurs font moins d'heures et perdent leur emploi. Les problèmes ont été aggravés par la constitution de stocks et la surproduction, les entreprises ayant anticipé une forte demande due à la reprise économique et aux dépenses de revanche. "La combinaison de la pression inflationniste, du verrouillage prolongé de la Chine et des tensions géopolitiques en Europe de l'Est a fait chuter le sentiment des consommateurs", a déclaré Kim Ji-san, analyste chez Kiwoom Securities. Le nombre de smartphones Samsung Electronics détenus par les détaillants et les grossistes a atteint 50 millions, selon les médias locaux. La plupart des produits en stock sont des appareils de la série Galaxy A, qui sont des produits à bas prix. Park Hyung-wou, analyste chez Shinhan Financial Investment, prévoit que l'entreprise technologique a abaissé de 10 % son objectif de production pour 2022, à 270 millions d'appareils. "Samsung Electronics a notifié à tous les groupes commerciaux de suspendre leurs achats et de contrôler l'état de leurs stocks", indique le rapport de la DSCC. "Samsung a informé les fabricants d'écrans plats sur les marchés des smartphones et des téléviseurs que les achats de panneaux seraient interrompus." La société s'approvisionne en panneaux d'affichage à cristaux liquides (LCD) auprès des entreprises chinoises BOE et HKC. La surabondance de stocks chez les détaillants américains d'électronique grand public indique que la surabondance n'est pas prête de se résorber. Best Buy a déclaré 74 jours d'inventaire au premier trimestre, soit environ 14 jours de plus que la normale, selon le DSCC. Best Buy fait partie des cinq premières entreprises clientes de Samsung Electronics. Le stock d'Amazon a atteint son niveau le plus bas (22 jours) à la fin du mois de juin 2020, mais a atteint un niveau record de 57 jours à la fin du mois de mars de cette année. L'anémie de la demande constitue également un signal d'alarme pour le secteur des puces mémoire, dont les prix évoluent en fonction des ventes d'appareils électroniques grand public. Les prix des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) devraient chuter de 3 à 8 % au troisième trimestre, selon l'organisme de suivi du marché des semi-conducteurs TrendForce. Au troisième trimestre, le marché des DRAM sera touché par la faible demande d'électronique grand public résultant de la guerre russo-ukrainienne et de l'inflation élevée. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
La crise du néon : https://www.engineering.com/story/neon-supply-is-in-crisis-we-were-warned (24 juin 2022) Il s'avère que dans les lasers argon-krypton, qui sont essentiels pour l'architecture des puces de 14 nm couramment utilisées aujourd'hui, le néon, qui représente 95 % du mélange gazeux à l'intérieur du laser, ne produit pas d'effet laser, mais reste essentiel au processus. Les procédés industriels le produisent par réfrigération de l'air jusqu'à ce qu'il devienne liquide, puis par distillation du liquide pour en faire bouillir les différentes fractions, un peu comme le raffinage de l'essence à partir du pétrole brut. Ce procédé est coûteux, trop coûteux pour être utilisé uniquement pour obtenir du néon, mais l'industrie sidérurgique l'utilise pour produire des quantités massives d'oxygène, qui est facilement disponible dans l'air. Les gaz à l'état de traces, comme le néon, le xénon et d'autres gaz, s'évaporent séparément et sont réservés à d'autres usages industriels. Mais la fabrication de l'acier est géographiquement dispersée, les aciéries fonctionnant individuellement et produisant relativement peu de ces gaz rares à l'état de traces. Pour que le processus soit économiquement viable, il faut concentrer un grand nombre d'aciéries dans une petite zone pour créer un grand système d'alimentation par distillation d'air. Et l'Union soviétique, toujours championne des mégaprojets, s'est exécutée en construisant des complexes sidérurgiques massifs et concentrés dans l'est de l'Ukraine. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'en 2014 et 2015, un bref conflit a éclaté dans l'est de l'Ukraine, et que les analystes de l'industrie des semi-conducteurs de l'époque ont mis en garde contre les conséquences d'une grave interruption de l'approvisionnement en néon. Dans les huit années qui ont suivi, il semble que personne n'ait rien fait pour diversifier la chaîne d'approvisionnement en néon, préférant laisser une région de l'Ukraine fournir la moitié ou les trois quarts de ce gaz de procédé critique pour l'industrie mondiale des puces. Les Chinois se démènent pour s'assurer que leur industrie nationale en a suffisamment et, bien entendu, les prix du néon ont explosé. Les personnes qui fabriquent les lasers cherchent des moyens de réduire la quantité de gaz néon utilisée dans les systèmes. Le gaz néon s'use, et un grand fabricant, TSMC, a lancé un programme de recyclage. https://www.zdnet.fr/actualites/en-ukraine-les-fabricants-de-neon-stoppent-leur-production-39938883.htm Aux côtés de la Chine, l’Ukraine est l’un des premiers producteurs mondiaux de ce type de gaz. La société Ingas, basée à Marioupol, produisait entre 15 000 et 20 000 m3 de gaz par mois, tandis que Cryoin, installée à Odessa, produisait de son côté entre 10 000 et 15 000 m3 de gaz par mois. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lecho.be/dossiers/conflit-ukraine-russie/jeffrey-sachs-universite-de-columbia-je-ne-crois-pas-que-les-etats-unis-ou-l-ukraine-puissent-gagner-cette-guerre/10394901.html (12 juin 2022) Jeffrey Sachs (université de Columbia): "Je ne crois pas que les États-Unis ou l’Ukraine puissent 'gagner' cette guerre" Une paix négociée se traduirait par la neutralité ukrainienne et le non-élargissement de l’Otan. Or, ceci va à l’encontre de la politique américaine qui vise à encercler la Russie dans la région de la mer Noire. Pour cette raison, les États-Unis ne sont pas encore prêts à accepter un accord fondé sur la non-expansion de l’Alliance atlantique. Et il s’agit là d’une grave erreur, commise dès 2008, avec la promesse d’adhésion faite à l’Ukraine et à la Géorgie, malgré l’opposition de nombreux pays européens. L’Europe doit comprendre que ses intérêts vitaux ne coïncident pas avec l’hégémonie américaine et l’élargissement de l’Otan. La structure centralisée du pouvoir chinois date de 221 av. J.-C. Imaginer que la Chine puisse ressembler à une démocratie parlementaire européenne ou à la démocratie présidentielle américaine relève vraiment de la naïveté! Une coopération, fructueuse pour tous, en matière commerciale, touristique, culturelle et scientifique, ne peut présupposer que la Chine se transforme un jour en une démocratie libérale. La vision portée par le président Joe Biden, qui conçoit les relations internationales comme un affrontement entre démocraties et autocraties, est erronée. Le gouvernement américain représente aussi une importante source de propagande ! Une grande partie des informations diffusées, aux États-Unis, sur la politique étrangère, la guerre en Ukraine… sont manipulées, voire mensongères. Je suis donc plutôt sceptique sur ce nouveau « Conseil de la gouvernance de la désinformation ». -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
29 juin 2022. Pacal Boniface : 04:26 Le piège, ce serait de transformer l'OTAN en alliance militaire du "choc des civilisations", de faire de cette alliance contre la menace soviétique et maintenant russe, une alliance un peu globale, qui devrait pouvoir intervenir sur tous les terrains, sous toutes les latitudes, et qui viendrait toujours, sous leadership américain, contrer la menace chinoise. 06:00 Mais il faut faire attention à une tendance américaine de militariser la réponse à des défis politiques. Il ne faudrait pas qu'on reproduise le schéma de ce qui s'est produit avec la Russie : au départ des divergences, et puis un clivage de plus en plus important et puis finalement aujourd'hui un antagonisme. Et donc le fait que l'OTAN mette la Chine au centre de ses préoccupations peut être un danger, et nous devons, nous pays européens, résister à cela, parce que sur ce point nous ne partageons pas l'agenda des États-Unis. 07:19 Est-ce qu'il [Biden] demande une alliance ou un alignement ? (...) Nous ne devons pas cesser de réfléchir et de voir quels sont nos intérêts à long terme. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.tagesschau.de/inland/offener-brief-ukraine-verhandlung-101.html (30 juin 2022) Des personnalités allemandes ont appelé dans une nouvelle lettre ouverte les États occidentaux à mettre fin à la guerre en Ukraine par des négociations. Dans cet appel intitulé "Waffenstillstand jetzt !" et publié dans l'hebdomadaire Die Zeit, des personnalités allemandes connues comme le philosophe Richard David Precht, la romancière Juli Zeh et le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar demandent une "avancée concertée" pour des négociations. https://www.zeit.de/2022/27/ukraine-krieg-frieden-waffenstillstand (29 juin 2022) Un cessez-le-feu maintenant ! Les auteurs de cet appel demandent à l'Occident de mettre fin à la guerre en Ukraine par des négociations. Juli Zeh et Richard David Precht font partie des signataires. L'Europe est confrontée à la tâche de rétablir la paix sur le continent et de la garantir à long terme. Pour cela, il est nécessaire de développer une stratégie pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. C'est notamment grâce à des sanctions économiques massives et à un soutien militaire de l'Europe et des États-Unis que l'Ukraine a pu se défendre jusqu'à présent contre la guerre d'agression brutale menée par la Russie. Plus les mesures se prolongent, plus le but de guerre qui leur est lié devient toutefois flou. Une victoire de l'Ukraine avec la reconquête de tous les territoires occupés, y compris les oblasts de Donetsk et de Louhansk et la Crimée, est considérée comme irréaliste par les experts militaires, car la Russie est militairement supérieure et possède la capacité de poursuivre l'escalade militaire. Les pays occidentaux qui soutiennent militairement l'Ukraine doivent donc se demander quel est leur objectif exact et si (et pendant combien de temps) les livraisons d'armes restent la voie à suivre. La poursuite de la guerre dans le but d'une victoire totale de l'Ukraine sur la Russie signifie des milliers de victimes de guerre supplémentaires qui meurent pour un objectif qui ne semble pas être réaliste. En outre, les conséquences de la guerre ne se limitent plus à l'Ukraine. Sa poursuite provoque des urgences humanitaires, économiques et écologiques massives dans le monde entier. En Afrique, la famine menace et pourrait coûter la vie à des millions de personnes. La hausse rapide des prix, le manque d'énergie et de nourriture ont déjà provoqué des troubles dans de nombreux pays. La pénurie d'engrais aura également un impact mondial si la guerre se poursuit au-delà de l'automne. Il faut s'attendre à un grand nombre de victimes et à une déstabilisation de la situation mondiale. Ces conséquences dramatiques imminentes sont également thématisées au niveau politique international (G7, ONU). L'Occident doit s'opposer de manière unie à l'agression de la Russie en Ukraine et à d'autres revendications revanchardes. Mais la poursuite de la guerre en Ukraine n'est pas la solution au problème. Les développements actuels concernant le transit ferroviaire vers l'enclave russe de Kaliningrad ainsi que l'annonce par Poutine de la livraison de systèmes de missiles à capacité nucléaire à la Biélorussie montrent que le risque d'escalade s'accroît. L'Occident doit tout mettre en œuvre pour que les parties parviennent à une solution négociée dans les meilleurs délais. Elle seule peut empêcher une guerre d'usure de plusieurs années, avec ses conséquences locales et mondiales fatales, ainsi qu'une escalade militaire pouvant aller jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. Négocier ne signifie pas, comme on le croit parfois, dicter une capitulation à l'Ukraine. Il ne doit pas y avoir de paix dictée par Poutine. Négocier ne signifie pas non plus décider quelque chose au-dessus de la tête des parties concernées. La communauté internationale doit au contraire faire tout son possible pour créer les conditions dans lesquelles les négociations sont possibles. Cela implique de déclarer que les acteurs occidentaux n'ont aucun intérêt à ce que la guerre se poursuive et qu'ils adapteront leurs stratégies en conséquence. Cela implique également la volonté de garantir au niveau international les conditions d'un cessez-le-feu ainsi que les résultats des négociations de paix, ce qui peut nécessiter un engagement important. Plus la guerre se prolonge, plus la pression internationale doit être forte pour que les deux parties retrouvent leur volonté de négocier. L'Occident doit faire tout son possible pour faire pression sur les gouvernements russe et ukrainien afin qu'ils suspendent les combats. Les sanctions économiques et le soutien militaire doivent être intégrés dans une stratégie politique visant à une désescalade progressive jusqu'à l'obtention d'un cessez-le-feu. Jusqu'à présent, aucune initiative concertée n'a été prise par la communauté internationale, notamment par les grands acteurs occidentaux, pour lancer des négociations. Tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas partir du principe qu'une entente est impossible et que Poutine en particulier ne veut pas négocier. Le fait que les belligérants posent des exigences maximales ou refusent expressément les pourparlers de paix n'est pas un point de départ inhabituel dans les conflits enlisés. Le déroulement des tentatives de négociations jusqu'à présent montre une volonté initiale de compréhension de la part des deux parties, avec un rapprochement des objectifs. Seule une offensive diplomatique de grande envergure peut permettre de sortir de l'impasse actuelle. L'ouverture de négociations ne justifie pas les crimes de guerre. Nous partageons le désir de justice. Les négociations sont cependant un moyen nécessaire pour éviter les souffrances sur place et les conséquences de la guerre dans le monde entier. Face à la menace de catastrophes humanitaires et au risque manifeste d'escalade, le point de départ pour le rétablissement de la stabilité doit être trouvé le plus rapidement possible. Seule une suspension des hostilités crée le temps et l'opportunité nécessaires à cet effet. L'importance de l'objectif exige que nous relevions ce défi et que nous fassions tout pour qu'un cessez-le-feu rapide et l'ouverture de négociations de paix soient possibles - et que nous évitions tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cet objectif. Jakob Augstein (journaliste), Richard A. Falk (professeur de droit international), Svenja Flaßpöhler (philosophe), Thomas Glauben (professeur d'économie agricole), Josef Haslinger (écrivain), Elisa Hoven (professeur de droit pénal), Alexander Kluge (cinéaste et écrivain), Christoph Menke (professeur de philosophie), Wolfgang Merkel (professeur de sciences politiques), Julian Nida-Rümelin (philosophe), Robert Pfaller (philosophe), Richard D. Precht (philosophe), Jeffrey Sachs (professeur d'économie), Michael von der Schulenburg (ancien diplomate de l'ONU), Edgar Selge (acteur), Ilija Trojanow (écrivain), Erich Vad (général à la retraite, ancien conseiller militaire d'Angela Merkel), Johannes Varwick (professeur de politique internationale), Harald Welzer (psychologue social), Ranga Yogeshwar (journaliste scientifique), Juli Zeh ( écrivaine) -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.wsws.org/fr/articles/2022/03/07/hist-m07.html Iaroslav Stets'ko, qui «avait écrit des lettres au Führer, au Duce, au Poglavnik [le plus haut nazi croate] et au Caudillo [Franco], leur demandant d’accepter l’État ukrainien nouvellement proclamé, s’est fait désigner en 1966 citoyen d’honneur de la ville canadienne de Winnipeg». L’historien poursuit: «En 1983, il est invité au Capitole et à la Maison-Blanche, où George Bush et Ronald Reagan reçoivent le “dernier premier ministre d’un État ukrainien libre”», c’est-à-dire qui avait existé sous le contrôle du Troisième Reich. «Le 11 juillet 1982», rappelle Rossoliński-Liebe, «pendant la semaine des nations captives, le drapeau rouge et noir de l’OUN-B, introduit lors du deuxième grand congrès des nationalistes ukrainiens en 1941, a flotté au-dessus du Capitole des États-Unis». «Il symbolisait la liberté et la démocratie, et non la pureté ethnique et le fascisme génocidaire. Personne n’a compris qu’il s’agissait du même drapeau qui avait flotté sur l’hôtel de ville de Lviv et d’autres bâtiments, sous lequel des civils juifs ont été maltraités et tués en juillet 1941…» Note : wsws.org est un site avec une idéologie assez critiquable, mais Rossolinski-Liebe est un historien sérieux : -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Madrid : https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/vor-nato-gipfel-ganz-madrid-soll-zu-hause-bleiben-18132504.html (28 juin 2022) Le sommet de l'OTAN débutera mardi soir par un dîner solennel au Palais royal. Mercredi, les discussions au sommet débuteront au centre d'exposition en périphérie de la ville. Depuis lundi, la reine Letizia s'occupe des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Dans un premier temps, elle s'est rendue avec Jill Biden dans une organisation de lutte contre le cancer, puis mardi, elle a visité un centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. Le mercredi, une excursion à La Granja de San Ildefonso près de Ségovie est prévue avec tous les autres. Ce château de style baroque tardif avec ses jeux d'eau était autrefois la résidence d'été des rois. Après le déjeuner à Madrid, ils iront voir le tableau "Guernica" de Picasso. Qui aurait cru que l'OTAN célébrerait de la sorte un artiste communiste affidé de Moscou ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso Picasso adhère, le 5 octobre 1944, au Parti communiste français (PCF) et publie un article dans L'Humanité, les 29 et 30 octobre 1944, intitulé « Pourquoi j'ai adhéré au Parti communiste », dans lequel il explique que son engagement personnel date de la période de la Guerre d'Espagne, renforcé par la lutte des résistants communistes français durant la guerre qui vient de s'achever, et qu'il ne lui suffit plus de lutter avec ses peintures « révolutionnaires » mais de « tout [lui]-même », adhérant à l'idéal communiste de progrès et de bonheur de l'homme63,64. S'il se sent proche des idéaux du parti, il n'en sera jamais un membre actif, gardant sa totale liberté d'expression et prenant position principalement à travers ses tableaux, dénonçant notamment la Guerre de Corée en 1951 et prônant la Paix contre la Guerre dans de nombreuses œuvres. Picasso sera même en butte à de nombreux conflits avec les dirigeants du PCF, notamment quant à un portrait jugé peu respectueux de Joseph Staline, publié à la demande de Louis Aragon le 12 mars 1953 à la une des Lettres françaises. C'est l'affaire du portrait de Staline, au cours de laquelle le PCF oblige Louis Aragon à faire son autocritique. Très opposé à la guerre, Picasso peint la célèbre Colombe de la paix (1949) à l'occasion de son adhésion au Conseil Mondial de la Paix et reçoit à ce titre un prix international de la paix en [1950]. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_mondial_de_la_paix Le 18 mars 1950, le Conseil mondial de la paix lance l'appel de Stockholm qui exige notamment « l'interdiction absolue de l’arme atomique ». Cette initiative est commandée par la peur de la guerre atomique, dans un contexte de guerre froide. La campagne remporte un franc succès populaire, recueillant, selon ses promoteurs, une dizaine de millions de signatures en France (dont celle du jeune Jacques Chirac), tandis que le Kominform annonce le chiffre (rocambolesque) de 560 millions de signatures en Europe. Le nombre disproportionné de signataires venait de pays socialistes. Pour l'historien Pierre Milza, ces chiffres sont « totalement incontrôlables et de toute évidence hautement fantaisistes »2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_international_de_la_paix Des prix internationaux de la paix sont décernés chaque année par le Conseil mondial de la paix, qui récompensent des productions artistiques contribuant à la paix. Ils récompensent essentiellement des compagnons de route du mouvement communiste. -

République tchèque
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://francais.radio.cz/une-vaste-affaire-de-corruption-ebranle-un-des-partis-de-la-coalition-8753745 (20 juin 2022) Une affaire de corruption autour de la société des transports pragois impliquant, entre autres, un adjoint au maire de Prague, membre d’un des partis de la coalition au pouvoir, ébranle le gouvernement à moins de deux semaines du début de la présidence tchèque de l’UE. Alors que la police a inculpé la semaine dernière onze personnes, le ministre de l’Education Petr Gazdík (STAN) a fait savoir dimanche qu’il démissionnait de son poste. Dans le dossier de près de 90 pages consulté par la presse tchèque, résultat de deux ans d’enquête, de filatures et d’écoutes téléphoniques, les enquêteurs décrivent en détail le fonctionnement de ce groupe informel, composé de dirigeants de la société de transports, de politiciens, d’hommes d’affaires et de lobbyistes. La police estime que ce groupe avait mis en place un système lui permettant de placer des proches à des postes clés au sein de la société de transports afin que ces derniers puissent exercer une influence sur les différents appels d’offres et ainsi obtenir des pots-de-vin des entreprises gagnantes. Selon les enquêteurs, à la tête de cette association informelle se trouvait Michal Redl, un homme d’affaires et lobbyiste de Zlín, qui au début des années 2000 a également été lié avec Radovan Krejčíř, importante figure du crime organisé ayant fui la justice tchèque et aujourd’hui emprisonné en Afrique du Sud. https://francais.radio.cz/kaliningrad-une-ville-dans-la-tourmente-fondee-par-un-roi-tcheque-8754499 (28 juin 2022) Il faut savoir que le roi tchèque Ottokar II n’a pas envahi la région de l’actuelle Kaliningrad pour son propre compte mais il était ce qu’on appelle un 'hôte' des chevaliers teutoniques – L'Ordre teutonique est une corporation chevaleresque et monacale qui fonctionne un peu sur le même modèle que les Templiers. Les Chevaliers teutoniques se sont établis dans le Nord-est de l’Europe, en Prusse et en Livonie, et ces moines-soldats sont chargés de conquérir ces régions païennes et de convertir les populations à la foi catholique. C’est une conquête religieuse mais avant tout militaire. Le roi tchèque Ottokar II est à ce moment-là dans une position très particulière. Il est un monarque extrêmement puissant, l’un des premiers personnages de la chrétienté à ce moment-là, qui n’ambitionne rien de moins que de devenir empereur. Un empereur a besoin de prestige, besoin de se poser comme le garant de la foi catholique. Alors pour lui c’est l’occasion de mettre son prestige international en avant, en participant à une croisade, à une entreprise de conquête au nom de la chrétienté. Elle est présentée comme un acte généreux et spontané mais il y a très vraisemblablement tout un calcul politique derrière. L’un de ses lointains successeurs, Jean de Bohême, ressortissant de la très puissante famille des Luxembourg, se rendra au XIVe siècle sur les traces de son prédécesseur Ottokar II. Jean de Bohême a une telle influence que des chevaliers de France et d’Angleterre vont de plus en plus se tourner eux aussi vers la Baltique pour leurs croisades, étant donné que la croisade en Terre sainte est rendue impossible à partir de la fin du XIIIe siècle. Des chroniqueurs, notamment des chroniqueurs tchèques, racontent qu’on tuait tout le monde, y compris femmes, enfants et vieillards. Une fois l’expédition menée, quand les païens acceptent d’entrer en négociation, on arrête les hostilités et on peut passer des accords. En général, le but est d’arriver au baptême d’un prince. Un chef balte accepte de se rendre dans une ville – à Königsberg après sa fondation – et on le baptise avec sa famille. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Comme je disais l'autre jour, c'est superbement discret comme méthode d'espionnage : se répandre dans la presse en propos prorusses. J'admire la grande cohérence de tes positions. En même temps tu penses que pour pouvoir négocier il faut déjà être d'accord (et on se demande ce qui reste à négocier...), en même temps tu penses qu'il ne faut pas lire de publications qui ne pensent pas comme soi-même, autrement dit, il faut déjà être d'accord pour pouvoir écouter ce que l'interlocuteur a à dire (et on se demande bien ce qui reste à débattre...). Cela me rappelle ces réflexions de Raymond Aron et de Barack Obama : - - On pourrait compléter avec les notions plus contemporaines d'"echo chamber" et de "bulle de filtre". -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
- Ne commente pas un article de ce média. Il est reconnu comme extrêmement pro-russe et peu fiable... Je précise pour @Shorr kan : Nous pouvons croire @cracou les yeux fermés sur ce point. Il s'appuie sur une excellente source qui est Wikipédia : Wikipédia s'appuyant elle même sur un auteur qui ne peut être qu'irréfutable puisque néoconservateur : -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Jokowi en visite à Kiev et à Moscou : https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3183448/what-indonesias-joko-widodo-hoping-achieve-when-he-meets (29 juin 2022) "Le premier président de l'Indonésie, Sukarno, avait une relation étroite avec l'Union soviétique au moment de l'indépendance et cela signifie que l'Indonésie a maintenant une relation morale avec la Russie", a déclaré à This Week in Asia Kosman Samosir, maître de conférences en droit international à l'Université catholique Santo Thomas de Medan. "Jokowi aura à cœur d'aider la Russie et l'Ukraine à trouver une solution pacifique au conflit grâce à cette relation morale", a-t-il ajouté, en utilisant le nom couramment utilisé du président. Par le passé, la Russie a également été une source importante d'armes et de matériel militaire pour l'Indonésie, cette dernière achetant des véhicules blindés et des avions à la Russie, bien que Gilang Kembara, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales, ait déclaré que cette relation commerciale était "relativement stagnante" à l'heure actuelle en raison de l'attention accrue portée aux États-Unis comme source d'armes. "Pourtant, il existe un sentiment de nostalgie historique pour les Indonésiens à l'égard de la Russie", a-t-il déclaré. "Dans l'esprit du passé, Jokowi voudra aider". Le gouvernement indonésien a également indiqué que M. Widodo discuterait des exportations en provenance de Russie et d'Ukraine dans le cadre de son voyage. Le ministre indonésien des affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré dimanche qu'"il est nécessaire de sécuriser un corridor céréalier en provenance d'Ukraine et d'ouvrir les exportations de nourriture et d'engrais en provenance de Russie. M. Sulaiman a déclaré qu'il ne pensait pas que la visite de Jokowi à Moscou provoquerait une hostilité soudaine entre l'Australie et l'Indonésie. Les relations entre les deux pays ont récemment été renouvelées lorsque Anthony Albanese a fait de l'Indonésie sa première visite à l'étranger en tant que Premier ministre australien. "Cela confirme plutôt l'intention de M. Albanese de courtiser l'Indonésie et son analyse que l'Australie a négligé l'Indonésie pendant bien trop longtemps", a déclaré M. Sulaiman. https://www.aspistrategist.org.au/widodos-mission-to-moscow-seeking-peace-and-an-end-to-putins-blockade-of-ukraines-wheat/ (29 juin 2022) Widodo lui-même semblait invoquer l'esprit (sinon le nom) de Hatta en expliquant le but de sa mission avant son départ pour l'Europe. Je vais me rendre en Ukraine", a-t-il déclaré, dans le but d'inviter "le président ukrainien, le président [Volodymyr] Zelensky, à ouvrir des possibilités de dialogue dans un contexte de paix". Il entendait atteindre le même objectif lors de son voyage à Moscou. Il répliquera son ouverture à Zelensky en invitant également Poutine à ouvrir un dialogue avec son homologue ukrainien et "dès que possible ... faire une trêve et arrêter la guerre". M. Widodo était manifestement tout aussi déterminé à rappeler aux pays du G7 la nécessité de la paix. Nous encouragerons et inviterons les pays du G7 à travailler ensemble pour négocier la paix en Ukraine", a-t-il déclaré, "et aussi pour trouver une solution urgente à la crise alimentaire et énergétique qui engloutit le monde". M. Zelensky a probablement du mal à voir l'intérêt de la visite de son homologue indonésien, du moins en ce qui concerne les intérêts de l'Ukraine. Widodo représente, après tout, un pays qui a résisté à l'imposition de sanctions à l'encontre de l'agresseur de l'Ukraine et dont les commentaires du grand public, comme l'aurait rapporté l'ambassade d'Ukraine à Jakarta, ont eu tendance à avaler le mensonge russe selon lequel la cause principale de la guerre était la prétendue provocation de l'Ukraine et de l'OTAN. Les commentaires du chancelier allemand Olaf Scholz et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au G7 suggèrent qu'un boycott européen du sommet du G20 à Bali en réponse à la présence de Poutine semble moins probable qu'auparavant. Scholz a insisté, par exemple, sur le fait que l'Allemagne ne veut pas "torpiller" le G20. Mais M. Widodo serait désireux d'éliminer tout risque de torpillage en renforçant le compromis initialement présenté par le président américain Joe Biden et maintenant avancé par M. Widodo lui-même, à savoir la participation de M. Zelensky au sommet en tant qu'invité spécial. Cette réinvitation sera vraisemblablement le premier point de discussion de Widodo lors de la réunion de Kiev. Toutefois, l'objectif premier de M. Widodo à Moscou sera probablement de mettre un terme au blocus effectif des exportations de céréales de l'Ukraine par la Russie, ce qu'il a présenté dans un moule non aligné comme une mesure qui contribuerait à atténuer les difficultés que connaissent de nombreuses personnes dans les pays en développement en raison de la guerre. Aucun pays n'en profiterait davantage que son propre pays. L'Indonésie est le plus grand importateur de blé au monde (en valeur monétaire) et 25 % de ses importations provenaient d'Ukraine en 2021. L'Ukraine était le premier fournisseur de blé de l'Indonésie en 2020. Cette céréale est utilisée pour fabriquer des nouilles, qui sont devenues un aliment de base populaire et relativement bon marché pour des millions d'Indonésiens. Mais les pénuries de blé et de farine de blé ont nui aux consommateurs comme aux producteurs, réduisant considérablement la production de denrées alimentaires à base de blé et provoquant une inflation des prix. L'administration de M. Widodo a dû faire face à de nombreuses protestations à la suite d'une flambée similaire des prix de l'huile de cuisson dans le monde, résultant de pénuries de cette denrée liées à la guerre, ce qui a entraîné une interdiction momentanée des exportations d'huile de palme indonésienne, et récemment, le limogeage du ministre indonésien du commerce. Des manifestations de rue pour protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires sont probablement la dernière chose que Widodo souhaite alors qu'il attend avec impatience l'arrivée de ses invités au G20 à Bali. Mais en se rendant à la fois dans la capitale de la source de ces importations et dans le repaire de la personne qui les bloque, il peut au moins dire à ses citoyens qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour alléger leur fardeau. - -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Il semblerait que la référence soit cette affaire datant de mars, au lendemain du déclenchement de l'offensive russe : https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/13/white-house-us-joe-biden-oil-output-prices-saudi-arabia-uae (13 mars 2022) Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, et son homologue des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, doivent encore accepter un appel téléphonique avec l'homme le plus puissant de l'Occident - un scénario pratiquement impensable sous les administrations précédentes. La priorité immédiate de M. Biden est que les deux pays contribuent à exercer une pression économique maximale sur la Russie en augmentant leur production de pétrole. Chaque capitale est un fournisseur majeur de pétrole, avec une capacité excédentaire, ce qui atténuerait l'effet sur les consommateurs américains par le biais des prix des carburants avant les élections de mi-mandat en novembre qui menacent le contrôle démocrate du Congrès. Cependant, l'impasse va bien au-delà du pétrole. À Riyad, le prince Mohammed se sent rabroué par le refus de M. Biden de dialoguer avec lui depuis son entrée en fonction. Le meurtre du dissident saoudien Jamal Khashoggi par les assistants de sécurité du prince héritier, la guerre au Yémen, l'emprisonnement de militants des droits de l'homme et le boycott du Qatar ont fait de lui un paria pour l'administration. Les différends avec Abu Dhabi sont presque aussi graves. Les États-Unis ont été particulièrement décontenancés par les abstentions répétées des Émirats arabes unis au Conseil de sécurité des Nations unies, qui ont été considérées par les diplomates occidentaux à New York comme une contrepartie du soutien russe à certaines des positions anti-Houthi qu'ils souhaitaient voir adopter par le Conseil dans la guerre au Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été outrés par le fait que l'administration Biden ait retiré les Houthis, soutenus par l'Iran, de la liste des organisations terroristes mondiales, alors qu'ils poursuivent une série de négociations laborieuses avec l'Iran pour relancer l'accord nucléaire de l'ère Obama déchiré par Donald Trump. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Émirats, élargissement de l'OTAN : https://nationalinterest.org/feature/america-world-limits-203217 (27 juin 2022) De nombreux pays ont refusé de se joindre au régime de sanctions imposé à la Russie par les États-Unis et l'Europe en réponse à son invasion de l'Ukraine. Ces nations veulent clairement éviter de prendre des risques dans un monde où la domination américaine est moins certaine. Cela concerne même des pays qui ont bénéficié du parapluie de sécurité américain. Prenez les Émirats arabes unis par exemple, qui ont permis aux oligarques russes d'échapper aux sanctions ciblées sur leurs actifs. Le prince héritier émirati a doublé ce mauvais comportement lorsqu'il a refusé un appel du président Joe Biden pour discuter de la détresse du marché de l'énergie. Les États-Unis ne devraient pas tolérer une élite délirante en matière de politique étrangère qui ignore les contraintes réelles de la puissance américaine. Au contraire, nos dirigeants devraient adopter une approche sobre et réaliste de l'état actuel du monde, qui reconnaisse nos limites afin que l'Amérique puisse rester sûre et prospère. En Europe de l'Est, les États-Unis doivent faire comprendre à nos riches partenaires européens qu'ils sont les premiers responsables de la sécurité de leur propre continent. Les échecs de la Russie en Ukraine ont révélé que ses forces armées conventionnelles ne sont pas une menace pour les armées européennes bien financées et bien entraînées - même sans un soutien américain significatif. Une armée russe qui ne peut pas prendre Kharkiv ne peut certainement pas prendre Varsovie, Berlin ou Paris. Par conséquent, les États-Unis devraient encourager le renforcement et le développement d'architectures de sécurité non OTAN en Europe, comme la politique de défense et de sécurité commune de l'Union européenne. Pour faciliter efficacement cette évolution, les États-Unis doivent éviter de prendre des mesures qui encouragent le parasitisme sous le parapluie de la sécurité américaine. Il s'agit notamment de politiques à courte vue telles que des déploiements plus permanents de troupes américaines en Europe ou l'élargissement de l'OTAN à des pays comme la Finlande et la Suède. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Si c'est le cas, c'est vraiment une perversion du G7 qui au départ était un juste un moment de détente sans la presse, pour leur permettre de se parler en toute franchise, principalement sur les question économiques. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_sept_(économie) Puis, avec l'ajout de l'Italie lors d'un premier sommet au château de Rambouillet, du 15 au 17 novembre 1975 sur l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing, le G6 est créé. Les six chefs d'État fondateurs du groupe s'engagent alors à se réunir annuellement, avec une présidence tournante, afin de traiter les questions économiques et financières de façon informelle. -

Vers l'indépendance de l'écosse et la fin du Royaume Uni ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://news.sky.com/story/nicola-sturgeon-sets-a-date-for-a-proposed-scottish-independence-referendum-12641957 (28 juin 2022) Nicola Sturgeon a fixé la date d'un "référendum consultatif" proposé l'année prochaine sur l'indépendance de l'Écosse. Sous les acclamations et les applaudissements du parlement dévolu à Holyrood, la première ministre a déclaré que la législation établirait des plans pour un vote qui aurait lieu le 19 octobre 2023. La question sera posée : "L'Écosse doit-elle être un pays indépendant ?" Mme Sturgeon a reconnu que son plan pourrait se heurter à des blocages juridiques ou à la résistance du gouvernement britannique - et a menacé que si tel était le cas, son parti, le SNP, se présenterait aux prochaines élections générales comme un "référendum de facto".