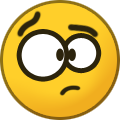-
Compteur de contenus
25 527 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Le point Pearl Harbor/Hiro Hito, encore : https://nationalinterest.org/feature/raging-toward-abyss-russia-201144 (11 mars 2022) George Beebe : Nous sommes dans une spirale d'escalade qui s'intensifie avec une puissance nucléaire amèrement lésée qui, sous la pression d'une campagne militaire qui piétine et de sanctions économiques asphyxiantes, pourrait bientôt être confrontée à un choix entre accepter une humiliation nationale et faire quelque chose que nous avons longtemps considéré comme inimaginable : attaquer directement un membre de l'OTAN ou même les États-Unis. Les dirigeants soviétiques n'ont jamais été confrontés à un tel dilemme. Contrairement au mythe populaire, Kennedy n'a pas simplement forcé Khrouchtchev à faire marche arrière en 1962 en le menaçant de la perspective d'attaques militaires américaines contre les installations de missiles soviétiques à Cuba. Il a associé cette menace à la volonté de conclure un accord pour sauver la face. Les deux dirigeants ont mis fin à la crise en échangeant le retrait de ces missiles soviétiques contre le retrait des missiles américains à moyenne portée en Turquie et en Italie, assorti de l'engagement des États-Unis de ne jamais envahir Cuba. Nous n'avons pas de tels accords aujourd'hui. Presque tous les accords de contrôle des armements et de gestion des crises de l'époque de la guerre froide ont disparu, et aucun nouvel accord adapté aux nouvelles conditions actuelles n'a vu le jour. Farida Rustamova, correspondante de la BBC à Moscou, a rapporté que Vladimir Poutine pense que l'Occident a détruit toutes les anciennes règles du jeu et que la Russie est désormais engagée dans un combat qui n'est circonscrit par aucune frontière convenue. La récente directive de Poutine plaçant les forces nucléaires stratégiques de la Russie sous un "régime spécial de service de combat" suggère qu'elle a raison. Le centre de gravité des médias et de l'opinion publique occidentaux s'est considérablement déplacé depuis la guerre froide. Depuis au moins une décennie, il n'existe pas de groupe d'intérêt américain significatif en faveur d'une quelconque détente avec Moscou. Peu de gens considèrent la guerre nucléaire avec la Russie comme une possibilité sérieuse, et presque tous semblent supposer que les États-Unis ne peuvent pas être entraînés dans une guerre directe avec la Russie contre son gré. Indignés à juste titre par l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, nos commentateurs médiatiques et nos guerriers sur Twitter se concentrent sur la manière de garantir la défaite de la Russie et l'éviction de Poutine. Mais l'avènement de l'ère cybernétique a rendu les risques d'escalade vers un conflit direct Est-Ouest beaucoup plus grands que pendant la guerre froide, tout en ne faisant pas grand-chose pour réduire son potentiel de destruction. Notre dépendance à l'égard d'une infrastructure numérique pratiquement sans défense rend les États-Unis beaucoup plus vulnérables aux attaques étrangères qu'il y a seulement quelques décennies. Poutine a publiquement averti que les sanctions économiques occidentales constituaient une guerre contre la Russie. Comment pourrions-nous réagir si les cybercombattants russes ripostaient en désactivant les centrales électriques américaines ou en perturbant les transactions à Wall Street ? Une fois que les deux parties auront commencé à attaquer les infrastructures critiques, pourraient-elles être tentées de cibler les satellites militaires et de renseignement dont dépend la capacité de chaque partie à détecter les frappes nucléaires et à y répondre ? Nous ne pouvons pas savoir comment ces facteurs disparates peuvent se combiner pour façonner les événements des prochaines semaines. Mais il est juste de dire que nous nous aventurons sur terra incognita, et non dans une sorte de relecture étrangement rassurante d'une compétition réglementée de la guerre froide qui s'est terminée de manière heureuse, du moins pour les États-Unis et leurs alliés. Les dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas ingérables, mais ils sont certainement sans précédent. Au moins un dicton de la guerre froide conserve sa pertinence dans ces nouvelles circonstances : les dirigeants des superpuissances ne doivent pas se mettre mutuellement dans des situations où ils doivent choisir entre perdre la face et déclencher une guerre nucléaire, ce qui, selon Kennedy, était la principale leçon de la crise des missiles de Cuba. Que pouvons-nous faire - et que devons-nous éviter de faire - pour ne pas nous acculer, nous ou le Kremlin, dans une telle situation ? La récente décision de Washington d'activer les canaux de déconfliction militaire avec la Russie était judicieuse, tout comme le choix de l'OTAN de ne pas instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, qui aurait nécessité un engagement direct avec les avions et les défenses aériennes russes. Nous devons toutefois veiller à ne pas laisser notre objectif glisser de la dissuasion et de la punition de la Russie vers un changement de régime, ce qui serait plus susceptible de provoquer des représailles de la part de Poutine que sa destitution. Les États-Unis doivent également résister à la tentation de couper les contacts diplomatiques avec Moscou. Nous pouvons et devons veiller à ce que la Russie ne gagne pas cette guerre. Mais nous devons reconnaître que Poutine peut faire souffrir tous les autres de manière horrible si la Russie doit perdre. La diplomatie est notre seul moyen de sortir de cette impasse. Pour encourager les Russes à mettre fin aux combats, nous devons faire face à la douloureuse réalité : ils ont besoin d'une voie viable vers un avenir dans lequel les sanctions sont allégées et l'OTAN n'est pas en Ukraine, tout en préservant la sécurité de l'Ukraine. Dans notre indignation face à l'assaut sanglant de la Russie, très peu d'Occidentaux pensent que nous devrions chercher des moyens de mettre fin au conflit sans la capitulation du Kremlin. Mais si nous ne le faisons pas, il est peu probable que nous nous retrouvions dans une nouvelle guerre froide. Nous pourrions au contraire nous retrouver dans une guerre très chaude. -

Finlande
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lefigaro.fr/societes/le-reacteur-nucleaire-epr-finlandais-olkiluoto-3-mis-en-service-avec-12-ans-de-retard-20220312 Le réacteur nucléaire finlandais EPR d'Olkiluoto-3 a été mis en service pour la première fois samedi, a annoncé l'exploitant de la centrale. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
D'où la stupidité des Américains d'offrir sur un plateau des "opportunités fantastiques" à la Chine. Comme disait Schönbach. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Dans la théorie réaliste des relations internationales, le monde n'est qu'une vaste cour de récréation. https://fr.wikipedia.org/wiki/Réalisme_(relations_internationales) Le système international est par définition anarchique et dans un état naturel de guerre : en l'absence de gouvernement supérieur aux États, ceux-ci sont autonomes et indépendants, ils entrent en conflit. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Schönbach a aussi dit que Poutine voulait du respect. Donc il n'a peut-être pas envahi l'Ukraine pour envahir l'Ukraine mais pour montrer ce qu'il en coûte quand on lui manque de respect. -

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.fnn.jp/articles/-/329771 (11 mars 2022) Selon l'agence de presse Interfax, la Russie a annoncé le 10 janvier qu'elle avait effectué un exercice de lancement de missiles sol-air dans les îles Kouriles, qui font référence aux Territoires du Nord et aux îles Chishima. On pense qu'elle vise à faire pression sur le Japon, qui s'est joint aux sanctions pour l'invasion de l'Ukraine. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Le média de service public allemand met gentiment en garde contre la propagande ukrainienne (et russe, mais cela va sans dire) : https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-krieg-propaganda-101.html Politique d'information de l'Ukraine Sympathique, mais souvent imprécise Mise à jour : 09.03.2022 17:29 Dans la lutte pour la souveraineté en matière d'information et d'opinion, l'Ukraine est en bonne position avec le sympathique Selenskyj comme président. Mais les déclarations hâtives et imprécises mettent également les alliés en difficulté. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-mariupol-nach-angaben-russlands-blockiert-a-e0b75e05-ade5-49c0-a25e-d064ac9b9d55 (11 mars 2022) A 50 kilomètres au nord de Marioupol, les séparatistes prorusses ont pris le contrôle de la ville de Volnovakha, a déclaré le ministère russe de la Défense. -

République démocratique du Congo
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Mani dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.dw.com/fr/monusco-retrait-du-contingent-ukrainien-casques-bleus-ukraine-ituri-onu-nord-kivu-violences/a-61075849 (10 mars 2022) Dans l'est de la RDC, le départ des Casques bleus ukrainiens est un non-évènement Pour John Kambale, rapporteur général de la société civile de Beni, ce retrait est même un non-événement. Toutes ces forces, dit-il, sont inutiles : "Inutiles parce que nous sommes tués devant leurs positions, nous sommes tués devant leur campements, nous sommes égorgés, écrasés comme des vermines devant leurs yeux. Ils sont observateurs de notre mort. Alors nous sommes en train de souhaiter bon voyage au contingent ukrainien. Nous attendons le départ des autres." Constituée d'environ 20.000 hommes, la Monusco demeure la plus importante et la plus coûteuse des missions de maintien de la paix de l'ONU au monde. -

Hongrie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
http://french.news.cn/europe/2022-03/08/c_1310504621.htm Avec l'achèvement de la numérisation dans l'usine du Centre d'approvisionnement européen (ESC) de Huawei à Paty, à 20 km à l'ouest de la capitale Budapest, la Hongrie se rapproche de l'avant-garde des avancées technologiques 5G. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.tvanouvelles.ca/2022/03/10/jean-charest-livre-un-plaidoyer-pour-lunite-du-parti-conservateur-en-alberta Dans la capitale pétrolière du pays, M. Charest a vanté ses contacts dans l’industrie, sa connaissance de la région, en mettant l’accent sur sa volonté de construire des pipelines et en soulignant au passage un «événement qui change tout» : la guerre en Ukraine, qui doit permettre au Canada de mieux se positionner dans le monde et de fournir l’Europe en pétrole. Sauf que la politique en question ressemble plus au traité de Brest-Litovsk (création d'une Ukraine indépendante alliée de l'Allemagne aux dépens de la Russie, lourdes pénalité financières imposées à la Russie). -

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/03/10/afghanistan-even-worse-ukraine-war-denounced-russian-state/ La télévision d'État russe a diffusé des appels à Vladimir Poutine, le président du pays, pour qu'il mette fin à sa guerre en Ukraine, au cours d'un programme dans lequel des experts ont ouvertement comparé l'invasion à "l'Afghanistan, mais en pire". Vladimir Soloviyev, habituellement l'un des propagandistes en chef les plus fiables du Kremlin, a dû interrompre les invités de son talk-show télévisé à une heure de grande écoute pour qu'ils cessent de critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. S'exprimant au cours d'une émission diffusée sur Russia 1, Karen Shakhnazarov, cinéaste et homme d'État, a déclaré que le conflit en Ukraine risquait d'isoler la Russie. Il a déclaré à M. Soloviyev : "J'ai du mal à imaginer la prise de villes telles que Kiev. Je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblerait". Il a ensuite appelé à mettre un terme au conflit, en déclarant : "Si ce tableau commence à se transformer en une catastrophe humanitaire absolue, même nos proches alliés comme la Chine et l'Inde seront contraints de prendre leurs distances avec nous3. "Cette opinion publique, dont ils saturent le monde entier, peut nous porter préjudice ... Mettre fin à cette opération stabilisera les choses à l'intérieur du pays." Plus tard, lors de la diffusion d'Une soirée avec Vladimir Soloviev, l'un des programmes les plus regardés de la télévision russe, l'invité Semyon Bagdasarov, un universitaire, a déclaré : "Avons-nous besoin de nous engager dans un autre Afghanistan, mais encore pire ?" Sur la chaîne de télévision du ministère russe de la défense, Zvezda, un officier de l'armée en activité a expliqué à un public de talk-show comment les soldats russes mouraient en Ukraine. "Nos gars là-bas, de Donetsk et de Louhansk, et nos forces d'opérations spéciales sont en train de mourir, ainsi que notre pays", a-t-il déclaré. "Non, non, non", interrompt le présentateur qui se lève de son bureau en gesticulant et marche à travers le studio en criant : "Stop !" "Nos jeunes continuent de mourir", poursuit le soldat. À ce moment-là, le présentateur s'était approché de lui et avait crié : "Pouvez-vous arrêter maintenant ? Je vais vous dire ce que nos gars font là-bas. Nos gars écrasent les serpents fascistes. C'est un triomphe de l'armée russe. C'est la renaissance de la Russie." -

Chine - Inde : Relations bilatérales
Wallaby a répondu à un(e) sujet de leclercs dans Politique etrangère / Relations internationales
Je ne savais pas que l'Inde s'opposait "vigoureusement" à la nouvelle route de la soie. Elle a rompu les relations diplomatiques avec l'Italie ? L'expression "choix de Hobson" est inusitée en français. Je propose de traduire : "pris entre le marteau et l'enclume". Je rends les armes devant tant de sigles OTAIP, BITD, incompréhensibles. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est à partir de la bataille de Moscou (janvier 1942) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Moscou Croyant en son infaillibilité, Hitler va donc de plus en plus prendre en charge personnellement la poursuite des opérations en repoussant les conseils de ses officiers, ce qui ne fera que dégrader une situation déjà précaire. Comme l'écrivit Guderian : « Cela jeta un froid dans nos relations, un froid qui ne se dissiperait jamais plus. » -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.rnd.de/politik/russlands-krieg-in-ukraine-scholz-gegen-schnellen-eu-beitritt-der-ukraine-5IKF2OJLJQHOP562CCXQVPQWFM.html (10 mars 2022) Le chancelier allemand Olaf Scholz continue de rejeter une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte avait lui aussi déjà rejeté une procédure d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lesoir.be/428682/article/2022-03-08/coronavirus-le-nombre-de-nouveaux-cas-aux-pays-bas-augmente-rapidement Le nombre de nouveaux cas de coronavirus aux Pays-Bas augmente rapidement après des semaines de chiffres en baisse. Cette augmentation fait suite à l’assouplissement des règles de coronavirus dans le secteur de la restauration, qui a coïncidé avec l’organisation du carnaval. Le nombre de tests positifs est en augmentation, surtout dans les régions où le carnaval a été célébré. https://www.france24.com/fr/france/20220310-covid-19-la-fin-des-restrictions-sanitaires-arrive-t-elle-trop-tôt-en-france Selon les données publiées mercredi 9 mars par Santé publique France, le pays a enregistré en 24 heures 69 190 nouveaux cas, soit une hausse de 20 % par rapport à mercredi dernier. -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
30 octobre 2021. Aquilino Morelle, énarque, ancien conseiller de Lionel Jospin et de François Hollande, publie le livre : "L’Opium des élites : Comment on a défait la France sans faire l’Europe" 01:02:43 On vous dit : soit vous êtes fédéraliste, c'est à dire que vous consentez à ce qui se passe aujourd'hui sans barguigner, ou alors vous êtes un partisan de la sortie de l'Union, et donc un destructeur. Mais non ! Les gens comme moi qui avons travaillé pour écrire ce livre, et tant d'autres, ce que nous voulons, c'est pouvoir parler en adultes et de manière politique de l'Europe. Car l'Europe est un sujet politique majeur pour la nation France, et nous ne pouvons pas le laisser aux fonctionnaires de la commission ou aux députés européens ou aux journalistes qui défendent une vision univoque de la construction européenne. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Ce qui est donc moins grave que le bilan du bombardement de l'hôpital de Kunduz en 2015 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_du_centre_de_soins_de_MSF_à_Kondôz Le bilan humain s’élève à 30 morts, dont 13 personnels MSF et 10 patients, parmi lesquels trois enfants. Sept corps méconnaissables ont été retrouvés dans les ruines et n’ont pas pu être identifiés. Et qui avait mérité des sanctions extrêmement sévères contre les responsables : MSF a demandé une enquête internationale indépendante, et a ouvert une pétition adressant cette demande au Président des États-Unis Barack Obama. Donc de la même façon, il faut pour Marioupol exiger une enquête internationale indépendante et lancer une pétition contre le président de la Russie Vladimir Poutine. -
-
-

Corée du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20220310001900884?section=national/index Le candidat de la principale formation d'opposition Yoon Suk-yeol a été élu ce jeudi nouveau président de la Corée du Sud. Yoon adopte une ligne dure en matière de sécurité nationale, affirmant qu'une frappe préventive pourrait être nécessaire pour répondre à une menace imminente de la Corée du Nord. Il s'est également engagé à déployer des unités supplémentaires du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud afin de dissuader toute agression nord-coréenne. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/09/les-services-de-renseignement-attentifs-au-depart-de-volontaires-francais-pour-l-ukraine_6116733_3210.html Selon la DGSI, entre 60 et 70 personnes, issues en majorité de l’ultradroite, seraient déterminées à rallier les rangs de l’armée ukrainienne. « Ils suscitent tout particulièrement notre attention, avance une source des services de renseignement, compte tenu de l’engagement dans le conflit du bataillon Azov, qui semble exercer une certaine fascination sur une frange de l’ultradroite française. » -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est une question de forme. Le problème de fond, au-delà de la forme, c'est de savoir si la confiance règne, ou si la relation est constructive ou destructive. -

Venezuela
Wallaby a répondu à un(e) sujet de tharassboulbah dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-les-etats-unis-se-rapprochent-du-venezuela-apres-l-embargo-sur-petrole-russe-3fa26f82-f667-442a-9394-9d91428cd140 (9 mars 2022) Samedi, des responsables américains ont rencontré le président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas pour des entretiens bilatéraux, les premiers depuis des années. Après cette visite surprise, deux Américains, (...) ont été libérés de prison mardi 8 mars. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/krieg-in-der-ukraine-gefaehrdet-deutschen-it-mittelstand-17852235.html (9 mars 2022) Jusqu'à présent, la guerre en Ukraine a surtout préoccupé l'économie allemande dans une perspective de production : les entreprises allemandes qui y exploitent des usines ou qui s'y approvisionnent sont soudainement coupées de leur production. En milieu de semaine, Volkswagen et BMW ont fait savoir qu'ils devaient arrêter la production de voitures dans plusieurs usines en raison du manque de pièces de sous-traitance en provenance d'Ukraine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'Allemagne dépend également de la main-d'œuvre qualifiée d'Ukraine et de Biélorussie, notamment dans le secteur informatique. En effet, c'est là que se trouvent de nombreux développeurs qui programment des logiciels pour les PME allemandes. "Ces dernières années, la main-d'œuvre qualifiée de Biélorussie et d'Ukraine a été un facteur de réussite essentiel pour le développement des entreprises allemandes de logiciels", explique Deutscher. Son entreprise, qui emploie 120 personnes, développe des logiciels permettant de facturer automatiquement des modèles commerciaux d'abonnement numérique, par exemple pour les entreprises de médias. "Si nous n'avions dû compter que sur des développeurs allemands, nous ne serions jamais allés aussi loin. Il n'y en a pratiquement pas". Selon l'agence de recrutement néerlandaise Daxx, spécialisée dans l'externalisation du développement de logiciels en Europe de l'Est, l'Ukraine compte environ 200.000 développeurs. Cela fait de ce pays le deuxième plus grand réservoir de main-d'œuvre qualifiée en Europe de l'Est dans le secteur informatique, après la Russie. La situation est similaire en Biélorussie, où Billwerk employait de nombreux développeurs. Au départ, le site de l'entreprise à Minsk était plus grand que le siège social à Francfort. "Il faut savoir qu'il y a un très bon secteur informatique à Minsk, qui s'est développé au fil des ans", explique Deutscher. Le système de formation autour de la numérisation y est en partie mieux établi qu'en Allemagne, avec en même temps des salaires nettement plus bas. Une étude réalisée en 2005 par l'association numérique Bitkom a conclu que les coûts salariaux en Biélorussie et en Ukraine ne représentaient alors que 11% des coûts en Allemagne. Grâce aux possibilités de collaboration numérique, les programmeurs ont pu travailler depuis la Biélorussie sans devoir déménager. Le gouvernement a encouragé le recrutement par des entreprises de logiciels occidentales en leur accordant des avantages fiscaux. Les développeurs travaillaient volontiers pour des entreprises allemandes, car leurs salaires restaient nettement supérieurs à la moyenne locale. "Travailler comme programmeur pour des entreprises occidentales est l'une des rares possibilités de gagner un salaire de pointe en Biélorussie et en Ukraine", explique Deutscher. Ce soi-disant "nearshoring" a longtemps été une bonne affaire pour les deux parties. Jusqu'à ce que le régime du dirigeant Alexandr Lukaschenko devienne de plus en plus répressif. Après les élections truquées de l'été 2020, qui ont entraîné des manifestations de masse et une grève générale, de nombreux spécialistes ont quitté le pays. Recruter de nouveaux développeurs est donc devenu impossible, rapporte Deutscher. Billwerk a donc créé un nouveau site à Gdansk, en Pologne, et s'est concentré sur la relocalisation de ses collaborateurs. Nombre d'entre eux ont accepté l'offre : sur les 20 collaborateurs de Billwerk en Biélorussie et un en Ukraine, seuls dix sont restés à Minsk. Nombre d'entre eux venaient de construire une maison ou devaient subvenir aux besoins de leur famille. Comme Billwerk a commencé très tôt à faire venir ses collaborateurs de la zone de crise, l'entreprise est aujourd'hui mieux placée que nombre de ses collègues du secteur. De grandes entreprises comme Mercedes et de nombreux groupes américains emploient également des programmeurs en Biélorussie ou en Ukraine. Interrogée à ce sujet, l'association informatique Bitkom affirme que toutes les entreprises tentent d'abord d'entrer en contact avec des collaborateurs sur place, puis de les faire sortir du pays dans la mesure du possible. Dans un premier temps, de nombreux développeurs ne peuvent plus continuer à programmer. Des retards dans les projets en cours en sont la conséquence. Certains collaborateurs ont été mis à pied, explique une porte-parole de Bitkom. Pour Billwerk, il n'en est pas question. L'entreprise soutient ses collaborateurs biélorusses, souligne Deutscher. Mais on craint fortement de ne plus pouvoir les aider à partir d'un certain point. Billwerk craint que dans le cadre des sanctions après la Russie, la Biélorussie soit également déconnectée du système de paiement Swift. A cela s'ajoute une inquiétude personnelle pour les collaborateurs : "La situation est actuellement tendue, car nous ne savons pas combien de temps les Biélorusses pourront encore quitter le pays - surtout les hommes, s'ils sont appelés en Biélorussie", explique Deutscher. De nombreux développeurs auraient moins de 30 ans et seraient donc attractifs pour l'armée. Afin d'anticiper une exclusion de Swift, Billwerk vient de verser un montant important en euros à sa filiale de Minsk. Cet argent pourrait servir à payer les salaires des employés restants pendant environ huit mois, explique le directeur financier Leigh Hooper. "Si la crise n'est pas terminée et que la Biélorussie est déconnectée du système Swift, c'est fini. Nous ne pourrons alors plus continuer à payer nos employés". -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://news.sky.com/story/ukraine-war-briton-who-volunteered-to-join-fight-against-russia-turned-down-and-told-he-would-be-a-liability-12560778 (9 mars 2022) M. Dawson était l'un des nombreux volontaires qui ont parlé à Sky News devant l'ambassade d'Ukraine la semaine dernière, après que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss ait déclaré qu'elle soutiendrait "absolument" les ressortissants britanniques qui choisiraient d'aller aider à lutter contre l'invasion russe. Le ministre de la défense, Ben Wallace, a ensuite contredit Mme Truss en exhortant les Britanniques à ne pas se rendre en Ukraine pour participer aux combats, affirmant que la situation "très dangereuse" pouvait les conduire à être tués. Les Britanniques seront-ils poursuivis s'ils se rendent en Ukraine pour combattre les troupes russes ? Le ministère des Affaires étrangères a déclaré aux Britanniques : "Si vous vous rendez en Ukraine pour combattre, ou pour aider d'autres personnes engagées dans le conflit, vos activités peuvent constituer des infractions à la législation britannique et vous pourriez être poursuivi à votre retour au Royaume-Uni." La loi sur l'enrôlement à l'étranger de 1870 interdit aux Britanniques de combattre dans le "service militaire ou naval de tout État étranger" qui est en guerre avec un pays avec lequel le Royaume-Uni est "en paix". Depuis le 11 février, le Foreign Office a déconseillé aux Britanniques de se rendre dans toute l'Ukraine et a exhorté les ressortissants britanniques à quitter ce pays déchiré par la guerre. L'armée britannique a déclaré qu'il était interdit à tous les militaires de se rendre en Ukraine. La Metropolitan Police aurait averti ses agents qu'ils s'exposeraient à des mesures disciplinaires s'ils se rendaient en Ukraine pour aider à combattre l'armée russe. Des questions ont été soulevées quant à la légalité du départ de Britanniques pour combattre dans des conflits étrangers antérieurs. En 2014, le Crown Prosecution Service a averti que les ressortissants britanniques qui partaient combattre dans la guerre civile syrienne pouvaient commettre une infraction, même s'ils rejoignaient les rebelles qui luttaient pour renverser le président Bachar Assad.