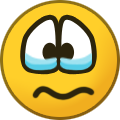-
Compteur de contenus
1 844 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
14
Tout ce qui a été posté par Manuel77
-
Laisse-moi compléter : …otherwise, you‘ll get whacked. Maintenant, c'est logique et compréhensible.
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Vous n'avez pas besoin d'analyser toutes ces déclarations de Merz, le FCAS et les armes nucléaires avec autant de précision que les dix commandements. Il dit ces choses dans des interviews, mais il a la fâcheuse tendance à en dire trop à la fois et à devoir ensuite faire marche arrière. Tout le contraire de Scholz, qui ne disait rien dans ses interviews. Idem Merkel. D'ailleurs, dans la même interview, il a également déclaré que l'Allemagne n'aurait peut-être pas besoin d'avion piloté. Cela ne serait pertinent que s'il s'agissait d'une déclaration gouvernementale ou d'un discours sur ce sujet spécifique. -
Merz dit n'importe quoi. Il y a quelques heures, il a déclaré que l'Allemagne ne cherchait pas à se doter de ses propres armes nucléaires, mais que des armes nucléaires françaises pourraient éventuellement être transportées par des avions allemands. Il veut repousser les divergences « conceptuelles » à l'année 2017, à l'ère Merkel, et ne pas aborder le fait que Macron et lui-même ne peuvent pas forcer la main aux industriels concernés. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-02/atomwaffen-friedrich-merz-verteidigung-frankreich-grossbritannien
-
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Il est vrai que lors de la conférence de Munich, le ministre des Affaires étrangères Wadephul a joué le rôle de transatlantique et de sceptique vis-à-vis de la souveraineté européenne. Il s'agit d'ailleurs d'un renversement des rôles. Normalement, c'est ainsi : 1. La chancellerie fédérale est composée de réalistes, favorables à la coopération avec les États-Unis. Accords douteux. Éthique de la responsabilité. 2. Le ministère des Affaires étrangères est composé d'idéalistes et de spécialistes du droit international, qui veulent que justice soit faite, même si le monde s'écroule. Éthique de conviction. Wadephul (CDU) joue désormais le rôle du réaliste, ce qui fait de lui un chef sans Indiens dans son ministère. Les collaborateurs qui y travaillent sont influencés par des chefs rouges et verts. Pourquoi ce changement de rôles a-t-il eu lieu ? Normalement, Merz, en tant que chancelier, devrait être le réaliste et le transatlantique ! Mais Trump et ses gangsters sont tellement détestés par 80 % des Allemands que tout mot amical à leur égard peut être préjudiciable lors des élections. Mais comme je l'ai déjà écrit ailleurs, c'est Friedrich Merz qui a prononcé le discours programmatique lors de la conférence sur la sécurité, et celui-ci doit être analysé. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-kanzler-msc-2407218 Il a également rencontré Gavin Newsom, ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement américain. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Comme cette affaire a suscité un tollé diplomatique, j'ai écouté l'enregistrement original de l'interview du ministre. Il ne s'agissait pas d'une attaque planifiée contre la France. Le journaliste l'a acculé en lui demandant pourquoi le gouvernement Merz était contre les euro-obligations pour la defence (Urgence ! La guerre approche !). Après tout, Armin Laschet (CDU, presque chancelier fédéral, francophile) et le président de la Banque fédérale allemande Nagel (chose inhabituelle !) y sont également favorables. Le ton donnait à penser que Macron était le plus grand patriote européen et que le gouvernement allemand, à l'esprit étroit, était composé de provinciaux avares. Le journaliste était un peu provocateur et le ministre un peu hésitant. Acculé, Wadephul a répondu maladroitement que Macron devrait d'abord montrer comment il comptait transférer l'argent de l'État providence vers la défense. https://www.deutschlandfunk.de/msc-nachlese-mit-aussenminister-johann-wadephul-cdu-im-interview-100.html -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
De belles histoires serbes dignes d'un conte de fées sur la toute-puissante BND. Ils ont emballé vingt avions dans des boîtes d'allumettes et les ont envoyés par pigeons voyageurs. Aucune preuve. Les génies de la comptabilité du bloc de l'Est ne savaient eux-mêmes combien d'avions ils avaient produits, vendus et donnés. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Tu as bien observé. Merz veut résolument être un chancelier axé sur la politique étrangère. En Allemagne, il y a longtemps eu deux courants en matière de politique étrangère : le courant réaliste de la chancellerie et le courant idéaliste du ministère des Affaires étrangères. Les décisions importantes étaient prises à la chancellerie. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que bon nombre des problèmes de l'Allemagne sont d'origine géopolitique, c'est pourquoi Merz veut décider seul de la politique étrangère. Le ministre des Affaires étrangères Wadephul n'a absolument aucune importance. Si tu veux connaître la position « officielle » du gouvernement allemand, tu dois lire le discours de Merz à la Conférence de Munich sur la sécurité. Il a été soigneusement préparé. : https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-kanzler-msc-2407218 -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Depuis 1950, l'Allemagne de l'Ouest était le plus grand partenaire commercial de la Yougoslavie, il n'y avait aucune raison d'y étendre son influence en semant le « chaos ». L'influence était déjà maximale. Après la fin du Titostan, les bonnes gens là-bas ont fait ce qu'elles ont l'habitude de faire, elles se sont entretuées. L'industrie et l'agro-industrie yougoslaves fonctionnaient grâce à la technologie ouest-allemande et américaine, dont certaines méthodes ont été exportées vers la RDA. -
Pologne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
En Pologne, le débat sur les armes nucléaires fait rage. Le président « de droite » Nawrocki a réclamé que son pays se dote de son propre arsenal nucléaire. Tusk reste prudent. https://www.zeit.de/politik/ausland/2026-02/polen-atomwaffen-karol-nawrocki-russland-usa-nato-gxe J'ai récemment écouté un podcast avec une membre d'un groupe de réflexion polonais (Monika Sus). Il semblait que les armes nucléaires ne constituaient pas sa priorité absolue. Fort sentiment de trahison de la part des États-Unis, elle a déclaré que dans un récent sondage, seuls 15 % des Polonais faisaient confiance au président Trump en termes securite. Si je comprends bien, ils n'ont pas d'enrichissement d'uranium. Ils ont un réacteur de recherche, le premier réacteur commercial devrait être mis en service en 2036. En Allemagne, on a l'impression que la Pologne connaît un grand succès économique, mais que le ressentiment à l'égard de l'Allemagne et de la Russie ne cesse de croître. Nous ne pouvons pas expliquer de manière plausible pourquoi leur système politique est si polarisé. Peut-être ne peuvent-ils surmonter leur traumatisme historique qu'avec leurs propres armes nucléaires. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Je pense que ce n'est pas si différent de ce qu'Eribon a écrit dans « Retour à Reims ». Depuis l'ancienne RDA, l'Allemagne de l'Ouest apparaît comme Paris depuis le grand vide : hégémonique et arrogante. Après la chute du mur, les habitants de cette région ont souvent voté pour des extrémistes de gauche, et maintenant, ils votent pour des extrémistes de droite afin d'agacer « nous », les Allemands de l'Ouest. Le problème, c'est que les « extrémistes de gauche » (le SED est devenu le PDS, puis le parti Die Linke) se sont rapprochés du centre et sont devenus les piliers du système dans les Länder où ils ont intégré le gouvernement. L'AfD, quant à elle, continue de se radicaliser à droite et ne parle plus que d'apocalypse et de Ragnarök, au sens figuré. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
En Allemagne, le discours de Rubio fait l'objet d'une analyse très minutieuse. Il a d'abord été accueilli par des applaudissements (probablement parce qu'il n'a pas tiré sur le public avec un fusil de chasse comme Vance), mais les commentaires après coup sont nettement plus négatifs. Je résumerais cet article ainsi : le discours était réactionnaire et vise à revenir avant 1789. Grand journal de la gauche/ écologiste. https://archive.is/X2jRZ -
Oui, mais les relations entre les Suisses alémaniques et l'Allemagne sont également « particulières ». L'UDC souverainiste y est particulièrement forte et voit d'un mauvais œil l'influence de l'UE sous « hégémonie » allemande.
-
Laissons la parole aux Suisses neutres :https://archive.is/kmVJz#selection-419.0-459.144 Un échec grandiose : pourquoi l'Europe ne parvient pas à construire un avion de combat Le projet d'avion FCAS est sur le point d'être abandonné. Cela réjouit au moins les gaullistes en France, qui considèrent l'indépendance nationale et la puissance nucléaire comme la recette pour une nouvelle ère en Europe. L'écart entre les ambitions et la réalité, entre les grands discours sur la souveraineté de l'Europe et la réalité militaire, est d'environ 15 mètres. C'est la longueur d'un avion de combat – un Eurofighter, le Rafale français, le F-35 américain. Ou le futur avion de combat du FCAS, pièce maîtresse du Future Combat Air System, le plus grand et le plus coûteux projet d'armement européen. Il n'a pas de nom officiel, seulement un acronyme, et il est désormais tout simplement tombé à l'eau, alors que Friedrich Merz et Emmanuel Macron, à la tribune de la Conférence de Munich sur la sécurité cette semaine, affirment le contraire, évoquant l'énorme potentiel de l'Europe et sa détermination à faire face à toutes les menaces. 15 mètres, ce n'est pas beaucoup, et pourtant c'est tout un monde. Le FCAS, « Ef-kas » dans le jargon des responsables de l'armement, est apparemment mort. Les Allemands, les Français et les Espagnols ne construiront pas d'avion de combat commun. Les divergences sont insurmontables, les relations entre Airbus Defence et Dassault Aviation, avec son intransigeant directeur Éric Trappier, sont irrémédiablement rompues. Ce n'est qu'après la conférence sur la sécurité de ce week-end que Berlin, Paris et Madrid annonceront cette vérité, selon les prévisions. Cette admission est trop honteuse vis-à-vis des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie et de leurs propres populations. En pleine guerre, la plus importante en Europe depuis 1945, menacés par Vladimir Poutine, ridiculisés par Donald Trump, les Européens ne parviennent pas à construire leur propre avion de combat pour les prochaines décennies. Non pas par manque d'argent, mais parce que les dirigeants se disputent pour savoir quelle entreprise est la meilleure et doit diriger le projet. Mais aussi parce que soudain, c'est une question d'idéologie : la France contre tous les autres, le néo-gaullisme contre l'Europe du marché intérieur et les technocrates de Bruxelles. Vendredi, à Munich, le chef de l'État français avait pourtant prononcé un discours d'encouragement, un discours de motivation, comme un entraîneur qui tente de remotiver son équipe dans les vestiaires. « C'est le moment de construire une Europe forte », a déclaré Macron, « nous avons besoin d'une attitude plus positive ». Les Européens ne doivent plus se cacher, ni se recroqueviller. Le chancelier allemand a tenu des propos similaires. Tout va changer désormais, a-t-il suggéré : « Nous changeons notre façon de penser. Nous avons compris que dans l'ère des grandes puissances, notre liberté n'est pas acquise. Elle est menacée. Il faudra de la fermeté et de la volonté pour affirmer cette liberté. » Et puis, le FCAS, le « système de défense pour ce siècle », tel qu'annoncé il y a neuf ans par ses initiateurs Macron et l'ancienne chancelière Angela Merkel, échoue-t-il justement ? Un avion de combat, accompagné de drones et de systèmes de transport pour d'autres avions sans pilote, soutenu par un cloud de données pour le combat ; meilleur et plus puissant que tout ce que les Américains, les Russes et les Chinois ont jusqu'à présent ? 2000 ingénieurs en Allemagne et en France auraient récemment réfléchi à cet avion de combat de sixième génération et au système qui l'accompagne. La dernière phase de planification aura coûté plus de 3 milliards d'euros – les études pour un « démonstrateur » qui devait voler cette année, mais qui n'a pas encore été construit. Le projet a été estimé à la somme record de 100 milliards d'euros. À partir de 2040, les Européens devraient disposer de leur nouveau système de défense avec l'avion de combat. Mais le FCAS n'a jamais avancé depuis son lancement en 2017. La saga du FCAS met en évidence le problème fondamental de l'Union européenne, et plus encore du tandem franco-allemand, lorsqu'il s'agit de grands contrats d'armement : les politiciens concluent des accords, annoncent un projet européen, puis les entrepreneurs des pays de l'UE se disputent – soutenus par ces mêmes politiciens – la répartition du gâteau, la production de moteurs, les systèmes de commande, les secrets industriels à ne pas partager, les centaines de fournisseurs nationaux à mandater, les emplois et les profits. L'égoïsme national s'oppose au pathos européen. Parfois, cela fonctionne, parfois cela échoue. La construction de l'avion de transport Airbus A400M pour sept États membres de l'UE a pris un quart de siècle, mais il vole désormais. En revanche, la construction commune d'un avion de combat avec les Français a échoué dans les années 80 ; deux appareils ont alors vu le jour : l'Eurofighter et le Rafale français. Il pourrait en être de même pour le FCAS. Dassault va à nouveau construire un avion à réaction seul, Airbus Defence – dans lequel la France détient également des parts – pourrait se lancer dans un autre projet déjà en cours : les Britanniques, les Italiens et les Japonais prévoient déjà un nouvel avion de combat, tout comme les Suédois. Le directeur d'Airbus Defence, Michael Schöllhorn, déplore cette fragmentation des Européens. Il a récemment réaffirmé que, contrairement aux États-Unis, tout était produit en plusieurs exemplaires sur le Vieux Continent. En effet, il existe quatorze types de chars de combat en Europe, près d'une vingtaine de systèmes d'artillerie et quinze modèles d'avions de combat. Les gouvernements européens ont toujours privilégié les incitations financières et les synergies : les coûts sont partagés et les projets d'armement qu'une seule entreprise ne pourrait pas mener à bien seule deviennent ainsi réalisables d'un seul coup. C'est ce que l'on pourrait croire. Mais pas si l'on en croit Éric Trappier, le PDG chevronné de Dassault. « Je suis un type simple », a-t-il déclaré avec coquetterie lors d'une audition devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale française l'année dernière. « Je ne suis pas très intelligent, c'est la raison pour laquelle j'occupe ce poste ! » Mais parfois, il vaut mieux ne pas vouloir être trop intelligent et agir à la place. Dès le début, Éric Trappier a insisté sur le leadership technique de Dassault dans le projet FCAS. Dassault serait le « meilleur athlète », capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire : construire tout seul un avion de combat maniable et ultramoderne. Les Allemands d'Airbus Defence devraient se contenter des drones, les Espagnols du cloud de combat. Soit beaucoup moins de valeur ajoutée et de prestige. Pour le patron de Dassault, toute cette orientation est erronée. Ni dans le projet d'avion FCAS, ni même en Europe, où les autres États – contrairement à la France – n'ont pas construit après la Seconde Guerre mondiale une puissance nucléaire indépendante des Américains, mais seulement un marché intérieur, comme le raille Trappier, dans lequel ils font circuler des marchandises. L'entrée des Espagnols dans le consortium FCAS en 2019 a réduit le poids des Français à un tiers par rapport à celui des Allemands. Le plus compétent dans ce projet pourrait être mis en minorité à tout moment ! C'est ainsi que voit les choses Trappier, et la question est de savoir dans quelle mesure le président Macron le suit sur ce point. Le chef de l'État français est faible, il entame sa dernière année de mandat, il n'a pas la majorité au Parlement et il est extrêmement impopulaire. L'État français ne détient plus de parts dans Dassault et ne peut donc pas intervenir dans la gestion de l'entreprise. À Munich, Macron a de nouveau fait la promotion du projet FCAS. Mais Trappier s'est depuis longtemps rapproché politiquement du Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. L'un d'eux pourrait remporter les élections présidentielles l'année prochaine. Le néo-gaullisme, suivi par Dassault et d'autres entreprises françaises, trouve un large écho au sein du parti d'extrême droite. L'indépendance nationale et la capacité de frappe nucléaire, que le général de Gaulle a élevées au rang de doctrine d'État dans les années 1960, apparaissent aujourd'hui plus que jamais comme une position logique pour beaucoup dans le pays. « Le modèle français a ses vertus, et l'Europe a tout intérêt à s'en inspirer », a déclaré le patron de Dassault devant les députés. Des décombres du projet FCAS pourrait ainsi surgir un mauvais esprit : la rivalité entre la France et l'Allemagne pour le leadership en Europe.
-
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Non, comme la France n'est pas dépendante de l'Allemagne, elle ressemble plutôt à un escroc matrimonial insistant. On accepte ses flatteries, mais il faut cacher sa carte de crédit. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
J'ai donc examiné le programme, qui comprend 150 revendications accompagnées d'un point d'exclamation. Dans ce domaine, qui relève de l'éducation, le gouvernement régional pourrait effectivement prendre de nombreuses décisions. https://table.media/assets/berlin/26-01-23_entwurf_afd-regierungsprogramm-2026-sachsen-anhalt.pdf Recevoir des cours de russe ! Le russe est une langue internationale et scientifique parlée par plus de 250 millions de personnes, dont 150 millions de locuteurs natifs. Il permet d'accéder à des réalisations culturelles de très haut niveau et ouvre de précieuses possibilités de communication. L'Allemagne, et en particulier la Saxe-Anhalt, ont un grand intérêt, tant sur le plan économique que culturel, à entretenir de bonnes relations avec la Russie. La politique hostile à la Russie menée actuellement par les anciens partis n'est quant à elle pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Elle divise l'Europe dans l'intérêt d'autres pays. Afin de lutter contre cela et de poser les bases d'un avenir meilleur, nous ferons tout notre possible pour maintenir l'enseignement du russe en Saxe-Anhalt et, si possible, le développer. Pour ce faire, il convient notamment de cibler des locuteurs natifs russes ayant une formation universitaire et de les recruter en tant que nouveaux venus dans la profession. 15. Relancer les échanges scolaires avec la Russie ! Les 10 et 11 février 2022, la Conférence des ministres de l'Éducation a décidé de suspendre la coopération avec la Russie. La Saxe-Anhalt a suivi cette décision et a depuis lors gelé toutes les relations au niveau scolaire, et en particulier tous les programmes d'échange scolaire. Nous allons relancer les échanges scolaires avec la Russie, reprendre tous les programmes gelés et en développer de nouveaux, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, on n'apprend une langue étrangère difficile comme le russe de manière à pouvoir communiquer que si l'on est en contact avec des locuteurs natifs. Deuxièmement, le contact personnel avec des Russes est le meilleur remède contre la propagande haineuse et l'attisement des conflits qui ont actuellement cours. --- --- Ils n'écrivent malheureusement rien sur la France, mais ils connaissent bien Bismarck : Plus 1813 et 1871 – Réviser les programmes d'histoire ! Les programmes scolaires d'histoire de tous les types d'écoles se caractérisent par le fait que le XIXe siècle, période la plus importante pour la formation de la nation allemande, est trop peu abordé. Or, l'État-nation fondé en 1871 est le prédécesseur de la République fédérale d'Allemagne. L'Empire allemand fondé par Bismarck a établi des normes dans les domaines scientifique, culturel et économique qui peuvent encore aujourd'hui nous servir d'inspiration et de modèle. C'est pourquoi nous mettrons clairement l'accent, dans nos cours, sur la création et l'histoire couronnée de succès de cet État. -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Les élections régionales auront bientôt lieu en Saxe-Anhalt, le Land où l'AfD est le plus fort et où il pourrait peut-être pour la première fois fournir le ministre-président. C'est un Land rural et pauvre. Voici le programme de l'AfD si elle arrive au pouvoir. Il faut dire que certains points du programme sont du verbiage, car un Land n'est tout simplement pas compétent dans ce domaine politique.:https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/afd-wahl-programm-entwurf-102.html Le leitmotiv central du programme de l'AfD est apparemment ce qu'on appelle la « remigration ». Alors qu'il y a deux ans, ce terme était encore discuté dans les coulisses de Potsdam, il est désormais au cœur du programme. Le projet de programme réclame un « revirement à 180 degrés de la politique migratoire » et une offensive globale en matière d'expulsion. La migration y est présentée comme une menace fondamentale, associée à des termes tels que « étranger à la culture » ou « hostile aux nationaux ». L'asile ne doit être expressément qu'un « droit d'hospitalité temporaire ». Rémigration et État fort : atteintes aux droits et à la vie quotidienne Le projet dresse l'image d'un État fort et autoritaire, qui impose l'ordre par la contrainte si nécessaire. Le ton et les mesures proposées rappellent l'agence américaine ICE chargée des expulsions, avec un hébergement centralisé, des obligations de travail et une application rigoureuse des obligations de quitter le territoire. Il est apparemment prévu de créer des centres d'hébergement en dehors des centres-villes, d'imposer une obligation de travail à tous les demandeurs d'asile et de confisquer leurs biens à leur arrivée. Selon le programme, l'argent liquide, les cartes de crédit et autres valeurs doivent être « identifiés, confisqués et utilisés pour financer l'hébergement et la restauration ». Le programme qualifie les agents chargés des expulsions de « héros du quotidien qui servent leur peuple et leur patrie ». L'AfD rejette donc catégoriquement l'asile ecclésiastique. Les paroisses pourraient être tenues financièrement responsables si les expulsions sont retardées. La rupture avec les principes libéraux-démocratiques est particulièrement évidente dans le chapitre consacré à la démocratie et aux droits civiques. L'AfD remet apparemment en question le vote par correspondance et le déclare vulnérable à la manipulation. Le vote aux urnes dans les bureaux de vote est présenté comme le seul modèle légitime. À l'avenir, les associations et les initiatives ne devraient bénéficier d'aides publiques que si elles font preuve d'un « engagement crédible en faveur de l'ordre démocratique et d'une attitude patriotique », une sorte de test de loyauté politique ayant des conséquences directes pour les clubs sportifs, les initiatives culturelles ou les fêtes de village. Dans le préambule, l'AfD dépeint un scénario dramatique. Sans elle, la démocratie serait perdue et une « dictature des anciens partis » menacerait. La date des élections de 2026 est décrite comme « peut-être notre dernière chance ». En matière de politique médiatique, le parti exige également un changement radical : résiliation des accords interétatiques sur la radiodiffusion, transformation de la radiodiffusion publique en une « radio de base » financée par les impôts, suppression des subventions pour les médias indépendants tels que Radio Corax. Le programme met l'accent sur l'action « dans l'intérêt des citoyens », mais prévoit de nombreuses suppressions : les programmes de subvention doivent être « déidéologisés », les délégués à l'égalité ou à l'intégration doivent être supprimés car ils sont considérés comme une « politique symbolique rouge-verte », tout comme les subventions publiques aux églises et à l'agence régionale de l'énergie. En matière de politique éducative, l'AfD promet de « mettre de l'ordre » et de mettre l'accent sur la performance. Dans le même temps, elle réclame la fin de l'inclusion, des classes spéciales pour les enfants réfugiés et des services de sécurité dans les écoles. Pour certaines familles, cela signifierait des trajets plus longs pour se rendre à l'école et moins de soutien individuel, tandis que des problèmes tels que la pénurie d'enseignants et la vétusté des bâtiments scolaires ne sont guère abordés. La suppression prévue des subventions publiques aux Églises aurait également des conséquences concrètes. En Saxe-Anhalt, les Églises sont des acteurs importants dans le domaine des crèches, des soins et des centres de conseil, en particulier là où les services publics font défaut. Dans le chapitre consacré à la famille et aux enfants, l'AfD défend une vision résolument conservatrice de la famille. La famille composée d'un « père, d'une mère et d'autant d'enfants que possible » doit redevenir le modèle à suivre. Le programme attribue la baisse du taux de natalité au fait que « les déviations sexuelles et les modes de vie non reproductifs sont désormais mieux acceptés » que le mariage classique. Il s'agit donc des couples de même sexe et/ou des couples qui décident délibérément de ne pas avoir d'enfants. En matière d'avortement, l'AfD demande un durcissement de la législation : une échographie doit être obligatoire lors des consultations en cas de grossesse conflictuelle. Les fonds publics destinés à l'insémination artificielle doivent être augmentés et les « couples sans enfants » doivent être privilégiés en matière d'adoption. L'AfD rejette explicitement l'immigration comme réponse au changement démographique : « Les enfants sont notre avenir, pas les immigrants. » L'AfD se positionne très clairement contre la ligne suivie jusqu'à présent par le gouvernement fédéral, l'UE et l'OTAN. La Russie est décrite comme un partenaire, tandis que l'aide à l'Ukraine est considérée comme une mauvaise incitation. L'AfD rejette les sanctions : « Les sanctions nuisent surtout à ceux qui les prononcent ! » Le parti demande la levée des sanctions contre la Russie, la mise en service du gazoduc Nord Stream et la relance des programmes d'échange scolaire avec la Russie. La guerre d'agression menée par la Russie n'est pas clairement désignée dans le texte, qui parle plutôt du « conflit ukrainien ». Les réfugiés ukrainiens se voient accorder un « statut particulier », notamment par l'accès direct au revenu citoyen. L'AfD écrit : « Le revenu citoyen est depuis longtemps devenu l'argent des migrants. » Elle remet en question le statut de protection de nombreux Ukrainiens et fait valoir que seule une petite partie du pays est touchée par la guerre. Elle préconise le retour des réfugiés : « L'Ukraine a besoin que ses citoyens reviennent pour reconstruire le pays », peut-on lire dans le programme. Ce dernier est encore à l'état de projet. -
Europe de la Défense ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de samson dans Politique etrangère / Relations internationales
Je ne vois pas dans les médias allemands que tout est rentré dans l'ordre grâce à Rubio. C'est juste que si 80 % des Allemands pensent que Trump est un gangster fou et peu fiable, 80 % pensent également qu'il sape la puissance américaine et qu'il y a donc de fortes chances qu'il soit écarté par le système. Ainsi, 80 % des Allemands pensent que les relations avec les États-Unis vont s'améliorer, mais qu'elles ne seront plus aussi bonnes qu'avant. Ces chiffres sont le fruit de mon intuition et ne sont pas scientifiques. -
Dissuasion nucléaire européenne, voire allemande ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Dissuasion nucléaire
Oui, cela semble être une bonne description de la situation. L'Allemagne est actuellement mal placée pour prendre des décisions aussi importantes. Lorsque les structures fondamentales de la défense ont été mises en place, le parlementarisme et la séparation des pouvoirs existaient certes, mais Adenauer a réussi à imposer un style très autoritaire – on parlait alors de « démocratie chancelière ». Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs, de partis et de coalitions. Ces forces se neutralisent, ce qui conduit souvent à un maintien du statu quo... -
US vs EUROPE
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
Hé, de ce côté du Rhin, j'ai toujours pensé que vous étiez de la même observance politique ? Est-ce que certaines nuances m'auraient échappé ? -
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Mon argument était le suivant : 1. Depuis 30 ans, tous les dirigeants français répètent à leurs voisins, en particulier à l'Allemagne, qu'ils doivent discuter de l'importance des armes nucléaires françaises pour l'Europe. 2. Depuis 30 ans, lesdits voisins refusent d'aborder le sujet, car l'Oncle Sam gère la sécurité et personne ne veut se brûler les doigts avec des questions aussi délicates. 3. Poutine envahit Kiev. 4. Trump découvre le Groenland. 5. Lesdits voisins, en particulier l'Allemagne, parlent de la nécessité de discuter de la nécessité d'une dissuasion nucléaire « européenne ». Avec toutes sortes d'idées amateurs. 6. Le FCAS part en vrille. 7. Ici, sur le forum, on s'indigne du fait que lesdits voisins veulent désormais parler d'armes nucléaires. C'est une tragicomédie. -
US vs EUROPE
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
Au Japon, la part de l'industrie dans le PIB est deux fois plus élevée qu'en France et nettement plus élevée qu'en Allemagne. Pourtant, le pays est en crise. Ce n'est pas aussi simple que cela. -
US vs EUROPE
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de herciv dans Politique etrangère / Relations internationales
En Allemagne, ce sont principalement des entreprises actives dans le secteur de l'acier ou des équipementiers automobiles (Bosch, Continental) qui ont signé. -
Royaume-Uni
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Pic a raison, il est fascinant de constater à quel point le marché immobilier diffère entre le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. J'ai interrogé ChatGPT. Le bail emphytéotique existe dans tous ces pays, mais ce n'est qu'au Royaume-Uni qu'il joue un rôle prépondérant. Cela remonte probablement au Moyen Âge, lorsque toutes les terres appartenaient au roi. Au cours de la première phase d'industrialisation, le Royaume-Uni a développé un marché immobilier qui fonctionne de manière très différente de celui du continent, y compris en matière de financement. Quoi qu'il en soit, si les loyers sont si élevés au Royaume-Uni, cela n'est pas viable à long terme. En France, on aurait depuis longtemps des gilets jaunes armés de torches et de fourches. Le peuple le plus endurant d'Europe n'est pas le peuple russe, mais le peuple anglais. -
Royaume-Uni
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Bonjour Pic, Je suis désolé, soit je me suis trompé en écrivant, soit DeePl a mal traduit. Il ne s'agit pas de la retraite, mais du loyer qui, en moyenne, est deux fois plus élevé au Royaume-Uni qu'en Allemagne (750 euros contre 1 500 euros). -
Honnêtement, étant donné que l'ICE est manifestement un groupe d'hommes armés mal formés et indisciplinés, je me demande depuis une semaine si Trump ne ferait pas mieux de faire appel à l'armée s'il veut capturer les immigrants sans susciter trop de controverse. Au moins, celle-ci dispose d'une structure hiérarchique établie, d'une discipline et d'une plus grande sympathie de la part de la population locale.