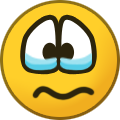-
Compteur de contenus
25 444 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Russie et dépendances.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tactac dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111679/SARS-CoV-2-Russland-legt-Foto-Datenbank-von-Infizierten-an (3 avril 2020) La Russie veut créer une base de données de photos de patients infectés par le CoV-2 du SRAS afin d'améliorer la surveillance des personnes infectées. Si le test est positif, une photo de la personne infectée sera prise immédiatement après, a déclaré le président du Parlement de Moscou, Alexei Shaposhnikov, à la chaîne publique Perwy Channel. Les photos ne sont accessibles qu'aux autorités, les données personnelles sont spécialement protégées. Ainsi, les personnes infectées en quarantaine et les résidents en auto-isolement pourraient être surveillés s'ils ne respectaient pas les réglementations strictes. Pour l'instant, ce règlement ne s'appliquerait que dans la métropole de Moscou et ses environs. Cependant, il pourrait également être utilisé à l'échelle nationale, a-t-on dit. Les autorités utilisent déjà des caméras de surveillance avec fonction de reconnaissance faciale pour contrôler les restrictions de sortie. Selon les estimations, au moins 15 millions de personnes vivent à Moscou, et depuis le début de la semaine, elles sont soumises à des couvre-feux draconiens. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
La décision n'était-elle pas déjà prise depuis un certain temps, notamment depuis que Monaco a passé contrat avec Huawei, sachant que l'opérateur de Monaco est un opérateur français ? -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/3078479/fears-massive-pakistan-coronavirus-outbreak-after-100000 (5 avril 2020) Pakistan Les autorités veulent tester ou mettre en quarantaine les personnes qui se sont rassemblées à la Tablighi Jamaat - un mouvement missionnaire islamique - du 10 au 12 mars Selon les organisateurs, environ 100 000 personnes ont assisté à la réunion Environ 2 500 participants - dont 1 500 étrangers - qui étaient restés autour du site de l'événement, qui comprend une mosquée et des dortoirs, ont été placés en quarantaine. Jusqu'à présent, au moins 154 fidèles qui se sont rendus au Jamaat le mois dernier ont été testés positifs pour le coronavirus, avec deux décès à ce jour, selon les autorités. Les fonctionnaires ont jusqu'à présent retrouvé environ 7 000 participants dans la province du Pendjab et les ont placés en quarantaine. Le 23 mars, le ministère de la santé de Gaza a confirmé que ses deux premiers cas de coronavirus étaient des Palestiniens qui avaient assisté au rassemblement. Le prédicateur principal de Tablighi, Naeem Butt, a déclaré qu'il était "ignorant" et "irresponsable" de blâmer le mouvement pour la propagation du virus. "Nous avons annulé notre événement après deux jours lorsque les autorités nous ont dit de le faire", a-t-il déclaré. -

Royaume-Uni
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/05/scotland-chief-medical-officer-seen-flouting-lockdown-advice-catherine-calderwood La médecin-chef écossaise (CMO) a été photographiée en train de visiter la résidence secondaire de sa famille à Fife pendant la pandémie de coronavirus, bien qu'elle ait elle-même conseillé de rester à la maison. Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré samedi : "Depuis le début de cette épidémie, la CMO travaille sept jours sur sept à la préparation de la réponse de l'Écosse. "Elle a profité de ce week-end pour aller vérifier une maison familiale à Fife, car elle sait qu'elle ne reviendra pas tant que la crise ne sera pas terminée. Elle y a passé la nuit avant de retourner à Édimbourg. "Conformément aux directives, elle est restée au sein de son propre groupe familial et a observé une distanciation sociale avec toute personne dépassée dans le village". -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html En bas de page, la carte de la surmortalité en France au 30 mars par rapport à 2019, par département. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Sur ce point, ce n'est pas ce que j'appellerais un "plein air". -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
J'avais retenu que la Porte Ouverte Chrétienne est ce qu'on appelle une "megachurch" de 7000 m² et de capacité d'accueil 3268 personnes en 2015 : https://www.lalsace.fr/actualite/2015/05/10/une-eglise-evangelique-de-7000-m2-inauguree-a-mulhouse Je doute que la rencontre de 2020 ait été tenue en plein air, en février, sous une température inférieure à 10°. Si c'est avec le pied ou avec des gants ? Ou en se lavant les mains ? -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Je retiens de cette vidéo l'importance d'ouvrir les fenêtres. Peut-être va-t-on aller vers une révision des critères d'ouverture des magasins en fonction d'une norme de climatisation ? Cela suggère aussi qu'on pourrait sous certaines conditions, sur la base d'études scientifiques, réautoriser les sports collectifs en plein air (mais pas les vestiaires). Pour l'instant, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu des chaînes de contaminations lors d'événements sportifs en plein air. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Ce qui serait intéressant c'est de regarder les chiffres de mortalité toutes causes confondues, et de les comparer avec l'année précédente, de façon à avoir une estimation des morts indirectes et de les comparer avec les autres pays comme l'Espagne ou l'Italie. Voir http://www.air-defense.net/forum/topic/21905-coronavirus-covid-19/?do=findComment&comment=1295144 -

Bolivie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Borisdedante dans Politique etrangère / Relations internationales
Morales avait son vernis : une décision de la cour constitutionnelle en sa faveur.- 159 réponses
-
- bolivie
- amérique du sud
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://nymag.com/intelligencer/2020/04/coronavirus-is-only-part-of-the-excess-fatality-mystery.html (avril 2020) Article sur les morts indirectes. En plus des décomptes officiels de décès dus au coronavirus, il faut compter les les morts dus au coronavirus mais qui pour une raison ou pour une autre n'apparaissent pas dans les statistiques, et les gens qui sont morts d'autres maladies faute d'avoir pu avoir été traités dans un système hospitalier saturé ou effondré. Dans certaines régions d'Italie la mortalité est 6 fois supérieure à l'an dernier, avec seulement un quart des décès attribués au coronavirus. Des constats similaires sont faits en Espagne. Dans certaines régions du monde touchées par l'ebola, il y a eu plus de morts par des malarias non traitées à cause de la saturation des hôpitaux que de morts directs par l'ebola. Une étude publiée en 2016 dans The Lancet a établi un lien entre au moins 250 000 décès par cancer et la récession de 2009. Le stress de la pandémie et la crise économique qu'elle a déclenchée vont probablement précipiter l'augmentation du tabagisme, de la consommation d'alcool et de la toxicomanie. "L'épidémie d'opiacés faisait la une des journaux jusqu'à ce que cela se produise, et elle n'a pas vraiment disparu", a déclaré M. Woolf. "Maintenant, mes collègues de la médecine des addictions rapportent une augmentation des surdoses d'opiacés pendant cette pandémie". -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
"q s p" veut dire compléter jusqu'à... 1000 ml, soit 1000-833-42-14.5 =110.5 mg donc ça doit faire dans les 0.833*0.96= 80°. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Est-ce qu'on sait à combien de degrés d'alcool est le gel ? -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Autre aspect mercantile qui permet de faire son beurre : le gel hydroalcoolique : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13909 Par exemple, un flacon de 100 ml pourra être vendu au détail jusqu'à 45 € le litre, un flacon de plus de 300 ml, 19,50 €. À ce prix là je me demande si je ne préfère pas me laver les mains à la vodka. Smirnoff, c'est plus classe que le gel hydroalcoolique fait maison de la pharmacie du coin. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Apparemment le regain de politique nationale (fermeture des frontières, etc...) coupe l'herbe sous le pied de l'AfD qui est en légère baisse. Les Verts sont en baisse aussi, je ne sais pas trop pourquoi ? Est-ce parce qu'ils sont perçus comme trop défavorables à l'industrie en cette période de crise économique ? Est-ce parce que la décroissance qui va être là, de facto, leur coupe l'herbe sous le pied, à eux aussi ? La mise à l'arrêt de l'économie arrête brusquement la pollution aussi. Confinement oblige, Greta Thunberg et ses amis ont arrêté de manifester le vendredi. Et aussi, en période de crise, il y a un effet de "regroupement autour du drapeau" donc autour du gouvernement en place CDU-SPD, qui est à l'action, tandis que l'opposition n'a pas grand chose à dire ou à critiquer, de peur d'apparaître comme divisant le pays à un moment où il a besoin d'être uni. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_87643946/umfrage-in-corona-krise-bevoelkerung-mit-regierung-so-zufrieden-wie-nie.html (3 avril 2020) Sondage : 63% sont satisfaits du gouvernement, soit 28 points en plus par rapport à il y a un mois ! Et à 60% de satisfaction, Merkel n'a jamais été aussi haut depuis le début de ce mandat. -

Politique étrangère du Royaume-Uni
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Berezech dans Politique etrangère / Relations internationales
Le parti travailliste a un nouveau chef, Keir Starmer. Voilà la proposition N°4 de ses 10 propositions : Plus de guerres illégales. Introduire une loi sur la prévention des interventions militaires et placer les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère. Revoir toutes les ventes d'armes au Royaume-Uni et faire de notre pays une force pour la paix et la justice internationales. source : https://keirstarmer.com/plans/10-pledges/ -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Ca a été relevé : https://www.accuweather.com/en/health-wellness/study-on-new-coronavirus-says-warmer-weather-may-slow-covid-19-spread-and-cooler-weather-may-accelerate-it/707177 (26 mars 2020) Leurs recherches (Bukhari et Jameel https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3556998) ont révélé que les pays au climat plus chaud et plus humide, comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, connaissaient un taux de croissance plus faible. Parallèlement, les pays et les États connaissant des taux de croissance élevés, comme l'Italie, la Corée du Sud et, aux États-Unis, les États de New York et de Washington, "présentent des régimes climatiques similaires aux points chauds d'origine du Hubei et du Hunan avec des températures moyennes comprises entre 3 et 10 C (37,4 et 50 F) en février et mars". Un phénomène similaire a été noté au début du mois par des chercheurs qui ont remarqué que de nombreux points chauds COVID-19 se trouvaient tous dans une "zone tempérée" entre 30 et 50 degrés de latitude nord. -
Voir aussi le "rapport de mobilité Google" : https://www.google.com/covid19/mobility/
-

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Shinzo Abe à la Chambre des Conseillers vendredi. Source : https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200404-00000019-jij-pol.view-000 -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207023019/Corona-Krise-Das-geht-zu-weit-Linke-und-Gruene-kritisieren-Reiseverbote.html (4 avril 2020) Die Linke et les Verts critiquent la mesure prise par la région de Meklembourg-Poméranie-Occidentale en prévision de Pâques : les résidences secondaires ne peuvent être occupées que par leurs propriétaires, et uniquement si ils ont leur résidence principale dans la région. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Il y a aussi le fait que quand il fait chaud, les gens sont plus souvent dehors, ou ouvrent les fenêtres, donc ne respirent pas un air confiné. Concernant la grippe saisonnière, il y a surtout des hypothèses, et pas de conclusions fermes, et a fortiori ce n'est pas forcément transposable au coronavirus, mais voilà un aperçu de la réflexion : https://en.wikipedia.org/wiki/Flu_season Le mécanisme exact qui sous-tend la nature saisonnière des épidémies de grippe est inconnu. Certaines explications sont proposées : Les gens sont plus souvent à l'intérieur pendant l'hiver, ils sont plus souvent en contact étroit, ce qui favorise la transmission d'une personne à l'autre. Une diminution saisonnière de la quantité de rayons ultraviolets peut réduire la probabilité que le virus soit endommagé ou tué par des dommages directs dus aux rayonnements ou par des effets indirects (c'est-à-dire la concentration d'ozone) augmentant la probabilité d'infection. Les températures froides conduisent à un air plus sec, ce qui peut déshydrater les muqueuses, empêchant l'organisme de se défendre efficacement contre les infections respiratoires virales. Les virus sont conservés dans des températures plus froides en raison d'une décomposition plus lente, de sorte qu'ils s'attardent plus longtemps sur les surfaces exposées (poignées de porte, comptoirs, etc.). Dans les pays où les enfants ne vont pas à l'école en été, le début de la saison de la grippe est plus prononcé et coïncide avec le début de l'école publique. On pense que l'environnement de la garderie est parfait pour la propagation de la maladie. La production de vitamine D à partir de l'ultraviolet B dans la peau change avec les saisons et affecte le système immunitaire. Des recherches menées sur des cobayes ont montré que la transmission du virus par aérosol est renforcée lorsque l'air est froid et sec. La dépendance à l'aridité semble être due à la dégradation des particules virales dans l'air humide, tandis que la dépendance au froid semble être due au fait que les hôtes infectés excrétent le virus pendant une période plus longue. Les chercheurs n'ont pas trouvé que le froid affaiblissait la réponse immunitaire des cobayes au virus. Les recherches menées par le National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) en 2008 ont montré que le virus de la grippe a une "enveloppe semblable à du beurre". L'enrobage fond lorsqu'il pénètre dans les voies respiratoires. En hiver, l'enrobage devient une coquille durcie ; il peut donc survivre par temps froid comme une spore. En été, l'enrobage fond avant que le virus n'atteigne les voies respiratoires. -

USA - Criailleries 2 - Rumeurs, controverses, polémiques
Wallaby a répondu à un(e) sujet de rogue0 dans Politique etrangère / Relations internationales
Trump recommande le masque mais ne veut pas en porter lui-même : Porter un masque facial lorsque je salue des présidents, des premiers ministres, des dictateurs, des rois, des reines - je ne sais pas, d'une certaine manière je ne le vois pas pour moi-même. Peut-être que je changerai d'avis, mais espérons que cela passera vite. -
À ce sujet, il existerait un "index de mobilité Google" :
-

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Les derniers graphiques de John Burn Murdoch source : https://www.ft.com/coronavirus-latest source : https://twitter.com/jburnmurdoch Je n'ai pas encore tout lu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'analyse inverse et prédire que l'épidémie, tout en ayant un lourd bilan, passera inaperçue en Afrique un peu comme la grippe de Hong Kong en France en 1969 ? Si les gouvernements ne prennent aucunes mesures de confinement (ou en prennent sans être capables de faire appliquer, ce qui revient au même), l'économie, formelle et informelle, pourrait ne pas beaucoup être affectée, et la légitimité des gouvernements ne pas être remise en question plus qu'ordinairement. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-lacademie-de-medecine-favorable-au-port-obligatoire-du-masque-meme-alternatif Jonathan F • Médecin ou Interne • Le 03/04/2020 à 19:57 Avec d'autres collègues médecins nous avons créé le site http://stop-postillons.fr/ qui est le site bénévole de référence pour tout savoir sur les masques faits "à la maison" pour lutter contre le coronavirus. Le site est mis à jour quotidiennement pour regrouper tous les tutoriels pour apprendre à fabriquer son propre masque, du plus simple en papier, au plus complexe validé scientifiquement. Vous y trouverez des guides didactiques pour apprendre à les porter et à les recycler ! Les références scientifiques sont également présentes. Le port de ces masques est indispensable comme 6ème mesure barrière pour enrayer l'épidémie de COVID19 et permettre un futur dé-confinement serein.