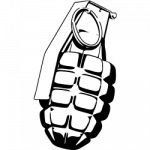-
Compteur de contenus
1 612 -
Inscription
-
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par max
-
Clairon, chaque fois qu'il m'est donné de te lire sur un sujet en rapport avec des véhicules "kaki" ( notoirement Français ) je crois deviner dans tes propos des intonnations dignes d'un camarade de "cambouis"... On se serai pas croisé par le passé dans une fosse à vidanges près d'une piste à chars des fois ? ;)
-
la cave d'Arnaud est un sujet qui ressort régulièrement à chaque évènement remarquable du site.... Les commentaires vont bon train et mème aux dires de certains le coté qualitatif des liquides contenus frise le " petit jésus en culotte de velour". Arnaud, très clairement, li va falloir passer à l'action =D =D =D
-
i think so
-
je ne vois aucune ( du verbe "pas du tout" ) comparaison possible entre la légion étrangère de l'armée Française et les contractors, ni de près ni de loins. Je comprend qu'en terme de sémantique, ou pour alors illustrer certains propos, on cite "la légion" par ce que sa composante humaine intègre une forte proportion de personnels d'origine étrangère, mais aller plus loins ensuite relève du douteux, non ? Un légionnaire est un soldat français. Pas le soldat "d'un certain idéal". Le concept "séduisant" pour certaines nations dans les conflits dits de Peters ( assymétriques ) consistant à déléguer des contractors là ou cela les arrange semble avoir atteind ses limites. Je lis de plus en plus dans la presse ouverte des RETEX édifiants... Quelqu'un a des info la dessus ?
-
;) Mon premier tir tendu au FLG, et mon premier doight en m... ! =D =D =D. Je reste persuadé que malgré ce beau carton sur le panzer/cible, le tir tendu de grenade à fusil reste... pas évident à réussir.
-
Bienvenu camarade et bon forum ! ;)
-
superbes photos jeanmi, merci.
-
... ça fait pas sérieux... =) Un hersatz de Merk, mais avec ( et c'est rigolo ) quand mème des points clés d'indent' d'un Merk : du "chains and ball " en nuque de tourelle un bulbe en embase de tourelle L'"air exaust" d'échappement au mème emplacement.... Par contre des grilles d'aération moteur dessous la nuque de tourelle, une embase de tourelleau "vissé", un canon très très court, une tourelle trop avancé sur sa caisse, comme déja dit le nombre de galets et leur forme, le panier en nuque de tourelle trop étroit... Maintenant, le but d'un tel engin ? intox/désinformation, training C.R.A.C.....
-
Je reste réservé sur le coté "aveugle" du Mossad ( et d'autres officines du mème pays d'ailleurs ) ainsi que le fait qu'il n'ait "rien compris à l'évolution du hezbollah".... La qualité du rens' Israélien serait-il donc tombé si bas ? Ne pourrait-on dire plutot que l'interprétation et l'application politique qu'en ont fait les décisionniares israéliens du moment ( avec d'autres facteurs, bien sur ) n'ont alors pas donné les résultat que l'on aurait pu s'attendre à voir. Franchement que les services de renseignement Israéliens se soient gourés sur toute la ligne me parait difficilement possible. Je ne dis pas que qq dossiers n'ont pas été foireux ou à coté de la plaque, comme il se doit dans ce genre de guerre "glauque", mais de là à penser que le Mossad ait été "aveugle"...... Alors cela signifierai que personne de ce service n'a pu "prévoir" la dotation du hezbollah en armement AC récent et performant, que le maillage serré d'abris et de cache logistique particulièrement bien disséminé ( du rens' de proximité ça... ) n'a pu ètre décelé bien en amont du début de l'offensive... Entre savoir et faire.... Pardon pour le HS Shuggart =)
-
si seulement.... =D, et si le temps pouvait ètre élastique.... =D. En fait je souhaiterai pouvoir un peu plus illustrer tout ça avec des dessins ( je "gribouille" un peu....), histoire de colorer un peu le tout. Fusilier toute intervention de ta part est la bienvenue ( ainsi que pour tout le monde d'ailleurs ), il est claire que les imprécisions et lacunes sont légions dans cette rédaction. Enrichissons ce brouillon que diable ! =D
-
=D =D =D, merci Rochambeau !
-
Et si l’on parlait d’une séquence de tir ? Ici point de radar Cobra dans la batterie ni de VOA …Avant de tirer ( on disait « traire » ), on met en place le boulet, la poudre et le tampon ; puis on cale la culasse lorsqu’il y en a une. La déflagration est provoqué par l’intermédiaire d’un orifice, le trou de lumière, ou lumière, qui a été creusé dans le tube vers la charge. Cet orifice est rempli d’une poudre noire particulièrement soignée et finement pulvérulente que le canonnier garde précieusement sur lui. On y met le feu avec un tison ou, mieux, avec une tige de fer qui a été porté au rouge dans un brasier tout proche entretenu par un aide. Cet aide est souvent la femme du boute-feu =D ; car la mise en œuvre de ces armes est aussi artisanale que leur fabrication. Plus tard on mettra le feu soit avec une mèche imprégnée de soufre, soit avec une corde bouillie dans une solution concentrée de salpêtre puis séchée… En mettant le feu il est prudent de se jeter dans le trou qu’on a préparé à l’avance, car il faut toujours prévoir un éclatement de la pièce. En 1561, encore, alors que le danger d’éclatement est considérablement réduit, un « traité de canonnerie » conseil aux canonniers « d’honorer Dieu et de craindre un peu plus de l’offenser que nul autre homme de guerre, car toutes les fois qu’il fait jouer de sa pièce il a son mortel ennemi devant lui… ». C’est d’ailleurs pourquoi les artilleurs ont conservé pieusement de fêter chaque 4 décembre leur protectrice, sainte Barbe….. ….Ah noble et sainte Barbe….. =)
-
... Puisque les armes à feu apparaissent comme étant l’avenir de l’armée, il est sage d’en organiser au mieux la production en France ; homme, métal, acier.. La fonte de fer a fini par succéder au fer forgé. Le fer vient d’Espagne ( il est réputé ), d’Angleterre et d’Allemagne. Mais le bronze parait déjà vouloir reprendre la place que le fer lui a prise. Un manuscrit du XVI eme siècle de la bibliothèque nationale montre le roi se préocupant, en 1354, des réserves de cuivre qui peuvent lui permettre de se donner une artillerie à feu en bronze comme celle vers laquelle l’Allemagne parait s’orienter sur les conseils du religieux franciscain de Fribourg-en-Brisgau ; Berthold Swartz. Ce document, intitulé « règlement des Monnoies » expose que « le dix-septiesme may mil trois cent cinquante quatre, ledit seigneur roy estant acertené de l’invention de faire artillerie trouvée en Allemagne par un moine nommé Berthold Swartz, ordonna aux généraux des Monnoies faire diligence d’entendre quelles quantités de cuivre estoient ausit royaume de France, tant pour adviser de smoyens d’iceux à estrangers et transport hors du royaume »…. Ainsi, ce règlement amorce la préparation de ce que l’on appel, six siècles plus tard, la mobilisation industrielle, avec recensement, stockage, contrôle et répartition des matières dondamentales pour la défense du pays… =) ...
-
…concernant les affûts…. A l’origine, l’affût sur lequel la bouche à feu est posée, ou fixée, n’est qu’un simple billot creusé. Son extrémité avant peut être soulevé par un tas de terre ou par une pièce de bois pour lui donner l’inclinaison voulue. L’autre extrémité du billot est placée dans un trou du sol qui, ainsi, encaisse le choc du recul. Parfois l’ensemble est immobilisé par des pieux. Qu’il s’agisse d’envoyer des pierres à l’intérieur de la ville assiégé ou d’essayer d’avoir qq efficacités sur les murailles en les attaquant en tir tendu, les pièces d’artillerie doivent s’en approcher. Elles sont ainsi à portée de toutes les armes des remparts. On les couvre donc, à l’avant, par un panneau de bois ( planches ou madriers ) appelé, selon la taille, « manteau » ou « mantelet », qui protège les canonniers contre les projectiles des assiégés et qu’on efface en le faisant pivoter autour d’un axe horizontal au moment du départ du coup. ...
-
Lorsque l’on parle de canon, en ce début de XIVeme siècle, il ne s’agit certes pas d’engins qui peuvent rappeler, même, les canons si simples du XIXeme siècle... On le voit, les canons, comme leur nom l’indique, ce sont des tubes, et ce nom sert seulement à distinguer les armes longues des mortiers. Longtemps, les canons, destinés essentiellement aux sièges ou à la défense des remparts, lanceront des projectiles ne dépassant pas 2 à 3 livres. C’est plus qu’il n’en faut pour défoncer une armure, c’est peu contre une muraille solide. Dans la deuxième moitié du XIVeme siècle, on voit apparaître des « gros canons jetant des pierres ». La portée utile ne dépasse pas qq centaines de mètres. La cadence de tir est de 10 à 20 coups par jour. Mais on envoie ainsi, dans une ville assiégée, des boulets de pierre dont le poids peut aller jusqu’à qq centaines de livres, faisant des dégâts sérieux et des victimes. En 1362, on signale une bombarde pesant 2000 livres. Pour info la livre en cours dans le royaume Français équivaut à 489,5 grammes. Dans le début du XVeme siècle, si l’on en croit certains acteurs et les restes de certaines pièces ( dont on ne sait pas si elles ont servi ), on atteint le gigantisme ; des bombardes de 25 000 livres…lançant des boulets pesant jusque 1000 livres, et même 1800 en l’an 1453.. ; mais c’est au siège de Constantinople. « A beau mentir qui vient de loin ! » =D. Quelques documents donnent des indications éparses, qui paraissent plus sures. Devant St-sauveur-le-Vicomte, en 1375, le « maître de l’artillerie » désigné pour le siège, Bernard de Monferrat, met sinon en œuvre du moins en plce 32 bouches à feu dont un « grand canon » jetant 100 livres amené de St Lo par Gérard de Figeac, « canonnier du roi », et un canon de 2300 livres qui a été forgé aux Halles de Caen en 42 jours de travail, avec l’aide de cinq maîtres forgeurs des plus habiles de la contrée ( Bilbo le hobbit ? =) ). En 1377, on signale une bombarde fabriquée pour le duc de Bourgogne et lançant une pierre de 437 livres. On ne connaît pas le calibre des grosses bombardes utilisées en 1432, au siège de Lagny, mais on sait qu’un de leur projectile, ayant la chance d’atteindre le pont sur la Marne, suffit pour en faire effondrer une arche……
-
Oups, bonne question… =) Il semble que le mot « bombarde » est très (trop ?) répandu à l’époque. Bien évidemment la bombarde ne lance pas des bombes, ce sont de grosses armes à feu….aussi je cite une phrase de l’époque « Ceste machine a esté premièrement appelée bombarde à cause du bruit qu’elle fait, que les latins appellent bombus ». On peut cependant dire que, dans leur début, les bombardes sont relativement courtes, légèrement tronconnique à l’intérieur et , en gros, cylindrique à l’extérieur, ce qui renforce la paroi au point ou l’explosion se produit. Ces métériels, courts, d’une seule pièce, se chargent par la bouche On donne à leur sujet quelques règles dont il serait audacieux de prétendre qu’elles sont respectées, mais qui peut ètre Akhilléus un élément de réponse à ta question ; -" La volée de la bombarde doit avoir une longueur d’environ 5 fois le diamètre de l’intérieur" - "Dans le volume de la chambre d’explosion ou réserve trois cinquième pour le tampon qui la sépare du boulet et il reste un vide de un cinquième… » Plus tard, lorsqu’ils s’allongent, l’extrémité arrière du tube est fermé par un bloc d’acier amovible comportant une chambre d’explosion ou l’on met la poudre. C’est la « chambre » ou « culasse ». Un étrier à queue basculant ( le « desserroir », complété au besoin par une cale ), peut être mis dans le prolongement du tube pour maintenir la culasse appliquée au moment du départ du coup. Il finit souvent par lâcher, avec un fort risque d’accident…. =|Normalement, chaque pièce a deux culasses. On charge l’une pendant qu’on tire l’autre. Dans la chambre de culasse, la poudre, légèrement tassé, est maintenu par un tampon de bois garni d’étoupe( ou, à défaut, d’herbe et de terre ) qui freine l’échappement des gaz par l’inévitable intervalle, le « vent », qui existe entre le projectile et la paroi de l’âme au détriment de la puissance de projection et de la précision en porté. Les bombardes lancent de grosses pierres qui sont appelé « boulet » lorsque l’on prend la peine de la tailler en boule, pour que, en collant un peu plus à la paroi et diminuant ainsi le « vent », elle utilise mieux la force des gaz de l’explosion. Des bombardes particulièrement petites, dites « bombardelles », sont souvent munies d’une queue qui se prolonge vers l’arrière et qui peut se poser sur l’épaule de celui qui vise. Un aide met le feu….. :|
-
...Nous arrivons aux « armes lourdes »… =) D’autres engins recherchent la puissance. Il est difficile de donner leurs caractèristiques. Jusqu’au début du XVeme siècle , chaque artisan canonnier farique les armes à sa guise, selon ses moyens, selon les désirs et les ressources du client, sans soucis d’un gabarit quelconque.... Il qualifie ses armes d’un nom qui parfois désigne une pièce en exemplaire unique et qui parfois se généralise sans, d’ailleurs, désigner les pièces d’un modèle terminé. Quelquefois même , le nom devient si général qu’il ne caractérise plus rien =D. Les armes appelées « mortier » ( ou « vase ») sont manifestement issues directement des mortiers dans lesquels on pilonne la poudre et ou se sont produit, au moins par accident, des explosions révélatrices des possibilités que la poudre noire offre pour expédier des projectiles. Gros, courts, tronconiques, d’une seule pièce, les mortiers peuvent envoyer sur les places assiégés ( sans aucun espoir de précision…. =D) de gros boulets ou des engins incendiaires. Du mortier, pour mieux exploiter la force de la poudre , on passe à des bouches à feu plus longues et finalement cylindriques. Le mot canon ( du latin « canna », canne, roseau creux du midi de la France ) qui les désigne normalement ( on dit aussi tuyau de tonnerre ) signifie alors « tube ». Si , depuis longtemps, ce mot n’est plus utilisé dans le sens actuel du tube, c’est évidemment pour éviter une confusion avec le sens nouveau très particulier que son emploi en matière d’artillerie lui donne. Cependant on dit toujours le « canon » (tube) d’un fusil. A l’origine, les projectiles de canons n’étaient pas gros. Comme les bouches à feu et les mortiers, les premiers canons sont en bronze. Mais ce bronze est couteux et résiste difficilement aux explosions mal controlées d’une poudre noire mal connue. Du bronze donc, on passe vite au fer…. =)
-
Continuons dans le « petit » calibre »……. =) Les couleuvrines légères sont servies par deux ou trois hommes. Parfois on se contente de les poser à terre en soutenant la bouche avec une pièce de bois. Plus souvent on les appuies, au moment de tirer, sur un support qui peut être le bras ou l’épaule d’un aide. Cette arme en s’allégeant devient le « couleuvrine » à main. Elle est parfois munie d’un crochet susceptible de s’accrocher au support ( notamment au parapet d’un rempart ) afin d’éviter au tireur le choc du recul, c’est la « couleuvrine à croc ». La couleuvrine à main, en s’allégeant encore et en prenant avec un manche en bois ( un fut ) une forme plus commode pour le tir, reçoit le nom d’arquebuse à feu. Celle-ci lance une balle de fer ou de plomb dont le diamètre peut ne pas dépasser celui de la monnaie courante appelée « pistole ». On désigne alors cette arme avec ce même mot ; et quand plus tard on fit des modèles très réduits de « pistoles », ce furent des « pistolets ». Ainsi se forme, souvent, les noms des nouvelles armes. De même, beaucoup plus tard, lorsque l’on cherche à remplacer l’incommode mèche comme moyen de mettre le feu à la poudre de l’arquebuse, on utilise ( par l’intermédiaire d’une petite charge de poudre fine, dite « fulminante », placée dans un bassinet ) d’abord les étincelles du rouet, puis celle d’un silex mu par un ressort qui arrache une pièce d’acier appelée « fusil » ( ou briquet ). C’est avec un tel « fusil » que depuis longtemps, pour faire du feu, on allume des combustibles bien secs. L’ « arquebuse à fusil » est finalement appelé fusil, et ce nom reste à l’arme légère, même lorsque au XIXeme siècle le « fusil » aura disparu, la mise à feu se faisant alors avec une amorce. Cette miniaturisation conduit les armes à feu légères à se répandre chez tous les combattants, et donc à perdre ce caractère exceptionnel qui fait l’artillerie ; elle lui échappe pour l’emploi…. =(
-
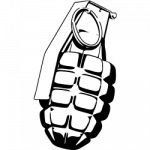
Tsahal retourne à ses fondamentaux et s'entraîne dur
max a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Politique etrangère / Relations internationales
Je pense que l'idée maitresse de ces qq lignes exprime le fait de ne pas se "noyer" ( les soldats Français ) dans une quelconque expérience d'Opex Africaines "colorées" qui n'ont de combat que le mot et ainsi perdre de vue que le métier des armes c'est aussi la sueur ET le sang, quelque chose dans le genre, quoi. Je trouve cet article assez dérangeant dans sa première partie, voir carrément déplacé. Pour tout dire il ne me plait pas du tout :mad: :mad: :mad:. Le premier passage appel à qq commentaires... ( pour le restant de l'article, rien à dire ). « Faire la guerre, la vraie.... » Je suppose que l'auteur de cet article connais son sujet, bien sur. Tout du moins peut-on penser qu’il appréhende à sa juste mesure ce que représente un contexte de guerre, avec son lot immuable de sang versé, de barbarie, du dépassement irréel du genre humain ( physique et moral ), de chagrin et de déception. Bref, ce que l’on peut trouver dans chaque conflit ( passé ou à venir ). Donc les militaires Français ont « joué » à la guéguerre dans les colonies, ils ont paradé avec brio tout de superbes armes vêtu face à des indigènes flanqués de sagaies ( sans 90 mm ) en bois et de machettes émoussées. A aucun moment ils n’ont risqué quoi que ce soit puisqu’en face il n’y avait rien, ou presque. Et ce presque a franchement peu de valeur … Pensez donc, des frais Officiers sortant de St Cyr nantis de bataillons de caporaux-chefs bardés d’armement high-tech dans des véhicules blindés guerroyant le chèche au vent des tribus autochtones montés de frêles petits chevaux de trait ! Allons-donc, tout au plus risquait-on un mauvais coup de baton ou un jet de salive aigrie ! =D De qui ce fou t-on ? Qui donc se permet de vulgariser les récentes années de combats menées par l’armée Française en Opex en les affublant du terme « sexy » ? Peut-on penser que le Tchad, la RCA et la cote d’Ivoire ( pour ne parler que d’eux ) n’ont été que des ballades de santé ? Pire encore, l’expérience acquise au cours de ces Opex n’aurait amené finalement ensuite qu’un sens du combat émoussé voir perverti ? En gros les qq camarades trop nombreux bléssés ou mort en missions là-bas ne l’auraient été qu’à cause de la maladie ou de la malchance ? J’en suis sur le cul ( ça y est, je deviens vulgaire ), les anciens de la feu 9eme DIMA qui ont tiré culasse au clair avec leur 105 mm dans les rangs de la charge Tchadienne lors de Manta doivent en blémir, les autres marsoins bombardé dans leur campement en C d’I aussi, que dire des artilleurs métro qui ont été bombardé au Tchad avec des bombes de 1500 kg mi-phosphore /mi-napalm, de ceux tombé ailleurs ( et les belges ?, tendons coupés à la machette sous casque bleu ), mon humeur m’en fait oublié pas mal d’autres encore. « Il faut sans cesse revenir à la formation tactique de base, à la manoeuvre des feux et des forces sur le terrain », ben voyons, on avait donc oublié tout cela aussi….Le clou du spectacle réside dans la phrase de fin, en mettant en parallèle la RCA et mourmelon. Franchement c’est du Vaudeville faisandé. Le rédacteur de ces lignes a une vision du métier des armes en général et de ses applications récentes dans un contexte géopolitique guerre froide/début des conflits de Peters en particulier pour le moins légère. Je fini par une note positive ; à la lumière donc de ses qq lignes je pense que finalement notre auteur a obtenu son diplôme avec mention pour aller séance tenante et sans aucune modération parader dans « Gala » et « Voici ». -
Pas mal tes extrès de vidéo Anzar, de la vraie identification ! =D Les deux premières me font penser indubitablement à qq chose de flottant....Si ce que l'on voit sur la première est bien un chassis surmonté d'une tourelle, je constate un tourelleau (?) trop développé en hauteur, genre shnorkel temps de paix... La deuxième photo ressemble à une caisse enchassé fans une sorte de coque, ou de sabot. Pour la troisième je dirai plutot une base de chassis type T-55, mais le plus étrange est qu'il manque des bras de balancier, pire encore dans les intervales là ou il n'y a pas de bras de balancier, les plans de joints des supports sont absent, comme si le flanc de caisse à cet endroit était lisse.... ...Des cibles flottantes ? =D =D =D ? on ne rie pas !
-
Il n’est pas envisageable de continuer ainsi sans s’arrêter qq instants sur la miniaturisation et parler donc des armes portatives…… Que Mauser, Berkut et qq autres me pardonnent les imprécisions techniques qu’il ne manquera pas de suivre, aussi je les enjoint à me corriger dès que l’occasion se présentera, thanks a lot ! =) La miniaturisation conduit d’abord les « artilleurs » à réaliser des engins relativement légers, que deux hommes peuvent porter. Il apparait que les pièces courtes, coulées en bronze ( alliage employé malgré son prix car il convient mieux à la fonderie ) sur le modèle des mortiers, exploite mal la force des gaz de l’explosion de la poudre. On s’avise donc de prolonger l’action de ces gaz employant un tube plus long. Pour obtenir un tel tube, les « artilleurs » enroulent au marteau, autour d’un mandrin, une longue feuille de métal ferreux et soudent les deux lèvres par martelage à chaud. Plus tard, dans les armes dites "à la Damas ", on enroule en hélice, autour d’un mandrin, un ruban de métal. On procède ensuite à un alésage ( on dit « forage ») avec un outil tournant. Le résultat est…ondulant =D. On en juge en observant, à l’intérieur du tube poli dirigé vers une lumière, les anneaux d’interférence. On ne comprend certes pas comment ces « anneaux » se forment, mais on sait qu’ils décèlent des irrégularités. On s’efforce d’y remédier par le « dressage » du tube, au marteau…. De telles armes, probablement en raison de leur forme très allongé, reçoivent le nom général de « couleuvrine » ou de « serpentine ». Elles projètent à l’origine des cailloux, plus tard des traits lourds ( les carreaux ) à pointe de fer et empennage de métal. Elles vont utiliser finalement des « balles » de fer ou de plomb ; et ce nom de « balle » s’est perpétué, pour ce petit projectile, même lorsqu’ils n’ont plus aucun rapport avec une sphère….. =D
-
I do Rochambeau, i do ! =) Pendant ce temps, notre Roger Bacon conseille de pousser l’épuration du salpêtre par dissolution et recristallisation fractionnée. Cette idée, maintenant, parait simple… Les proportions des constituants de la poudre noire varie aux environs de une partie de soufre, une partie de charbon de bois et de six parties de slapètre. « As , as, six » disent les chimistes. Les artilleurs ( économes ? ) ont tendance à mettre davantage de charbon de bois et arrivent à 1-2-6 pour la poudre à canon. On constate que les poudres à canon sont d’autant plus puissantes et régulières que le mélange est été plus pilonné. Le long travail de trituration nécessaire lasse les bras humains. On se décide donc à le demander à des moulins qui animent des pilons ou , plus tard, des meules, celles-ci donnant des mélanges plus homogènes avec moins de danger d’explosions accidentelles. Les Allemands ont une certaine avance dans ce domaine, car dès le milieu du XIVeme siècle, on signale des moulins à poudre à Ausbourg (1340 ) et à Spandau ( 1344 ). La France suit. On triture longuement du salpêtre épuré, du soufre et des charbons de bois léger comme le tilleul et le saule. Pour la poudre d’armes portatives, certains vont jusqu’au charbon de bois de chanvre. On a aussi des poudres à peu près régulières qui, dans un mortier, peuvent en explosant lancer dans des conditions à peu près prévisibles des projectiles qui sont normalement des pierres….. Il apparaît alors indispensable de réglementer et de surveiller les fabrication des poudres. En France, en 1354, un capitaine général des poudres existe, qui surveille et contrôle les « faiseurs et compositeurs » de poudre. Il relève de ce grand personnage au titre déjà désuet auquel est confié les contrôle de « l’artillerie », le grand maitre des arbalètriers. On peut donc admettre qu’on a, en France, des armes lançant des projectiles de combat avec de la poudre noire avant la fin du XII eme siècle. Comme je l’ai dit précédemment pour les engins à ressort, les armes à feu vont dès lors évoluer dans deux directions opposées, d’une part vers la miniaturisation et d’autre part vers la puissance….. =)
-
... Dans les pays d’Europe le nitrate de potassium n’apparaît, à l’état naturel, qu’en petites quantités sur les murs abrités de vielles habitations en sol humide ou il se forme par un phénomène analogue à celui qui donne la « neige de chine ». Le sous-sol de ces habitations étant imprégné de matières organiques plus ou moins fermentées, le nitrate de potasse qui se prépare ainsi dans l’humidité accompagne l’eau de dissolution qui remonte par capillarité dans les murs. Cette eau s’évapore à la surface de ces murs, le salpêtre y apparaît en taches blanchâtres formées de fines petites aiguilles. On peut le recueillir par brossage ou par lessivage des murs ou des matériaux de démolition. Mais pour deviner que cette poussière blanche a des propriétés intéressantes il faut d’abord avoir l’idée de la recueillir. Lorsque après l’avoir identifié au salpêtre on décide de ramasser, d’une façon ou d’une autre, cette matière qui tache les murs, on peut facilement en séparer les matières insolubles. Mais la poudre faite avec le salpêtre impur ainsi obtenu est inutilisable. Certains érudits estiment pouvoir préciser que , en Europe, le salpêtre est isolé pour la première fois dans le second quart du XIIIeme siècle. En fait que la poudre noire fut fabriqué en France vers le milieu de ce siècle. C’est l’époque des deux croisades, celle dont Louis IX fut l’inspirateur, le chef et finalement…la victime ( 1248 à 1254, puis 1270 ). Il n’y est pas question de poudre du coté des chrétiens. Les arabes, qui s’intéressent depuis longtemps à la poudre noire, ont observé qu’ils peuvent améliorer ce salpêtre impur en mettant , dans l’eau de dissolution, de la cendre de bois. On pense généralement que c’est un moyen de le débarrasser de ses impuretés. On peut penser plutôt ( avec Reinaud et Favé ; histoire de l’artillerie )que, avec les cendres de bois qui sont chargés en sels de potasse, il s’agit de transformer en nitrate de potasse les autres nitrates terreux mêlés au salpètre. ...
-
Je suis du mème avis Rochambeau =), cela dit si l’on connaît depuis fort longtemps les poudres de combustibles salpétrées, on ne peut parler de « poudre à canon » qu’à partie du moment ou l’explosion des ces poudres a été utilisé pour lancer des projectiles de guerre, c'est-à-dire, en France, vers la fin du XIIIeme siècle. En 1227, une ordonnance dr Louis IX accorde à l’hotel-Dieu « sauvegarde et exceptions pour…la recherche du salpêtre ». Peut-être la médecine de l’époque, qui utilisait, notamment contre la lèpre, ce sel rare en France, voulait-elle se le préserver ; peut-être les pharmaciens de l’Hôtel-Dieu sont-ils les seuls « chimistes » capables d’épurer suffisamment de salpêtre qui est utilisé pour la conservation des viandes et peut-être aussi dans des engins incendiaires ou des fusées…. le saint roi n’a certainement accordé ce privilège à l’Hotel-Dieu ni pour des feux d’artifices ni pour des canons qui n’existent pas encore…. =D Deux grands professeurs de la mondialement célèbre université de Paris ont eu connaissance de la poudre noire ; Albert le Grand, mort en 1280 et Roger Bacon, un moine franciscain d’origine britannique que j’ai déjà nommé il y a qq lignes. Les premiers écrits connus de celui-ci concernant cette poudre datent de 1248. Ils n’en ont pas dit grand-chose, et rien de permet de penser qu’ils en aient connu l’usage comme poudre à canon. Lorédan Larchey, ( origine de l’artillerie Française, 1863 ), étudie ce que fut l’utilisation de la poudre à canon en France dans une période courte bine choisie : 1324-1354. Il cite quelques faits précis et précieux, d’où il résulte clairement que des armes à feu existe alors en France depuis qq temps. « Mais la période traité est si obscure… » écrit-il…. En France, le charbon de bois est un produit courant, si courant qu’on ne le trouve généralement pas dans les comptes d’achats destinés à faire de la poudre à canon ; encore faut-il partir de bois légers. Le soufre lui n’est pas rare, il vient normalement des solfatares d’Italie. Il est raffiné, fondu et cristallisé. La condition de toute fabrication de poudre à canon est donc le salpêtre suffisamment pur. Sacré salpètre, on y revient… :lol:
-
oups, toutes mes excuses, c'est pas trois mais deux qu'il fallait lire..... =D Je n'ai pas dit que c'était absurde cador, je parle d'un "axe de progression", de quelque chose qui est en étude, à l'état de projets mais qui bute avec l'état de la technologie sur étagère actuelle dans ce domaine.