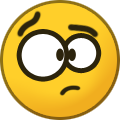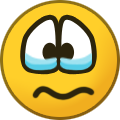-
Compteur de contenus
25 479 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Italie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://thediplomat.com/2020/10/demystifying-chinas-role-in-italys-port-of-trieste/ (15 octobre 2020) Fin septembre 2020, la société allemande Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a conclu un accord avec le port de Trieste, dans le nord de l'Italie, pour investir dans le développement de la plate-forme logistique du port. L'investissement comprend l'acquisition par HHLA de 50,1 % des parts de la plate-forme, le reste appartenant à Francesco Parisi S.p.A. (environ 23 %) et à ICOP (22 %), tandis que les parts restantes seront détenues par l'Interporto di Bologna. En Europe, et à Washington également, cette initiative a été bien accueillie car elle dissipe les fantômes des investissements chinois et les risques qu'ils auraient pu impliquer. En mars 2019, le port de Trieste a été parmi les signataires du protocole d'accord entre l'Italie et la République populaire de Chine dans le cadre de la nouvelle route de la soie (BRI). L'accord signé par le port de Trieste avec la China Communications Construction Company (CCCC) n'était guère plus qu'une déclaration d'intention et de bonne volonté pour le développement des relations futures entre les entités. Néanmoins, le protocole d'entente de mars 2019 a ouvert la voie à un protocole d'entente bilatéral plus spécifique, et dans une certaine mesure pragmatique, entre le port de Trieste et la CCCC, qui a été signé à Shanghai en novembre 2019. Ce dernier protocole d'accord prévoyait trois domaines de collaboration entre l'autorité du port de Trieste et la CCCC : un en Italie, un en Chine et un dans les pays tiers. Malgré la signature du deuxième protocole d'accord et le ton enthousiaste des parties concernées - qui a parfois provoqué des malentendus dans le public quant à la taille et à la portée de l'accord - le contenu avait des objectifs très limités et précis, dont aucun ne prévoyait la gestion, et encore moins la propriété, du port de Trieste par la CCCC. Pourtant, tant après le protocole d'accord de mars 2019 que celui qui a suivi en novembre, on craignait qu'une situation similaire à celle du port du Pirée en Grèce ne se reproduise dans le port italien, ce qui entraînerait l'expansion de l'influence de la Chine dans la région. Ces craintes étaient le résultat de deux éléments : une mauvaise communication du côté italien sur le contenu réel de l'accord - contenu souvent gonflé par certains médias - et le climat de tensions qui s'est développé au fil des ans autour des investissements chinois dans les projets d'infrastructure. -
https://capx.co/the-mods-procurement-disaster-is-tanking-the-british-army/ (30 septembre 2020) Depuis le milieu des années 2000, il est évident que le char de combat principal de l'armée, le Challenger 2, n'est pas efficace contre les blindages modernes. Un nouveau canon est nécessaire, qui à son tour nécessite une tourelle redessinée pour accueillir de nouvelles munitions. Des crises budgétaires interminables et des désaccords internes sur l'ampleur de la mise à niveau nécessaire ont fait perdre les douze dernières années. Les besoins d'une nouvelle tourelle, d'un canon plus puissant, d'une optique modernisée et (idéalement) d'un moteur plus puissant sont aujourd'hui évidents pour tout le monde, même pour l'armée : la provenance de l'argent pour payer tout cela l'est moins. Le Warrior Capability Sustainment Programme, conçu pour améliorer [les capacités des Warrior] et prolonger leur durée de vie jusqu'en 2040, est en cours depuis 2011, avec Lockheed Martin comme maître d'œuvre. À ce jour, 430 millions de livres sterling ont été dépensés pour les travaux de conception et d'évaluation. Pas un seul véhicule n'a été modernisé et le programme fonctionne avec plus de quatre ans de retard. Les coûts de production réels sont estimés à 800 millions de livres sterling supplémentaires. Même si le programme se poursuit - ce qui ne devrait probablement pas être le cas à ce stade - les problèmes liés aux coques vieillissantes et peu fiables et à un moteur sous-puissant persisteront. Dans une récente soumission à la Commission de défense, Lockheed a attribué le retard à l'évolution des besoins de l'armée (ce qui n'est que trop crédible, étant donné l'indécision de l'armée sur Challenger 2) et aux problèmes d'adaptation du nouveau canon choisi par l'armée aux anciens véhicules. Pourtant, même les catastrophes du Challenger et du Warrior font pâle figure en comparaison de la quête sans fin de l'armée pour des véhicules de poids moyen. Les difficultés de l'armée de terre à définir et à mettre en œuvre ses propres exigences en matière de véhicules de poids moyen ont consommé la plus grande partie de deux décennies et demie, au moins un milliard en coûts directs, et plusieurs milliards de plus en coûts indirects (comme l'achat précipité de véhicules de série résistants aux mines pour les opérations en Irak et en Afghanistan). Une soupe alphabétique de programmes - MRAV, TRACER, FRES - a permis de mettre en service un grand total de zéro véhicule. Étonnamment, l'histoire semble se terminer avec l'achat final - des années plus tard que nécessaire - d'un véhicule, le Boxer 8×8, que l'armée avait rejeté à deux reprises auparavant.
-

Chine
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Beijing-Diary/Confucius-Institutes-face-pushback-toward-China-s-gates - 12 octobre - "Les journalistes étrangers ne sont-ils pas autorisés à entrer dans ce parc ?" ai-je demandé. Il m'a répondu poliment : "Ce n'est pas qu'ils ne soient pas autorisés à entrer. Mais comme le parc Sun Yat Sen appartient au district de Tiananmen, ils doivent s'adresser à la direction". Je n'avais jamais entendu parler d'une telle règle, mais il était inutile de discuter. J'ai rendu le billet de 3 yuans (45 cents) et j'ai renoncé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les "règles" limitant les activités des journalistes étrangers ont insidieusement augmenté depuis l'épidémie de coronavirus qui a débuté au début de l'année. - 5 octobre - Vendredi matin dernier, [la Commission centrale d'inspection disciplinaire] a publié une déclaration commune avec la Commission nationale de surveillance annonçant que Dong Hong faisait l'objet d'une enquête pour "graves infractions disciplinaires". Dong a déjà été vice-ministre au sein d'une "équipe centrale d'inspection", une équipe spéciale qui réprime les fautes professionnelles. L'annonce qu'il faisait lui-même l'objet d'une enquête est intervenue au beau milieu de la série de huit fêtes nationales chinoises. Lorsque j'ai vérifié les antécédents de Dong sur Baidu, le moteur de recherche a donné des résultats inattendus. Après l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti à l'automne 2012, Wang a pris la tête de la Commission centrale d'inspection disciplinaire pour mener la campagne anti-corruption du dirigeant. Dong a de nouveau rejoint la commission pour soutenir Wang, qui est également devenu membre du comité permanent du Politburo, le principal organe décisionnel du parti, auquel il a siégé jusqu'en 2017. Dong était clairement l'un des plus proches collaborateurs de Wang. Mais il est inhabituel que la "proximité" politique d'une personne avec un certain membre du Comité permanent du Politburo figure de manière aussi évidente dans son CV. La biographie de Dong indique qu'il a "accompagné" Wang Qishan chaque fois que l'actuel vice-président chinois a été nommé à des postes clés, comme celui de vice-gouverneur de la province de Guangdong et de maire de Pékin à la fin des années 1990 et dans les années 2000. Fin septembre, Ren Zhiqiang, un éminent entrepreneur qui serait un ami de Wang depuis le collège, a été condamné à 18 ans de prison pour des accusations telles que la corruption. Nombreux sont ceux qui pensent que l'histoire ne s'arrête pas là. Ren, qui s'est fait connaître par son franc-parler, avait été arrêté en mars après avoir publié un article critiquant la réaction de Xi à l'épidémie de coronavirus. -

Taiwan
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Kiriyama dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3106082/taiwan-denounces-mainland-brutal-and-irrational-actions-after Harry Tseng Ho-jen, le vice-ministre des affaires étrangères de Taiwan, a déclaré lundi au Yuan législatif que deux membres de l'ambassade de Chine aux Fidji avaient tenté, le 8 octobre, de pénétrer de force dans une réception organisée par le bureau de représentation taïwanais à Suva, la capitale des Fidji, et de prendre des photos des participants. Les diplomates du continent se sont heurtés physiquement à un membre du personnel taïwanais lors de l'événement au Grand Pacific Hotel, qui a tenté de les arrêter et a ensuite été soigné à l'hôpital pour une commotion cérébrale, selon l'agence de presse taïwanaise Central News Agency. -

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Suga en visite au Vietnam : https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101900118&g=pol Le Premier ministre Suga a déclaré lors de la réunion qu'il était "sérieusement préoccupé par les tentatives de modifier unilatéralement le statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale, et qu'il continuerait à travailler avec le Vietnam" en gardant la Chine à l'esprit. Le Premier ministre Phuc a abondé dans le même sens, en déclarant : "Nous partageons de sérieuses préoccupations". L'accord sur les équipements de défense et le transfert de technologie en vigueur permet au Japon d'exporter des équipements de défense vers d'autres pays. Le Japon est déjà signataire d'accords avec neuf autres pays et le Vietnam est le troisième pays d'Asie, après les Philippines et la Malaisie. -

Inde : politique intérieure et internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Pour qu'il y ait une démocratie, il faut un peuple unique. Lorsque plusieurs peuples sont réunis dans un assemblage artificiel, on sort du modèle type de la démocratie. Lorsque des citoyens se déterminent non pas en fonction de l'intérêt général, mais en fonction de l'intérêt d'un groupe, on parle de "factionalisme". C'est le principal argument des anti-fédéralistes. Les Pères fondateurs de la Constitution Américaine le tenaient également pour un grave danger, et le Federalist Paper N°10, rédigé par James Madison, tente d'y apporter des réponses : https://en.wikipedia.org/wiki/Federalist_No._10 Les États-Unis ont eu besoin de la guerre de sécession pour se fédérer. Or la guerre civile n'est pas la démocratie. -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.bbc.com/news/world-europe-545486330 (18 octobre 2020) Leurs majestés royales des Pays-Bas font marche arrière après seulement un jour de vacances en Grèce, après que de fins observateurs aient fait observer que le Premier Ministre vient juste de recommander "d'éviter les déplacement non nécessaires". -

Bolivie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Borisdedante dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lefigaro.fr/international/bolivie-arce-le-dauphin-de-morales-remporte-la-presidentielle-des-le-1er-tour-20201019 Arce, le dauphin de Morales, remporte la présidentielle dès le 1er tour. L'ancien ministre bolivien de l'Économie devance de plus de 20 points son principal rival, le centriste Carlos Mesa.- 159 réponses
-
- 4
-

-

-

-
- bolivie
- amérique du sud
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

La Francophonie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Carl dans Politique etrangère / Relations internationales
Il ne faut surtout pas croire ce que dit la vidéo ci-dessus. La langue allemande est une langue de contrastes, permettant d'exprimer à la fois la dureté quand c'est nécessaire mais aussi une très grande douceur. D'ailleurs le mot pour dire "papillon", à savoir "schmetterling", quand on le prononce de façon non caricaturale, est très doux, comme un chuchotement. Il faut écouter des lieder de Schubert, des cantates de Bach, des opéras de Mozart pour s'en rendre compte. La musique, l'art a besoin de cette force du contraste pour être intéressant. Sinon on s'ennuie. -

Inde : politique intérieure et internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Un rassemblement qui a même englobé la Birmanie - jusqu'en 1937 - et où l'on peut voir l'origine des troubles intercommunautaires actuels de l'État d'Arakan. -

Politique étrangère des USA
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/joe-biden-doesnt-have-a-perfect-foreign-policy-record-but-unlike-trump-hes-learned-from-his-mistakes/2020/09/27/62b417f6-fe77-11ea-9ceb-061d646d9c67_story.html (27 septembre 2020) Alors que Biden est "un homme intègre" qu'il est "impossible de ne pas aimer", [Robert] Gates a écrit dans ses mémoires publiées en 2014, "il a eu tort sur presque toutes les grandes questions de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies". Gates ne détaille pas son accusation, mais elle n'est pas difficile à reconstituer. Biden a voté contre la campagne militaire américaine réussie qui a expulsé Saddam Hussein du Koweït en 1991. En Irak, il a compilé un trio de gaffes : Il a voté pour l'invasion de 2003, s'est opposé à la "poussée" (surge) de 2007 qui a sauvé la mission d'un désastre total et a supervisé le retrait prématuré en 2011 des dernières troupes américaines, ce qui a ouvert la voie à l'État islamique. Biden s'est opposé à la décision d'Obama de renforcer les troupes américaines en Afghanistan en 2009, proposant que la mission se limite plutôt à la lutte contre le terrorisme. Mais selon Gates, il a levé la main contre la plus importante opération antiterroriste de ces dernières années, le raid des forces spéciales de 2011 qui a tué Oussama Ben Laden. (M. Biden a déclaré qu'il avait ensuite encouragé Obama à aller de l'avant). https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/232 (18 octobre 2020) Matthias Fekl : Enfin, quel sera l’impact sur l’Europe ? La solidarité assez forte qui est née dans l’opposition à Trump se prolongera-t-elle si c’est Biden qui est élu ? Est-ce que de meilleures relations entre les Etats-Unis et l’Allemagne affaibliront le moteur franco-allemand ? Nicole Gnesotto : Les Européens sont toujours divisés, et tout porte à croire que Biden les divisera encore davantage. Je pense que l’élection de Biden est souhaitable, mais que ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Européens : les USA feront le forcing pour qu’on les suive sur la menace chinoise, en particulier sur les questions technologiques, et réduiront à néant les efforts d’identité politique européenne. -

Thaïlande
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Eh bien je dois vous avouer que cette image m'inspire... quelques comparaisons qui ne sont point raison. Le roi thaïlandais Vajiralongkorn <=> le dernier empereur chinois Le mouvement thaïlandais de protestation contre la monarchie <=> la révolution chinoise de 1911 et le mouvement chinois du 4 mai 1919 Le général Prayut Chan-o-cha <=> Yuan Shi Kai Les États-Unis tirent les ficelles des révolutions de couleur par l'intermédiaire du National Endowment for Democracy (NED) <=> L'Union Soviétique tire les ficelles du Parti Communiste Chinois via le Komintern Les militants pro-démocratie font des voyages à Washington <=> Chou En Lai, Deng Xiao Ping, Chiang Ching-kuo (fils de Chiang Kai-Shek) font des séjours à Moscou. -

Inde : politique intérieure et internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/29/narendra-modi-defie-les-musulmans-en-posant-la-premiere-pierre-d-un-temple-hindou-a-ayodhya_6047591_3210.html Est-ce un signe supplémentaire de la mise en œuvre de la suprématie hindoue et la fin d’un Etat laïque en Inde ? Le 5 août, le premier ministre indien, Narendra Modi, devrait poser lui-même, à Ayodhya, dans l’Uttar Pradesh, la première pierre d’un temple hindou, dont le projet de construction a divisé le pays et fait couler le sang pendant des décennies. Près de trois mille personnes, essentiellement des musulmans, sont mortes à cause du temple de Ram d’Ayodhya. Les hindous considèrent ce site comme le lieu de naissance du dieu Ram, un des sept avatars de Vishnou. Ils affirment qu’au XVIe siècle le fondateur de l’empire Mogol, Babur, y fit construire une mosquée sur les ruines du temple de Ram. En 1992, une foule de nationalistes hindous fanatiques avaient détruit la mosquée Babri et exigé la reconstruction du temple. Après des années de conflits, le 9 novembre 2019, la Cour suprême a tranché en faveur des hindous, autorisant l’édification du temple. Ce sera sa première visite à Ayodhya, mais le premier ministre comme son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), ont, depuis des années, fait du temple de Ram un symbole de l’identité indienne et une arme pour rassembler les hindous. La cérémonie de lancement du chantier sera retransmise en direct sur les chaînes de télévision. Seuls les « VIP » seront autorisés à y participer. Parmi les deux cents invités, Mohan Bhagwat, le chef du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), cette association des volontaires nationaux fondée en 1925 pour assurer la domination des hindous sur la nation indienne, ainsi que les représentants du Vishva Hindu Parishad (VHP-Conseil mondial hindou), une organisation d’extrême droite. Le chef du gouvernement de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, un moine nationaliste extrémiste, proche du premier ministre, a veillé personnellement aux préparatifs. Toute la galaxie nationaliste hindoue sera représentée pour assister à cet événement qualifié « de plus important de l’histoire de l’Inde indépendante ». -

Coronavirus - Covid 19
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Dominique Castoglia, épidémiologiste de maladie infectieuse et Christine Rouzioux, virologue étaient les invitées de C dans l'air du 5 octobre : https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1974303-emission-du-lundi-5-octobre-2020.html Donc je ne comprends pas comment on peut dire qu'il n'y a pas de virologues et d'épidémiologistes de maladies infectieuses dans les médias. Et qui va définir "les bonnes conclusions" ? Xi Jinping, j'imagine. En tout cas, merci Henri pour ce morceau d'anthologie d'"énergie positive". -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Ce qu'on appelle le "delta intérieur du Niger" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_intérieur_du_Niger Et qui a été aménagé par la colonisation sous le nom "d'office du Niger" pour y implanter le coton puis la canne à sucre, et maintenant le riz : source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_du_Niger -

La Francophonie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Carl dans Politique etrangère / Relations internationales
Source : https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/quand-gaulle-defendait-langue-francaise-dans-armees-224082 (18 septembre 2020) -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.dw.com/fr/plus-de-2000-déplacés-après-lattaque-de-farabougou-au-mali/a-55278690 (14 octobre 2020) Nous rapportions en début de semaine que des hommes armés avaient pris le contrôle du village de Farabougou au Mali, dans la région de Ségou. Ce mercredi, dans notre journal de 17hTU, le maire de la commune voisine de Sokolo faisait le point sur la situation. "Cela a créé un important flux de population, et les gens sont désormais dans notre commune", raconte Dramane Symbara. "Il y a plus de 300 ménages, ce qui fait plus de 2000 déplacés", indique le maire. -
http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2020/article.2020-10-06.4675201436 (6 octobre 2020) Les vieux partis politiques qui passent des années à recueillir trop peu de voix ne parviennent pas à mobiliser les générations, tandis que de nouveaux partis à thème unique voient le jour. Les constellations politiques changent en attendant de voir qui pourrait gagner un certain pouvoir. Geir Lippestad est connu comme l'avocat de la défense représentant le terroriste du 22 juillet à Oslo et Utøya. Il a également représenté le parti travailliste au conseil municipal d'Oslo. Il lance aujourd'hui le nouveau parti Sentrum. L'un de ses co-fondateurs est John Harald Bondevik, fils de l'ancien Premier ministre et leader du Parti démocrate-chrétien (KrF) Kjell Magne Bondevik. Jusqu'à présent, de nombreux membres du parti sont d'anciens membres du KrF issus de la gauche du parti. Lippestad est débordé par le lancement. Il ne veut rien dire sur les tendances possibles mais pense que quelque chose manque clairement lorsque les anciens partis ne parviennent pas à attirer des votes pendant des années. "100 000 personnes à mobilité réduite sont sans travail et cela se produit depuis de nombreuses années sans que personne ne fasse rien à ce sujet sur le plan politique. Nous pensons qu'il est nécessaire de créer un nouveau parti et nous avons recueilli une grande partie des 5 000 signatures physiques nécessaires pour aller incroyablement vite. Nous serons indépendants des blocs traditionnels de droite et de gauche, mais pour l'instant nous soutenons Jonas Gahr Støre (travailliste) en tant que nouveau Premier ministre de Norvège. Nous sommes maintenant un parti de centre-gauche", a déclaré M. Lippestad au Nordic Labour Journal. "Parmi les questions qui nous tiennent à cœur figurent le changement climatique et la lutte contre l'exclusion. C'est dans notre ADN. Nous parlons de globalité, et nous pensons qu'il faut inclure la politique industrielle, la propriété et la manière dont nous devrions investir en Norvège. Dans 15 ans, nous aurons une industrie différente de celle de l'exploration pétrolière. Nous devons assumer une responsabilité internationale, par exemple pour les réfugiés du camp de Moria", dit-il, et confirme que Sentrum est censé être un parti pro-UE. Un exemple de parti à thème unique qui a donné du piment à la politique traditionnelle de Bergen, la deuxième ville de Norvège, est le Mouvement populaire "Non à plus de péage" (FNB). Cesilie Tveit a été l'un des 11 membres élus au conseil municipal il y a un an. Le Mouvement populaire "Non à plus de péage" est devenu le deuxième plus grand groupe du conseil municipal de Bergen lors des élections municipales de 2019. Cesilie Tveit est l'un des 11 membres qui contribuent aujourd'hui à la gestion de la politique de Bergen. "Nous sommes un groupe de personnes adultes ayant une grande expérience de la vie professionnelle, et cela a été un avantage majeur. Nous siégeons dans différentes commissions et grâce à notre expérience professionnelle, nous pouvons apporter une contribution politique importante. Nous sommes donc plus qu'un parti à thème unique. Les comités bénéficient de nos expériences de la vie réelle, et l'administration et les autres politiciens sont très généreux dans mon expérience. Ils voient que nous sommes capables et désireux d'améliorer notre ville", dit-elle, mais refuse de placer fermement le parti à droite ou à gauche. Nous sommes dans le "centre". Nous coopérons avec plusieurs partis pour obtenir des votes sur une question, et nous avons au moins autant de questions du côté rouge [gauche] que du côté bleu [conservateur]. Les enjeux sont plus importants que le soutien à un bloc politique ou à un autre. Nous pouvons créer un parti parce que la démocratie fonctionne".
-
Est-ce que ce n'est pas une grande constante anthropologique, que la caste supérieure s'autoproclame "pure", "sans péché", et relègue les fonctions réputées impures, pourtant nécessaires à la société, aux castes inférieures ? Je pense aux Burakumin japonais, aux "intouchables" indiens, etc... Dans la division mondiale du travail, les pays les plus riches s'arrangent ainsi pour que les activités carbonées (le "péché" dans la religion-idéologie des élites mondialisées actuelle) soient prises en charges par d'autres pays, en "s'en lavant les mains".
-
https://reporterre.net/Le-modele-ecolo-scandinave-n-existe-pas (12 octobre 2020) Les médias parlent de « dissonance cognitive » et de « schizophrénie ». La Norvège est le plus gros producteur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest : « Le secteur [pétrolier] emploie 6 % de la population active, et représente presque la moitié des exportations. » Le décalage entre discours et réalité est illustré par l’affirmation d’Ola Elvestuen : « Nous sommes responsables du CO2 que nous émettons, pas de celui généré par nos exportations. »
-

Thaïlande
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
http://www.gavroche-thailande.com/actualites/politique/113196-tha-lande-politique-bangkok-capitale-d-un-royaume-sous-haute-tension-politique (16 octobre 2020) Malgré la proclamation de l'état d'urgence, les manifestants ont rempli une grande partie de la route Ratchadamri après avoir été bloqués par la police pour se rassembler à l'intersection de Ratchaprasong. L'estimation de 5 000 participants provient de deux grands sites d'information mais n'est pas officielle. En milieu de soirée, vers 21h, la manifestation ne montrait aucun signe de dispersion. La manifestation de jeudi à l'intersection de Ratchaprasong défie l'état d'urgence qui stipule que pas plus de 5 personnes ne peuvent se réunir. Les manifestants affichaient ouvertement le salut à trois doigts, le symbole de défi de ces manifestations, et . criaient "libérez nos amis" et "à bas la dictature" aux policiers présents. Le fait que la situation en Thaïlande ait été examinée récemment par le parlement allemand, et par les autorités de Bavière où le souverain se rend régulièrement, complique aussi la donne. Le gouvernement d'Angela Merkel a en effet averti la Thaïlande que le roi thaïlandais devrait cesser de mener des affaires d'État depuis le sol allemand. Maria Adebahr, porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement avait souligné à plusieurs reprises à l'ambassadeur de Thaïlande à Berlin que "les affaires étrangères de l'État ne devraient pas être poursuivies depuis le sol allemand". "Nous avons fait connaître notre position très clairement", a-t-elle déclaré. Interrogé la semaine dernière sur la réaction de l'Allemagne face à l'engagement du roi dans la politique intérieure depuis le sol allemand, le ministre des affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré "Nous contrecarrerons toujours clairement les efforts des hôtes de notre pays pour mener les affaires de l'État depuis notre pays". Il répondait à une question de Frithjof Schmidt, député des Verts de l'opposition, qui demandait pourquoi le gouvernement allemand permettait depuis des mois au roi de s'engager dans la politique intérieure depuis la Bavière. La porte-parole du ministère des affaires étrangères, a déclaré que les autorités thaïlandaises avaient assuré à Berlin que "c'est le Premier ministre qui dirige les affaires du gouvernement, et le roi de Thaïlande, en tant que chef d'une monarchie constitutionnelle, ce qu'est la Thaïlande, vit en Allemagne à titre privé". https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-protesters-set-to-reconverge-on-Bangkok-commercial-hub (16 octobre 2020) Certaines chaînes de télévision par câble ont été partiellement censurées, notamment la station pro-démocratie thaïlandaise VoiceTV et la chaîne publique britannique BBC. La chaîne publique japonaise NHK Premium a été interrompue lorsqu'elle a diffusé un segment sur les manifestations thaïlandaises lors d'un journal télévisé du mercredi soir. Le reportage et l'interruption ont eu lieu avant la publication du décret. L'accès Internet à Change.org, qui aide les utilisateurs à créer des pétitions, a également été coupé lorsque la plateforme a lancé une campagne de collecte de signatures pour inciter l'Allemagne à déclarer le roi Maha Vajiralongkorn persona non grata. Le roi, qui se trouve actuellement en Thaïlande et devrait y rester pendant plusieurs semaines, a passé la plus grande partie de son règne en Allemagne. -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
http://www.opex360.com/2020/04/08/un-avion-dattaque-leger-a-29-super-tucano-de-la-force-aerienne-malienne-sest-ecrase-pres-de-sevare/ (8 avril 2020) Les capacités d’attaque au sol de la force aérienne malienne ne reposent donc plus que sur 3 A-29 Super Tucano [on ignore quand les deux derniers exemplaires commandés seront livrés] ainsi que sur quatre hélicoptère Mi-24/35M cédés par la Russie [deux autres étaient attendus en 2019]. -

USA, tendances et problématiques de long terme
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.seattlemet.com/health-and-wellness/2014/03/the-end-of-the-nightmare-march-2014 (1er mars 2014) Histoire de la découverte d'un médicament contre certaines formes de syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Le "Groupe d'anciens combattants afro-américains de l'État de Washington" (...) a commencé comme groupe de soutien aux vétérans du Vietnam et s'est depuis développé pour inclure des vétérans des guerres précédentes et ultérieures : Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, guerre du Golfe et les guerres en Irak et en Afghanistan. Fin 1994, le Veterans Affairs Puget Sound Health Care System, alors connu sous le nom de Seattle VA Medical Center, a officiellement reconnu le précieux travail du groupe des vétérans afro-américains et leur a attribué un conseiller officiel, son nouveau chef de psychiatrie, le Dr Murray Raskind, qui à l'époque était surtout connu pour ses recherches sur la maladie d'Alzheimer. Les vétérans du Vietnam qu'il voyait chaque mercredi essayaient - et échouaient - à oublier leurs propres horreurs de guerre depuis si longtemps que beaucoup d'entre eux étaient non seulement épuisés mais suicidaires. La plupart d'entre eux buvaient beaucoup. L'alcool était la seule drogue qui pouvait les endormir de manière fiable. Malheureusement, cela ne les empêchait pas d'être réveillés par des cauchemars de combat. Et ce n'était pas tant le fait de s'endormir qui posait problème ; c'était le fait qu'une fois endormi, ils se retrouvaient dans un cauchemar de traumatisme, qui les réveillait en sueur, anxieux, devant vérifier s'il y avait des menaces dans l'environnement. Ils ont décrit cela comme une tempête d'adrénaline". La recherche de Raskind sur la maladie d'Alzheimer s'était concentrée sur le système d'adrénaline du cerveau. "Ou plus techniquement, ce que fait le système de noradrénaline du cerveau dans la maladie d'Alzheimer et il m'a semblé qu'il devrait peut-être être exploré dans le cadre du SSPT également." Comme le dit Raskind, "le système de noradrénaline du cerveau a pour fonction de vous rendre attentif aux nouveaux stimuli présents dans l'environnement. Bien sûr, lorsque vous êtes en situation de combat, c'est le premier moyen de vous garder en vie, vous et vos amis, surtout dans des guerres comme le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan, "lorsque les embuscades, qu'elles soient tendues par des personnes ou des engins explosifs improvisés, sont la principale situation de combat". Le problème, explique Raskind, est que, bien qu'il soit utile d'avoir vos systèmes de noradrénaline et d'adrénaline à un niveau de sensibilité élevé lorsque vous êtes au combat, il est très difficile de les remettre à zéro. Ce que les vétérans lui ont fait comprendre, c'est que, surtout la nuit, lorsqu'ils avaient désespérément besoin de repos, leur noradrénaline restait active. Alors qu'il réfléchissait à l'idée que de tels cauchemars puissent être déclenchés par une tempête d'adrénaline, Raskind, qui a aujourd'hui 71 ans, s'est mis à penser aux médicaments qui avaient été introduits pour combattre l'hypertension lorsqu'il était un très jeune médecin à New York. Au milieu des années 1990, ces médicaments, qui avaient alors plus de 20 ans, faisaient baisser la pression sanguine en bloquant les effets de la noradrénaline dans le cerveau. Il n'y a que deux récepteurs de la noradrénaline dans le cerveau : le récepteur bêta et le récepteur alpha-1. Raskind savait que l'un de ces médicaments, le propranolol, aidait les personnes souffrant d'anxiété liée à la prise de parole en public ou les musiciens souffrant d'anxiété liée à la performance en bloquant le récepteur bêta. Il a donc donné une dose d'essai au vétéran qui l'inquiétait le plus. Une semaine plus tard, le vétéran est revenu et a dit : "Doc, nous allons dans la mauvaise direction, mes cauchemars sont encore pires". "Mais d'après mon travail sur la maladie d'Alzheimer, [je savais] qu'il y avait deux récepteurs pour la noradrénaline, et qu'ils avaient des effets opposés sur certains systèmes cérébraux. Je me suis dit : "C'est peu probable, mais si le propranolol aggrave les cauchemars, peut-être que si nous pouvons trouver quelque chose qui bloque l'alpha-1, il aura l'effet inverse et améliorera les cauchemars, ce qui serait une bonne chose". Raskind a donc feuilleté à nouveau le Physician's Desk Reference de 2 500 pages et a trouvé un seul et unique bloqueur alpha-1 de la norépinéphrine : un médicament appelé prazosine. Il a d'abord été commercialisé sous le nom de Minipress pour l'hypertension par Pfizer dans les années 1970, et est maintenant un médicament générique bon marché dont le brevet a expiré depuis longtemps. Il a recoupé avec d'autres manuels de pharmacologie pour confirmer qu'il franchissait la barrière hémato-encéphalique. C'était le cas. Il a convaincu le vétéran d'essayer une dose progressive de prazosine, en l'augmentant lentement jusqu'à cinq milligrammes. Après trois semaines, dit Raskind, le vétéran "se lève, me serre la main et me dit : "C'est la première nuit que je dors depuis le Nam". "C'était un homme qui avait pris cinq médicaments différents et buvait un cinquième et demi de vodka par nuit simplement pour s'endormir pendant quelques heures. Mais Raskind a décidé d'essayer la prazosine avec un deuxième vétéran du groupe des vétérans afro-américains, un survivant du siège de Khe Sanh en 1968. Il a décrit des horreurs nocturnes aussi vivantes qu'une cassette vidéo implantée dans sa tête, dans laquelle des soldats nord-vietnamiens surgissaient de tunnels, et c'était sa faute car il avait placé les mines antipersonnel Claymore dans la mauvaise direction et lui et ses copains étaient sur le point d'être débordés. Ce deuxième vétéran, devenu si irritable par manque de sommeil que ses collègues de l'usine Boeing 767 d'Everett lui avaient construit "une petite cahute pour le tenir à l'écart de tout le monde", a fait état de résultats tout aussi stupéfiants. Il a commencé à dormir profondément pour la première fois depuis 30 ans. Raskind était excité. Il a décidé de mener une étude contrôlée par placebo. Mais comme la prazosine n'était plus brevetée - ce qui signifie qu'elle était bon marché et générique, et qu'il n'y avait pas d'argent à gagner - aucun fabricant de produits pharmaceutiques n'était prêt à soutenir un essai de médicament. De nombreux évaluateurs de subventions étaient également sceptiques : Pourquoi cet intérêt soudain pour une utilisation non conforme à l'étiquette d'un très vieux médicament ? Trois fois, les demandes de subvention de Raskind ont été rejetées. Finalement, en 2000, il a réuni assez d'argent pour mener une modeste étude. "La VA n'est qu'une organisation conservatrice", a déclaré Raskind. Mais le problème le plus important et le plus intéressant est la façon dont la Federal Drug Administration approuve les médicaments. "Aucun médicament générique ne sera jamais approuvé par la FDA pour quoi que ce soit", a expliqué Raskind, "parce que le processus d'approbation de la FDA ne s'applique qu'aux nouveaux médicaments encore sous brevet que la société pharmacologique est prête à investir dans de très grands essais cliniques multisites pour générer les données nécessaires à présenter à la FDA". Lorsqu'un médicament générique peu coûteux, prescrit sans étiquette, fonctionne comme la prazosine, les gens ne l'apprennent que par le bouche à oreille. "Vous ne verrez jamais de publicité télévisée pour la prazosine", a déclaré Raskind. Au début des années 2000, Raskind, [son patient] Banks, certains des autres vétérans afro-américains et leurs succès avec la prazosine ont été présentés dans les journaux locaux. Ce qui est frappant, c'est le peu de mention des guerres en Irak et en Afghanistan : aucune dans l'article du Seattle P-I, paru le 9 septembre 2002, pendant la période précédant l'invasion, et seulement une vague référence générale à la "nouvelle génération de soldats revenant d'Irak" dans l'article du Seattle Times, paru le 29 décembre 2003, alors que les guerres étaient bien engagées. Au fur et à mesure que ces guerres s'intensifiaient au cours des années suivantes, de plus en plus de jeunes patients souffrant de SSPT étaient adressés à Raskind et au Dr Elaine R. Peskind, sa partenaire dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et le SSPT. Tous deux ont entamé une décennie mouvementée de va-et-vient entre la VA à Seattle et la base conjointe Lewis-McChord au sud de Tacoma. L'écrasement de leur charge de patients a rendu encore plus difficile la diffusion de la prazosine, surtout sans le soutien de l'industrie pharmaceutique ou de la VA, qui était, avant 2010, notoirement réticente à diagnostiquer le SSPT. (Après un certain nombre de scandales en 2008 et 2009, au cours desquels les médecins de la VA ont été contraints de modifier les diagnostics de SSPT, qui peuvent donner lieu à des prestations à vie coûteuses, pour passer à des diagnostics comme le "trouble de la personnalité", qui implique une affection préexistante pour laquelle la VA n'aurait pas à payer, les règles exigeant des vétérans qu'ils documentent les traumatismes spécifiques qui ont déclenché les symptômes ont été abandonnées en 2010. Désormais, les vétérans doivent uniquement prouver qu'ils ont servi dans une zone de guerre et qu'ils avaient des fonctions qui auraient pu conduire à la crise qui a causé leur SSPT). "Les cauchemars de traumatismes sont comme des cassettes vidéo. Ils sont la ré-expérience exacte du traumatisme tel qu'il s'est produit. Ils n'ont pas d'éléments fantastiques. Ils sont littéraux, visuels, et ils sont exactement comme l'expérience du traumatisme. (...) Les vétérans se réveillent souvent en sueur, le cœur battant et les vêtements de lit étant déchirés. Ils frappent souvent leur partenaire de lit, sans vraiment s'en rendre compte - et normalement, pendant un sommeil de rêve, vous devriez être paralysé, vous devriez avoir une paralysie du sommeil. Ils se lèvent, patrouillent le périmètre, vérifient toutes les portes, s'assurent qu'elles sont bien fermées, regardent à travers les stores, s'assurent qu'il n'y a personne dehors. Ils se lèveront et regarderont la télé ou feront autre chose. C'est donc vraiment très différent du sommeil de rêve normal. Il s'agit d'une interruption du processus normal de rêve, et non d'un rêve normal. Et il ne remplit pas la fonction réparatrice du rêve normal" [explique Elaine Peskind]. Au cours des années 2000, les succès de la prazosine ont commencé à se propager de la VA à la base conjointe Lewis-McChord (JBLM). En 2006, le colonel Kris Peterson, chef du service de psychiatrie du centre médical de l'armée Madigan, a accepté de faire équipe avec Raskind et Peskind pour planifier un projet de cinq ans qu'ils ont appelé l'Initiative de réduction des cauchemars, qui comprendrait des essais contrôlés par placebo de la prazosine chez les soldats en service actif. Tammy Williams, une assistante sociale du JBLM, a été chargée de recruter des candidats. En plus d'entrer en contact avec les médecins du Madigan, elle a parlé aux chefs de brigade et a accroché une banderole devant l'entrée de Madigan, avec les mots "Got nightmare ?" en gros caractères et un numéro de téléphone à appeler. Près de 400 soldats ont répondu à l'appel. Tout en reconnaissant que l'armée a l'habitude de stigmatiser les diagnostics de SSPT, Hill [lieutenant colonel Jeffrey Hill, chef adjoint du département de la santé comportementale de Madigan] maintient que les niveaux de commandement supérieurs sont maintenant très favorables au traitement de la santé mentale. Ils ont vu le prix que leurs troupes ont payé lorsque le SSPT n'est pas traité : orientation professionnelle compromise, sécurité mise en péril, stagnation de la carrière et problèmes familiaux. C'est pourquoi Hill a trouvé si satisfaisant de travailler sur l'étude de la prazosine. "C'est formidable de pouvoir voir les gens aller mieux", a déclaré Hill. "Le sommeil est une grande partie du traitement. Les autres symptômes s'améliorent tous avec le sommeil". Cette foi dans le pouvoir du sommeil est maintenant une pierre angulaire officielle de la politique de santé de l'armée. En septembre 2012, le général Patricia D. Horoho, chirurgien de l'armée américaine, a annoncé une nouvelle stratégie de soins de santé appelée "Triade de la performance", qui met l'accent sur le sommeil, l'activité et la nutrition. Bien que cela puisse sembler évident, dans le monde militaire - où le manque de sommeil est souvent considéré comme une partie (ou une conséquence) du travail - c'est un grand pas en avant. En septembre dernier, Peterson, Raskind et Peskind ont publié les résultats de leur essai sur la prazosine dans l'American Journal of Psychiatry. Il s'agissait de la première étude jamais menée à bien sur l'effet d'un médicament spécifique sur un trouble du comportement chez les militaires en service actif. "La prazosine", conclut l'article, "est efficace pour le SSPT lié au combat avec cauchemars de traumatisme chez les soldats en service actif, et les bénéfices sont cliniquement significatifs". Les auteurs mettent en garde contre le fait que la prazosine ne "guérit" pas le SSPT mais suggèrent qu'il y a peut-être un espoir de combiner la pharmacothérapie et la thérapie par la parole. En 2012, Raskind a reçu le prix John Blair Barnwell, la plus haute distinction de la VA pour la recherche scientifique clinique, "pour ses travaux sur les voies biochimiques impliquées dans le stress post-traumatique, la maladie d'Alzheimer et l'alcoolisme. En particulier, il a été cité pour avoir été le fer de lance de l'utilisation d'un médicament générique peu coûteux appelé prazosine pour traiter les cauchemars du syndrome de stress post-traumatique". En octobre 2012, Raskind, Peskind et leurs collègues ont reçu le prix du commandant de l'armée américaine pour le service public - la quatrième plus haute distinction que l'armée puisse accorder à un civil - pour une recherche innovante dans le traitement des soldats de la base conjointe Lewis-McChord. La plupart des 23 millions d'anciens combattants aux États-Unis reçoivent des soins de santé en dehors de l'AV. Mais selon M. Raskind, environ 600 000 vétérans du système de la VA ont un diagnostic de SSPT dans leur dossier. La majorité des survivants du SSPT n'ont pas de cauchemars de traumatismes invalidants, mais parmi ceux qui sont traités par la VA, Raskind dit qu'une estimation prudente de ceux qui en ont est d'environ 100 000. Bien que seulement 17% des vétérans du système de la VA diagnostiqués comme souffrant de SSPT prennent de la prazosine, Raskind dit que c'est peut-être finalement le bon pourcentage, "parce que la prazosine fonctionne pour ceux qui ont cette affreuse tempête d'adrénaline associée aux cauchemars et à l'hyperexcitation diurne. Et pour ceux qui n'en souffrent pas, le médicament n'est pas particulièrement utile". -

Opérations au Mali
Wallaby a répondu à un(e) sujet de pascal dans Politique etrangère / Relations internationales
Le Parisien parle de diverses versions des faits autorisant à comprendre que les "renforts" seraient "tombés dans une embuscade" "dont l'arrivée a « coïncidé » avec l'attaque [de civils]", ce qui semble dire qu'ils n'avaient pas l'initiative. Le même article dit que les véhicules ennemis ont été "détruits par l'aviation militaire". Je ne savais pas que le Mali avait une aviation militaire. Si tel est le cas, c'est la première fois que j'en entends parler depuis 2012, où le Mali engageait des pilotes mercenaires ukrainiens. Est-il tiré par les cheveux d'imaginer qu'il s'agit de l'aviation française ? https://www.leparisien.fr/international/mali-19-personnes-tuees-dans-des-deux-embuscades-successives-14-10-2020-8402421.php Vers 1 heure du matin, un poste militaire à Sokoura, dans le stratégique cercle de Bankass, près de la frontière burkinabée, « a été attaqué par des individus armés non identifiés » selon le ministère de la Défense. Neuf soldats maliens ont été tués. Un renfort dépêché sur les lieux « est à son tour tombé dans une embuscade au niveau du pont de la localité de Paroukou », selon le ministère. Là, deux autres soldats ont perdu la vie. Dans les échanges de feu, treize assaillants ont été abattus et deux de leurs véhicules détruits par l'aviation militaire. Douze civils, des forains se rendant à la foire hebdomadaire de Bankas, ont été tués au même endroit dans des circonstances encore floues. Selon une source policière interrogée par l'AFP, les forains « suivaient le renfort de l'armée », se croyant protégés, et ont ensuite été pris pour cibles par des assaillants. Mais selon un représentant de l'Etat dans la région, s'exprimant sous couvert d'anonymat, le véhicule transportant les civils « se trouvait en première position », devant les renforts militaires, dont l'arrivée a « coïncidé » avec l'attaque. Parmi les douze civils figuraient deux femmes et un enfant. L'armée a également fait état de dix blessés et des disparus lors de la deuxième attaque. https://minusma.unmissions.org/communiqué-de-presse-mine-un-casque-bleu-tué-dans-les-environs-de-kidal (15 octobre 2020) Aujourd’hui vers 13h30, un véhicule de la Force de la MINUSMA a heurté une mine ou un engin explosif, à environ 50 km de la ville de Kidal. L'explosion a entraîné la mort d’un Casque bleu. Un autre, grièvement blessé, a été évacué par la MINUSMA pour recevoir des soins médicaux appropriés. http://www.lobservateur.bf/index.php?option=com_k2&view=item&id=5457 (13 octobre 2020) Ajoutez-y le blocus de Farabougou, au centre du Mali, où les djihadistes empêchent, depuis une semaine, les populations de sortir ou d’entrer, causant une pénurie de denrées alimentaires qui a commencé à tuer des enfants. Ils ne se sont pas contentés de fermer les portes du patelin puisqu’en plus du siège, les maîtres des lieux ont massacré six personnes, blessé vingt-deux autres et enlevé une dizaine de villageois. https://www.dw.com/fr/au-mali-le-village-de-farabougou-centre-assiégé/a-55266040 Ces violences font suite à l'enlèvement, lors de la foire hebdomadaire du village de Farabougou, d'une vingtaine de personnes, dont neuf étaient retenues depuis. A la suite de cet enlèvement, les ravisseurs, des djihadistes présumés, encerclent Farabougou, selon les responsables locaux cités par l'AFP. "Le village est coupé du pays par les terroristes qui ont bloqué toutes les voies d'accès", a déclaré le chef de village, Boukary Coulibaly dont les propos sont rapportés par l'AFP. -

Thaïlande
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3105723/wang-yi-opens-chinas-arms-and-wallet-embattled-thai-government (15 octobre 2020) Wang Yi parle investissements - du moins c'est ce qu'on suppose, puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse - avec le général Prayut et transmet "les "salutations cordiales" du président Xi Jinping pour le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn".