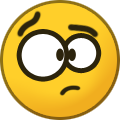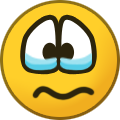-
Compteur de contenus
25 430 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Chine
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Les philosophes du XVIIIe siècle partent du principe qu'il faut un État, pour sortir l'humanité de l'état de nature, où l'homme est un loup pour l'homme et c'est la guerre de tous contre tous. C'est dans un deuxième temps seulement qu'ils font leur marché et choisissent parmi les différentes organisations possibles de l'État : monarchie ou tyrannie ou démocratie. Donc quelque tyrannique qu'elle soit, on peut a minima concéder à la Chine communiste qu'elle est un État. C'est d'ailleurs ce que les diplomaties du monde entier, à l'exception de Taïwan et son club de micro-États clients, disent. Époque où l'on a beaucoup glosé sur le "despotisme oriental". -

[BREXIT]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/185 (15 décembre 2019) Nicole Gnesotto : Un mot sur Boris Johnson lui-même. Il n’inspire pas franchement la bienveillance ou la sympathie, pas de ma part en tous cas, mais il faut tout de même lui reconnaître une qualité d’homme politique exceptionnelle. Il a réussi à faire remonter le parti conservateur à plus de 40% d’abord, il a ensuite obtenu de Westminster exactement ce qu’il voulait : de nouvelles élections après avoir négocié un accord de fond avec Bruxelles, pour lequel il a réussi à renégocier cette question du backstop, dont on nous répétait depuis trois ans qu’elle était immuable. Enfin, il a remporté cette élection. Qu’on l’aime ou non, c’est en tous cas un homme politique impressionnant. -

Chine
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Je suis plutôt d'accord avec la formule de Koojisensei : - la pyramide de Maslow place la sécurité à la base de la base de tout le reste - je suis d'accord avec la formule de Lacordaire : "entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit". -

terrorisme Opération Barkhane
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Scarabé dans Politique etrangère / Relations internationales
Je ne suis pas sûr que la Chine soit un problème pour Barkhane (la Chine appuie la MINUSMA, principalement dans le domaine médical, avec une base à Gao - 4 casques bleus chinois blessés en 2016). Si la Chine a du prestige en Afrique c'est 1 - qu'elle fournit un modèle de développement ; 2 - qu'elle a une aura non seulement de sainteté (à la faveur d'une amnésie sur ses guerres avec l'Inde ou le Vietnam), mais aussi le sésame par les temps qui courent : elle a l'aura de victime (du colonialisme, de l'agression étrangère). -

terrorisme Opération Barkhane
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Scarabé dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.jeuneafrique.com/869010/politique/niger-letat-islamique-revendique-lattaque-dinates/ (12 décembre 2019) Moussa Tchangari, une figure de la société civile, parle de « tristesse profonde » mais attaque aussi les forces étrangères, notamment françaises. « Tout le monde en parle mais où sont les drones ? Où sont les avions de chasse ? (…) Ces gens-là (troupes étrangères) ne sont pas là pour nous, pour nous c’était déjà très clair et donc les forces étrangères ne sont pas d’une grande utilité, elles doivent s’en aller ». -
https://grist.org/climate/politicians-knew-the-inconvenient-truth-about-the-colorado-river-100-years-ago-and-ignored-it/ (3 décembre 2019) Plus tôt cette année, les sept États qui dépendent du fleuve Colorado ont pris un tournant historique. Pour la première fois, l'Arizona, la Californie, l'Utah, le Nevada, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique ont convenu de trouver des moyens de réduire la quantité d'eau qu'ils puisent dans le fleuve à mesure que le niveau du lac Mead, le plus grand réservoir du pays, baisse encore. Le fleuve Colorado fournit de l'eau à 40 millions de personnes. Mais ses débits diminuent à mesure que la planète se réchauffe, ce qui réduit l'accumulation de neige qui alimente la rivière et entraîne l'évaporation d'une plus grande quantité d'eau à mesure que la rivière serpente des Rocheuses vers le golfe de Californie. Mais même si le changement climatique n'était pas un problème, le Colorado serait probablement encore en difficulté. En 1922, lorsque les États ont commencé à diviser l'eau de la rivière, ils ont grossièrement surestimé la quantité d'eau qui y coulait. Selon la rumeur, les États se seraient fiés à de mauvaises données lorsqu'ils se partagèrent l'eau. Mais un nouveau livre remet en question ce récit. Les hydrologues du début du siècle avaient en fait une assez bonne idée de la quantité d'eau que le fleuve pouvait économiser, écrivent John Fleck et Eric Kuhn dans « Maudite soit la science : Comment le fait d'ignorer la science gênante a asséché le fleuve Colorado ». Ils font valoir que les politiciens et les gestionnaires de l'eau au début des années 1900 ont ignoré les preuves sur les limites des ressources de la rivière. En 1916, six ans avant la signature du Colorado River Compact, Eugene Clyde LaRue, un jeune hydrologue du U.S. Geological Survey, a conclu que les réserves du fleuve Colorado étaient "insuffisantes pour irriguer toutes les terres irriguables du bassin". D'autres hydrologues de l'agence et des chercheurs qui étudient la question sont arrivés à la même conclusion. Hélas, leurs avertissements n'ont pas été entendus. Quand vous êtes-vous rendu compte que les idées reçues sur les rédacteurs de la loi du fleuve Colorado qui utilisent de mauvaises données étaient erronées ? Y a-t-il eu un moment de révélation ? Fleck : Le moment de révélation pour moi, c'est quand j'ai trouvé les transcriptions de l'audition de LaRue au Congrès en 1925, quand il a dit, aussi clairement que possible, qu'il n'y avait pas assez d'eau pour ce qu'ils voulaient faire. Cela a effacé tout doute que j'avais que les rapports étaient trop techniques et que les gens ne les comprenaient pas vraiment. Il témoignait devant le Congrès, et ils ont choisi de l'ignorer. Aucun des sénateurs n'en a tenu compte. Ils ont clairement choisi d'ignorer délibérément ce que LaRue disait. Kuhn : Il n'était pas seul. Il y avait l'hydrologue de l'USGS Herman Stabler, un professeur d'ingénierie de l'Université de l'Arizona et une commission de très haut niveau nommée par le Congrès, dirigée par un célèbre lieutenant général du Army Corps of Engineers, et ils sont arrivés à la même conclusion. Ce qui m'a surpris, c'est l'étendue de l'information parmi les experts de l'époque. Il n'y avait pas assez d'eau dans le système pour ce que nous voulions faire, même avant que le changement climatique ne devienne un problème. Alors pourquoi les gens n'ont-ils pas écouté les chercheurs ? Fleck : Les incitations à court terme étaient toujours de prétendre qu'il y avait plus d'eau pour que chacun puisse construire ce qu'il voulait - barrages, canaux, villes et fermes. Tout le monde savait, s'ils étaient réalistes, que les problèmes retomberaient sur les générations futures. Les gens n'étaient pas aussi investis dans l'avenir qu'ils l'étaient dans le présent. Certains États envisagent encore de construire des barrages et des pipelines pour extraire davantage d'eau du Colorado. Croyez-vous que nous ayons retenu la leçon ? Kuhn : Je pense que nous avons tiré des leçons de l'histoire, mais nous n'avons pas eu l'occasion de les appliquer à la prise de certaines décisions pratiques. Dans le passé, la plupart des États, à l'exception de la Californie, dépendaient des fonds fédéraux au Congrès. Il faut former des coalitions pour obtenir des projets par le biais de crédits parlementaires. Il était beaucoup plus facile de diviser politiquement un gâteau plus grand qu'il ne l'était que de faire face à la réalité. Aujourd'hui, les crédits du Congrès sont encore importants, mais les nouveaux projets sont en grande partie gérés par les grandes municipalités ou les États, comme le pipeline Lake Powell de l'Utah. Ce processus de coalition qui a permis de répartir la rivière, de fournir de l'argent et de l'eau - maintenant, nous utilisons cette eau à outrance, et nous devrons probablement réduire ce que les gens obtiennent. Quelle est la feuille de route ? Il n'y en a pas. Si vous ne commencez pas à réfléchir à ce problème fondamental, nous n'arriverons pas à faire le travail. Il est encore très difficile d'en convaincre les législateurs et les gouverneurs des États, parce qu'on leur a dit que nous avions encore de l'eau en surplus. Pensez-vous que les données sont ignorées dans le bassin du fleuve Colorado aujourd'hui ? Kuhn : L'un des endroits où les données sont ignorées, c'est dans le cas des demandes municipales. Las Vegas dessert aujourd'hui 40 à 50 % plus de personnes avec moins d'eau qu'en 2003. Denver Water a doublé la superficie de sa zone de service avec environ la même quantité d'eau qu'au début des années 1980. Les demandes ont diminué. Nous utilisons l'eau de façon beaucoup plus efficace, et cela n'a pas encore été intégré dans la culture du bassin. L'étude du bassin du fleuve Colorado réalisée en 2012 par le Bureau of Reclamation en est un bon exemple. Presque tous les États ont adopté la même position qu'en 1922, à savoir "Eh bien, nous avons besoin de plus d'eau". Ils ont ignoré ce qui se passait chez eux et sont revenus à la théorie traditionnelle des jeux - si vous voulez négocier avec quelqu'un, vous devez exagérer vos exigences. Fleck : Du côté positif, nous constatons que les planificateurs sont beaucoup plus efficaces pour élaborer les outils permettant d'intégrer une analyse des risques liés au changement climatique dans la modélisation. Mais le revers de la médaille, c'est que vous avez un groupe d'utilisateurs d'eau qui sont vraiment mal à l'aise pour être réalistes dans leur évaluation du fait que leurs besoins et leur approvisionnement en eau sont en baisse. Il s'agit donc de faire passer le message scientifique à travers cette barrière politique de la même façon qu'il était difficile de le faire dans les années 1920. La dernière ligne du livre dit qu'avec le changement climatique, il y a de moins en moins d'eau, et " nous ne savons pas jusqu'où se trouve le sol ". Comment planifier l'avenir si vous ne savez pas où est le fond ? A. Kuhn : Il faut cesser de se fier à ce concept d'un droit fondé sur une rivière très différente, et la gestion doit devenir plus souple. On a passé 100 ans à trancher le gâteau et à donner un morceau à tout le monde. Dans les cent prochaines années, nous devrons remettre la tarte en place et en faire une nouvelle. Les droits légaux totalisent plus que ce qu'il y a dans la rivière, et le système de gestion est conçu pour répondre à ces droits légaux. Cela doit changer fondamentalement. Il doit y avoir un changement de paradigme. Fleck : Je suis optimiste quant à notre capacité à le faire. Au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à l'élaboration des outils dont nous avons besoin pour commencer à résoudre ce problème. Les municipalités utilisent moins d'eau. Nous avons vu les utilisateurs agricoles de l'eau réussir à reconnaître les possibilités offertes et à ne pas essayer de s'accrocher à ces vieilles allocations et à ce mythe selon lequel "l'eau est pour se bagarrer". Nous pouvons le faire si nous pouvons négocier ensemble quelques éléments de collaboration. Si, alternativement, nous nous accrochons aux anciennes règles d'attribution de l'eau qui ont été écrites il y a un siècle, et que tout le monde s'y accroche et dit : "Oui, mais j'ai besoin de toute cette eau", alors tout pourrait exploser, et ce serait une catastrophe dans l'Ouest.
-

[BREXIT]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
J'étais curieux de voir ce que deviendrait le propos peu amène du Monde pour Boris Johnson, maintenant qu'il a reçu l'onction démocratique. https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/09/royaume-uni-des-elections-inquietantes-pour-l-europe_6022188_3232.html (9 décembre 2019) Rompant avec ses clowneries, le premier ministre a commencé à montrer son vrai visage : brutal, avide de pouvoir, fuyant le contact avec le public et les questions gênantes, faisant peu de cas du Parlement et, surtout, agitant un nationalisme et une arrogance dignes de Donald Trump. L’insouciance qu’il arbore sur les questions irlandaise et écossaise menace l’unité du pays. La « Grande-Bretagne mondiale » qu’il promet après le Brexit flatte la nostalgie impériale mais ressemble fort à une chimère. Pour tous les Européens, à commencer par les Français, les plus proches voisins et partenaires, l’enracinement d’un Trump au petit pied rêvant de transformer le Royaume-Uni en paradis fiscal pratiquant le dumping social et environnemental aux portes du continent serait une très mauvaise nouvelle. Alors voilà : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/13/elections-au-royaume-uni-l-europe-face-a-la-deuxieme-victoire-du-brexit_6022745_3232.html (14 décembre 2019) Aux Européens de rester unis pour le conduire à faire « le bon choix » : préserver le maximum de liens avec ses voisins plutôt que de mettre à exécution sa menace de transformer le Royaume-Uni en un paradis du dumping aux portes de l’Europe. Le "brutal avide de pouvoir" "agitant un nationalisme et une arrogance" est devenu soudain un homme tout à fait respectable, puisque capable de faire le "bon choix". - - - Parmi les grands blessés de cet accident électoral, un représentant du néo-blairisme pro-européen : https://blogs.spectator.co.uk/2019/12/jo-swinson-to-laura-pidcock-the-seven-biggest-scalps-from-election-night/ La carrière en montagnes russes de Chuka Umunna - qui l'a vu démissionner du cabinet fantôme travailliste, quitter le parti pour rejoindre le "Groupe indépendant", former le nouveau parti Change UK, quitter le parti pour devenir indépendant, puis rejoindre les Lib Dems - a pris fin brusquement. Oui, c'est beaucoup selon les critères britanniques. Tony Blair avait fait bien pire en 2005 : https://en.wikipedia.org/wiki/2005_United_Kingdom_general_election Tony Blair a été réélu Premier ministre, les travaillistes ayant 355 députés, mais avec un vote populaire de 35,2 %, le plus bas de tous les gouvernements majoritaires de l'histoire électorale britannique. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/usa-sanktionen-gegen-pipeline-nord-stream-2-showdown-auf-der-ostsee-a-1300867.html (12 décembre 2019) Le message vidéo du sénateur américain Ted Cruz répand l'humeur la plus alarmante. "Le temps presse", prévient une voix sérieuse, alors que des rangées de chars d'assaut russes défilent sur l'écran. Dans un gros plan, les méchants sont représentés en train de sceller leur sinistre travail contre les États-Unis avec une poignée de main : le président russe Vladimir Poutine - et la chancelière allemande Angela Merkel. Cruz, un candidat républicain et candidat à la présidence qui a échoué, a beaucoup fait ces derniers mois pour atteindre un objectif : Il veut empêcher le gazoduc Nord Stream 2 de livrer du gaz naturel russe directement en Allemagne à l'avenir. Maintenant, il semble avoir du succès à la dernière minute. Mercredi, le Congrès américain a adopté une loi prévoyant des sanctions à l'encontre des entreprises qui posent les conduites revêtues de béton dans la mer Baltique. En fait, il n'y a qu'une seule chose en ce moment : le suisse Allseas. Leurs dirigeants sont menacés de retrait de visa et de gel des avoirs aux Etats-Unis. Au plus tard la semaine prochaine, le Sénat adoptera également les dispositions relatives aux sanctions annexées au budget militaire de 738 milliards de dollars. Le président Donald Trump a déjà annoncé qu'il signerait la loi. Pour les deux parties, une course contre la montre a commencé. Pas même 150 kilomètres séparent le gazoduc double brin de sa destination à Lubmin près de Greifswald. Environ mille kilomètres de distance ont déjà été parcourus. Si Allseas, qui avec le "Pioneering Spirit" dirige le plus grand navire de pose du monde, est impressionné et arrête son travail, les choses devraient se tendre. Un représentant de l'actionnaire russe de Nord Stream, Gazprom, a déclaré au Wall Street Journal que cela prendrait encore cinq semaines. Mais même si Allseas sautait, le projet serait achevé "d'une manière ou d'une autre", a-t-il affirmé. "Si les sanctions arrivent, elles ne feront que prolonger la construction et la rendre plus coûteuse. Mais ils ne le tueront pas." Si nécessaire, ils utiliseront leurs propres navires. Cependant, les experts en énergie doutent que la méthode du bricolage soit une option réaliste. Mais Cruz ne peut pas se sentir gagnant non plus. La loi donne 60 jours au ministère des Affaires étrangères pour établir la liste des entreprises. Elles auraient alors 30 jours pour terminer leurs opérations. Même si les ministères de Washington forçaient le pas, les navires Allseas pourraient être déjà en route vers leurs ports d'attache et les sanctions pourraient littéralement être un coup porté à l'eau. Mais pour l'instant, la guerre des nerfs bat son plein. Cruz n'est pas le seul à résister au gazoduc. La Commission des affaires étrangères du Congrès a approuvé son projet à une large majorité non partisane. Alors que Mme Merkel soutient que Nord Stream est nécessaire pour garantir l'approvisionnement énergétique, les Américains préviennent que l'Europe devient dépendante de la Russie. L'entreprise publique Gazprom va gagner des milliards, "qui pourraient être utilisés pour alimenter l'agression russe", dit Cruz dans sa vidéo. De nombreux experts en politique étrangère craignent que l'Ukraine ne soit affaiblie et déstabilisée parce que Moscou n'a plus besoin de ses voisins comme pays de transit pour ses approvisionnements grâce au nouveau gazoduc. Et bien sûr, c'est aussi une question d'affaires : les États-Unis voudraient tirer profit de la soif d'énergie de l'Europe et exporter du gaz liquéfié vers l'Allemagne. La position de Trump sur le projet n'est pas claire Cependant, une personne reste comme toujours en marge du groupe des partisans de la ligne dure : Le président américain, dont on sait qu'il a un faible pour son homologue Poutine et peu de sympathie pour l'Ukraine. Trump a dit que l'Allemagne se faisait "otage de la Russie". Mais la rencontre de la semaine dernière avec Mme Merkel au sommet de l'OTAN semblait beaucoup plus douce. Tout cela est "un problème que l'Allemagne devra résoudre elle-même. Ce ne sera peut-être pas un problème pour l'Allemagne. J'espère que ce n'en sera pas un," a dit Trump. En fait, si le gouvernement américain l'avait voulu, il aurait pu prendre des mesures contre le gazoduc depuis longtemps. Il aurait pu simplement imposer des sanctions en vertu du CAATSA Act de 2017, la loi contre les adversaires de l'Amérique par des sanctions. Mais il ne l'a pas fait. Cruz, le collègue de parti de Trump, l'a remarqué. Si le gazoduc était achevé, "ce serait la faute des membres de ce gouvernement assis sur leurs fesses et n'exerçant pas leur pouvoir", a récemment fait remarquer le sénateur. Il s'agissait du ministre des Finances Steven Mnuchin. La peur de Trump était-elle le facteur limitant ? D'autres pensent que Mnuchin n'était pas le seul ralentissement. Pourquoi la Maison-Blanche et le Congrès ont-ils attendu jusqu'à la dernière ligne droite avant de se prononcer sur les sanctions ? C'est ce qu'a demandé l'expert en énergie du portail d'information Politico, Ben Lefebvre. La réponse de sa recherche : la peur de Trump. Les républicains craignaient que les sanctions de Nord Stream n'entrent dans le contexte de la manipulation de la campagne russe en 2016, une question que Trump ne veut pas connaître. Ils ont donc repoussé la décision. Selon cette lecture, les sanctions décidées aujourd'hui seraient un acte purement symbolique, trop tard pour avoir un quelconque effet : un pétard sans potentiel explosif. Mais peut-être que les choses seront différentes de toute façon : un tel navire de pose de canalisations peut avancer d'environ trois kilomètres par jour. Nord Stream 2 devrait être prêt d'ici la fin de l'année. Mais le projet de construction de 9,5 milliards d'euros a pris du retard. L'entreprise de construction a récemment déclaré qu'elle voulait achever le projet "dans les prochains mois". Toutefois, en raison des conditions météorologiques, il n'est pas possible de donner une date exacte. Ted Cruz a peut-être trouvé un nouvel allié transatlantique : l'hiver allemand. -

[BREXIT]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est plié : https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/13/jo-swinson-lib-dems-on-course-for-grim-night Jo Swinson a démissionné de son poste de chef du Parti libéral-démocrate avec effet immédiat après avoir perdu son siège. https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/12/exit-poll-predicts-majority-for-boris-johnson-and-conservatives Johnson, parlant à son propre dépouillement à Uxbridge, a dit : "Ce gouvernement conservateur one-nation s'est vu confier un nouveau mandat puissant pour faire en sorte que le brexit se réalise - et pas seulement pour faire en sorte que le brexit se réalise, mais pour unir notre pays et pour le faire progresser". https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatisme_one-nation Le conservatisme de type one-nation est une forme de conservatisme politique ayant une vision organique de la société et prônant le paternalisme et le pragmatisme. L'expression « One-nation Tory » a été popularisée par Benjamin Disraeli, porte-parole en chef du Parti conservateur du Royaume-Uni et Premier ministre à partir de 1868. En tant que philosophie politique, le conservatisme one-nation s'appuie sur l'idée que les sociétés existent et se développent organiquement et que chacun possède des obligations envers les autres. Cette approche insiste sur l'obligation paternaliste des classes dirigeantes envers les classes qui leur sont inférieures. Cette orientation philosophico-politique est la base de la mise en place de réformes sociales considérables lors de la présence de Disraeli au gouvernement. Vers la fin du XIXe siècle, le parti s'est détaché du paternalisme en faveur du capitalisme de libre marché, mais la peur de l'extrémisme lors de l'entre-deux-guerres ramène le conservatisme one-nation. Le parti garde cette philosophie lors du consensus d'après-guerre jusqu'à la montée de la Nouvelle Droite [thatchérienne], qui accuse le conservatisme one-nation d'être la cause de troubles économiques et sociaux. -

Ukraine 3
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Politique etrangère / Relations internationales
Traduttore, traditore. En anglais c'est "nice", qui prête moins à une interprétation de dédain. Réflexion faite, j'aurais du mettre "sympathique". Sur le moment j'avais une hésitation, mais comme je ne trouvais pas d'idée, j'ai laissé "gentil". -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/alain-prochiantz-scientifique-en-liberte-55-faire-entendre-la-musique-de-la-science (11 octobre 2019) 14:30 Alain Prochiantz : En 2002, à Lisbonne, nous investissions 2,2% du PIB en recherche et développement en France et en Allemagne. On s'est donné le but de mettre 3%. Les Allemands ont dépassé 3% et nous, on est toujours à 2,2. -

Ukraine 3
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://nationalinterest.org/feature/what-does-russia-expect-putin-zelensky-meeting-102842 (7 décembre 2019) Un récent sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev a révélé que le taux d'approbation de Zelensky a chuté de 21 % au cours des deux derniers mois, passant de 73 % en septembre à 52 % à la fin novembre. Les enquêteurs ont noté que la gestion du conflit dans l'est de l'Ukraine par Zelensky, ainsi que certaines réformes impopulaires, expliquent en partie pourquoi le soutien du président a chuté si rapidement. Ce contrecoup a convaincu de nombreuses personnes à Moscou que même si Zelensky a de bonnes intentions, il n'a pas le levier politique nécessaire pour poursuivre une politique de détente avec la Russie. "Bien que Zelensky ait remporté plus de 70% des voix, il n'a pas encore consolidé son pouvoir et la minorité nationaliste agressive peut dicter ses conditions au gouvernement actuel ", a déclaré Andranik Migranyan, conseiller informel de l'administration présidentielle russe et professeur à l'Institut national des relations internationales de Moscou. Même Poutine semble avoir des doutes quant à la vulnérabilité politique de son homologue ukrainien. Lors d'un forum d'investissement à Moscou le 20 novembre, le dirigeant russe a expliqué que s'il ne doute pas de la sincérité de Zelensky, il se demande si le comédien devenu président peut réellement tenir sa promesse d'apporter la paix à l'Ukraine orientale. "Quelle est ma relation avec Zelensky ? Il n'y en a pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. On s'est parlé au téléphone. Je pense que c'est un homme gentil, honnête. Je pense qu'il souhaite vraiment changer la situation pour le mieux, en particulier dans le Donbass", a déclaré le président russe. -

Océanie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Les consommateurs du cuivre de la mine de Panguna ?- 242 réponses
-
- 1
-

-

AFRIQUE : politiques internes et relations internationales
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.latribunedelart.com/ouvrez-ouvrez-la-cage-aux-oiseaux-quelques-remarques-a-propos-d-une-promesse-de-restitution (10 décembre 2019) Récemment, l’Université de Cambridge a annoncé la « restitution » au Nigéria d’un coq en bronze de l’ancien royaume de Benin. Cette pièce fut saisie par les troupes coloniales anglaises lors de la prise de Benin-City en 1897 et arriva en la possession du capitaine George W. Neville, un des officiers de cette expédition militaire, qui le légua ensuite au Jesus College. Une partie du « butin » contribua par sa vente à payer les frais de l’expédition et à pensionner les soldats blessés ainsi que les veuves de ceux qui furent tués. Le reste fut réparti entre les différents officiers au titre de trophées ou de souvenirs. Précisons ici que, à cette époque, ces pratiques susmentionnées, de même que la saisie d’objets dans un but stratégique (affaiblir la puissance politico-religieuse du vaincu), étaient considérées comme légitimes aussi bien par les armées européennes que par les armées africaines. A notre connaissance, aucun de ces objets récemment mis sur le marché n’a été acquis pour ses musées par le Nigéria, pays pourtant premier producteur de pétrole en Afrique ; et aucune de ces œuvres ne fut non plus acquise par de généreux donateurs nigérians pour le compte de ces mêmes musées. Soit dit en passant, le pays compte plus de 15.000 millionnaires en dollars et aussi une vingtaine de milliardaires. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le Nigéria possède déjà de solides collections qui ne collent pas vraiment avec l’image misérabiliste que l’on donne parfois des musées africains. Serait-ce en réalité du paternalisme déplacé que de justifier ici des restitutions de pièces au prétexte que « nous avons tout et ils n’ont rien » ? Ainsi, les collections du Nigerian National Museum de Lagos tournent autour de 45.000 pièces en réserves. Il est vrai qu’en ce qui concerne la question des restitutions, l’époque est à la moraline. L’important est de ne surtout pas créer un scénario trop compliqué afin que l’on puisse avoir, comme dans un très mauvais film hollywoodien, des méchants et des gentils bien identifiables… quitte à s’arranger avec l’histoire et le droit. Relevons pour finir que l’Université de Cambridge a en ce moment un vrai problème avec les volatiles. En effet, la digne institution a décidé, toujours sous la pression de quelques étudiants, de retirer du réfectoire dans lequel il se trouvait un tableau du XVIIème ; intitulé le Fowl Market (Le Marché aux volailles), cette copie d’atelier d’une œuvre de Frans Snyders conservée à L’Ermitage a pour sujet un étal garni de gibiers à poils, mais aussi et surtout à plumes. La raison de ce retrait est simple : le tableau, très peu sanguinolent au demeurant, choquait des élèves végétariens et végans. https://www.latribunedelart.com/la-restitution-du-sabre-d-el-hadj-oumar-tall-un-perilleux-galop-d-essai-au-mepris-du-droit-et-de-l (29 novembre 2019) Ainsi, la simple lecture des travaux de l’historienne malienne Madina Ly-Tall publiés en 1996 dans le volume VI de l’« Histoire générale de l’Afrique », pages 658 à 682, montre « la violence avec laquelle l’islam fut imposé à des peuples pétris par plusieurs siècles de croyances à leurs religions traditionnelles » notamment aux populations animistes bambara, dont plusieurs cités importantes furent ravagées par les mudjāhidūn d’El Hadj Oumar Tall, pour qui « la terreur était une arme stratégique : massacre des hommes, réduction à l’esclavage des femmes et des enfants brisaient le moral des pays menacés et amenaient certains à se rendre sans combattre » (p. 671). L’historienne décrit également la pratique systématique du butin de guerre (p. 675) dont les chantres des restitutions font souvent la justification. Convenons également qu’il est plus que curieux de restituer le dimanche un symbole de l’établissement par le djihad d’un empire islamique fondé au prix de la soumission brutale de populations locales animistes et de participer le lendemain à un forum consacré à la paix et la sécurité en Afrique en fustigeant, à juste titre cette fois, les groupes terroristes se revendiquant de Daesh dont, finalement, le but n’est autre que d’imposer à leur tour par la force un état islamique, notamment, comme le fit au Mali celui dont on honorait la mémoire la veille, El Hadj Oumar Tall. La place du sabre d’El Hadj Oumar Tall est-elle au Sénégal, comme l’affirme Edouard Philippe ? Rien n’est moins certain mais, à Paris, il n’était que le souvenir d’une victoire d’un empire colonial sur un autre, alors qu’à Dakar, il risque de redevenir celui de l’un des premiers califats imposés en Afrique de l’Ouest par la violence. -

Bolivie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Borisdedante dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/05/the-guardian-view-on-bolivia-respect-the-people (5 décembre 2019) Éditorial : La tâche du gouvernement intérimaire est d'organiser l'élection de façon équitable. Il n'a pas de mandat pour prendre des décisions importantes en matière de politique étrangère, comme la rupture des liens diplomatiques avec le Venezuela, ou pour faire des déclarations provocatrices.- 159 réponses
-
- bolivie
- amérique du sud
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Ukraine 3
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/10/sommet-ukraine-russie-un-resultat-tiede_1768287 (10 décembre 2019) Certes, des «objectifs réalistes» ont été fixés. Un cessez-le-feu intégral avant la fin de l’année, accompagné d’un élargissement du mandat de l’OSCE qui en observera le respect 24 heures sur 24. Un échange de prisonniers «tous contre tous», d’ici le 31 décembre, avec le concours des ONG internationales qui auront un accès illimité à tous les détenus. La réactualisation du plan de déminage dans ce qui est devenu l’un des territoires les plus minés au monde. La création de nouveaux points de passage pour les populations civiles et trois zones de désengagement des forces armées supplémentaires le long de la ligne de front, d’ici mars 2020, en plus des trois qui ont déjà été mises en place avec succès ces dernières semaines. Volodymyr Zelensky, novice en politique et élu sur la promesse de paix est venu à Paris en ayant promis aux Ukrainiens de ne pas capituler face à son homologue russe. En essayant notamment d’inverser le séquençage prévu par les accords de Minsk, selon lequel l’Ukraine ne récupérera le contrôle de sa frontière méridionale avec la Russie que le lendemain d’élections locales et une fois qu’un statut spécial pour les territoires séparatistes de Donetsk et Louhansk aura été inscrit dans la Constitution ukrainienne. Des mesures que Kiev n’a jamais pu accepter, puisqu’il en va de sa souveraineté. Pardon, madame la journaliste de Libération, mais est-ce que signer les accords de Minsk, ne veut pas dire "accepter" les mesures écrites dans les accords de Minsk ? -

co² Economie et climat. CO2 or not CO2?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Economie et défense
Le plus gros problème, ce n'est pas les bateaux, c'est les camions : source : AIE 2016 https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-transport-co2-part-emissions-1017/ -

co² Economie et climat. CO2 or not CO2?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Jojo67 dans Economie et défense
Oui, mais c'est "illusoire" : Une telle filière ne pourra voir le jour que s'il y a une demande pour de tels carburants. Pour cela, il faut qu'il y ait une obligation d'incorporation pour les compagnies aériennes. Problème, au regard de la spécificité internationale du transport aérien, une telle règlementation ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale, sous peine de créer des écarts de compétitivité entre les compagnies qui seraient obligées d'utiliser des carburants alternatifs beaucoup plus coûteux et celles qui n'y seraient pas contraintes. Vu la lenteur des débats pour mettre en place dans la douleur le système de compensation mondial des émissions de CO2 Corsia partir de 2020, il semble aujourd'hui illusoire d'espérer réunir tous les pays de la planète sur un tel projet. -
Cela fait déjà un certain temps que cette guerre d'Afghanistan présente tous les caractères d'une impasse : - - - - Un Afghanistan où Hillary Clinton s'était illustrée à sa manière :
-

Chine
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.letemps.ch/monde/chine-cameras-intelligentes (3 février 2019) Une petite foule s’est amassée des deux côtés de la route, l’une des plus fréquentées du quartier de Futian, à Shenzhen. Ils attendent que le feu passe au rouge. Soudain, un vieil homme poussant un chariot chargé de bouteilles vides perd patience et s’élance, slalomant entre les véhicules. Il est suivi par une dame munie de deux valises à roulettes roses. Quelques instants plus tard, leurs visages apparaissent sur un écran géant, avec leur nom et la moitié de leur numéro de carte d’identité. Ils ont été pris sur le fait par deux caméras de surveillance équipées d’un logiciel de reconnaissance faciale. Celles-ci corrèlent les images des passants avec une base de données contenant les photos et les cartes d’identité des 1,4 milliard de citoyens chinois. D’ici peu, la police de Shenzhen enverra à ces délinquants un message personnalisé et une amende, via les réseaux sociaux WeChat et Weibo. https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3021206/china-big-brother-watching-you-even-you-sort-your-trash (5 août 2019) Dans la ville de Jiuting, à Shanghai, en juin, l'escadron de gestion urbaine s'occupait d'une affaire dans laquelle une camionnette chargée de mousse isolante avait été secrètement déversée sur un site d'élimination des déchets de construction pendant la nuit. En raison de l'omniprésence des caméras vidéo, il n'a pas fallu longtemps aux officiels pour pour retrouver la camionnette et condamner le contrevenant à une amende de 20 000 yuans (2 900 $US). Bien que l'amende élevée et l'application déterminée des lois de recyclage aient choqué de nombreux citoyens internautes, elles faisaient partie intégrante d'un nouveau schéma de tri des déchets à Shanghai. qui a été qualifié de "le plus strict de l'histoire". La mise en œuvre de la nouvelle politique illustre également comment la surveillance de haute technologie a encouragé l'État chinois à mener des initiatives plus ambitieuses, ciblant non seulement les questions économiques mais aussi les activités les plus banales dans la vie des gens ordinaires. Peaceful City est une plate-forme de gestion de la sécurité qui connecte des caméras à travers les villes et contrôle tous les aspects de la sécurité publique, y compris le maintien de l'ordre, la gestion des urgences, la gestion du trafic et le contrôle des accès. Un système de surveillance de masse appelé Skynet est connecté à cette plate-forme, constitué par un réseau de caméras vidéo échangeant des informations en temps réel avec les bases de données gouvernementales. Il y avait 200 millions de ces caméras en 2018, et avec 400 millions de plus à installer d'ici 2020, la Chine aura bientôt presque une caméra pour deux citoyens. L'objectif de Pékin, écrit Stephen Chen dans le Post, est "d'identifier n'importe qui, n'importe quand, n'importe où en Chine en trois secondes". Ces caméras ont aidé la police de Shanghai à arrêter 6 000 suspects en 2017. À Wuhan, le nombre de cambriolages a diminué de 39 % en 2014, après le lancement par la ville de la deuxième phase de Skynet. À Guizhou, un journaliste de la BBC qui a testé le système de surveillance de la reconnaissance faciale a été arrêté par des hommes en uniforme en sept minutes. À l'heure actuelle, la police résout 90 % des crimes en Chine grâce au réseau de surveillance. L'utilisation de la caméra fait également partie intégrante de la tentative du Parti communiste d'améliorer le comportement civique et de décourager les crachats, les déchets et autres mauvaises habitudes. Par exemple, la start-up Intellifusion de Shenzhen utilise des caméras haute définition et des caméras artificielles pour aider la police à identifier et à faire honte aux gens qui traversent la rue hors des clous, en montrant leurs photos sur les écrans LED sur place et sur Internet. Mais le système de tri des déchets de Shanghai ajoute encore un autre niveau à la surveillance en Chine. En 2018, la ville a mis en place des bacs de recyclage intelligents, c'est-à-dire des bacs équipés de caméras vidéo et de scanners qui permettent de distinguer les différentes catégories de déchets et de recueillir des données sur leur élimination. Pour utiliser ces bacs, les résidents glissent leur carte à puce. Ceux qui trient régulièrement leurs déchets gagnent des points monnayables, et ceux qui ne les trient pas peuvent recevoir la visite du comité de quartier. L'étape suivante - le transfert des déchets de la poubelle au centre de traitement - fait également appel à des caméras haute définition et à des outils d'IA. En mars, Shanghai a lancé une plate-forme d'information qui suit l'ensemble du processus d'élimination des déchets. Des caméras sont installées sur les camions à ordures et dans les stations de transfert, où 2 000 à 3 000 photos des déchets sont prises, puis analysées à l'aide de l'IA pour détecter les déchets qui ont été mal classés - par exemple, une bouteille en plastique qui a été jetée avec les déchets humides. La mise en place d'un système de collecte de données pour le tri des déchets n'est pas seulement importante pour attraper les recycleurs récalcitrants ou pour appliquer les lois de recyclage. C'est aussi un excellent exemple de la façon dont le système de données de la Chine deviendra un jour intégré et à multiples facettes. En recueillant des données détaillées sur les habitudes d'élimination des déchets à grande échelle, l'État est en mesure de comprendre ses citoyens et les tenants et aboutissants de leur vie sous un autre angle - combien de viande ils mangent, ce qu'ils consomment, s'il y a des preuves de comportement criminel, une maladie contagieuse, etc. Cette réalité de haute technologie non seulement façonne la façon dont l'État chinois gouverne son peuple, mais ouvre aussi la porte à une nouvelle façon de gouverner au XXIe siècle. Les reportages antérieurs sur le système de surveillance chinois ont eu tendance à mettre l'accent, à juste titre, sur les questions morales de protection de la vie privée - et, en fait, à passer outre ce que la technologie fait réellement sur le terrain. La surveillance du public est une tâche dont les responsabilités sont de plus en plus importantes. Le système de caméras de surveillance de la Chine, qui s'imbrique dans les initiatives gouvernementales, montre à quel point la technologie est en train de remodeler la relation entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Elle apporte de nouvelles attentes sur ce qui est possible, mais aussi sur ce qui est attendu de la gestion d'un vaste pays avec une population énorme. -

Océanie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lepoint.fr/monde/papouasie-fin-du-referendum-sur-l-independance-de-l-ile-de-bougainville-07-12-2019-2351834_24.php (7 décembre 2019) Fin du référendum sur l'indépendance de l'île de Bougainville Le oui à l'indépendance est donné favori mais les résultats du scrutin ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Un vote favorable à l'indépendance devrait encore être ratifié par le Parlement de Papouasie, où l'on redoute un effet de contagion dans un pays d'une très grande diversité ethnique.- 242 réponses
-
- 1
-

-

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
Les grands esprits se rencontrent : -

co² Effondrement écologique et civilisationnel en ce siècle ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Economie et défense
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/alain-prochiantz-scientifique-en-liberte-35-ni-dieu-ni-nature-mais-des-maitres (9 octobre 2019) 24:27 Alain Prochiantz : Alors on peut trouver ça pas grave : après tout, tous les animaux ont un début, un milieu, une fin. Le jour où Sapiens ne sera plus là, les autres proliféreront comme ils veulent, et puis... mais bon, la nature n'existera plus parce qu'il n'y aura plus personne pour en parler. Hein, il faut quand même voir ça aussi : la nature, elle existe parce qu'on peut la nommer. Donc, il y aura la nature, Sapiens ne sera plus là et puis voilà. Mais on peut aussi se dire que c'est dommage, on veut voir pousser ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, donc il faut peut-être arrêter le désastre, que les scientifiques peuvent prévoir. Et puis gérer la chose, gérer la biodiversité, pas forcément pour ou parce qu'il faut de la biodiversité, mais parce qu'elle est nécessaire à la survie de Sapiens. Il faut assumer l'égoïsme de Sapiens. Si on veut vraiment sauver la planète, c'est pas pour sauver la planète, c'est pour sauver Sapiens, quand même. Et ça, ça veut dire qu'il faut y mettre tous les moyens, y compris le meilleur moyen qu'a Sapiens, c'est son cortex. C'est effectivement les sciences, les solutions techniques, qui permettront de repousser le plus tard possible le moment final. À contraster avec ce que dit Jacques Blamont : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2562&v=uNXQa43hCCk&feature=emb_logo (13 août 2012) 42:40 Jacques Blamont : Dans les 50 dernières années, la population du monde a doublé, et l'efficacité de son utilisation des ressources naturelles a aussi beaucoup augmenté. Journaliste : et donc il vous vient l'idée que la spiritualité - alors que vous êtes athée... Jacques Blamont : Oui, c'est à dire que lorsque l'on voit que l'évolution historique amène à une disparition des ressources naturelles dans une cinquantaine d'années, dans un grand nombre de domaines vitaux, on se demande : qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors la première solution c'est de se dire, eh bien, la technique et la science permettront de résoudre ce problème. Là, je pense que c'est une fausse idée. C'est pas possible, parce que la technique et la science augmentent encore notre efficacité, et donc augmentent encore notre emprise sur les ressources naturelles. La seconde idée, c'est de s'en tirer par la gouvernance politique, par exemple une sorte d'ONU, supérieure à ce qui est là, maintenant, qui permettrait d'établir des règles, disons d'austérité ou d'utilisation plus raisonnable des ressources naturelles : eh bien, tout le monde sait que ça ne marche pas. Journaliste : Faudrait déjà arrêter de nous dire qu'il faut une croissance tous les ans pour que l'économie marche. Jacques Blamont : Oui, mais ça, c'est une idée absurde. C'est malheureusement l'idée de tous les hommes politiques (...) C'est à dire que puisque ni la science, ni la politique, c'est à dire des moyens rationnels ne peuvent fournir une solution aux très graves difficultés qui nous attendent, peut-être qu'on peut essayer par des ressources non rationnelles ou spirituelles, et pour ça, il faut s'adresser aux spécialistes du spirituel, des gens qui depuis des générations ont l'habitude de manipuler les esprits de manière à convaincre les foules de vivre de façon plus frugale. Et avec ce que dit Heidegger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Heidegger_et_la_question_de_la_technique La Technique moderne, en tant que manifestation ultime de la volonté de puissance, représente, pour Martin Heidegger, le danger le plus grand. Dominique Janicaud constate aussi : « Nul ne peut contester qu'en un laps de temps relativement court (en comparaison de l'histoire et surtout de la préhistoire de l'humanité) les sciences et les techniques ont transformé notre planète au point d'ébranler des équilibres écologiques et ethnologiques immémoriaux, au point surtout de faire douter l'homme du sens de son existence et de ses travaux, jusqu'à faire vaciller sa propre identité ». Là où Nietzsche voit la manifestation de la domination de l'homme sur la nature, Heidegger perçoit tout au contraire la dernière étape de sa dépossession au long d'une histoire de la métaphysique, des époques et des modes de dévoilement de l'être. Plus l'homme se prend pour le « seigneur de la terre », plus il devient une simple pièce du « dispositif technique ».- 2 406 réponses
-
- effondrement
- ecologie
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Autriche
Wallaby a répondu à un(e) sujet de rogue0 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/taxe-gafa-l-autriche-critique-aussi-la-menace-americaine-20191203 (3 décembre 2019) En septembre, le Parlement autrichien est allé plus loin que la France en approuvant une taxe de 5% sur les revenus publicitaires des géants américains engrangeant au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, dont au moins 25 millions en Autriche. La mesure doit entrer en application en janvier et son «but est d'introduire de l'équité fiscale entre tous les médias traditionnels et digitaux en Autriche». https://orf.at/stories/3146706/ (6 décembre 2019) Les négociations gouvernementales entre l'ÖVP et les Verts se poursuivent, sans fin en vue. Aujourd'hui, il y a eu des pourparlers continus, et même ce week-end, les équipes de négociation de l'ÖVP et des Verts veulent travailler sur une éventuelle coalition, a-t-on dit des deux côtés. -

Le Brésil, le géant de l'Amérique du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Philippe Top-Force dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.la-croix.com/Economie/Bresil-croissance-trimestrielle-bienvenue-Bolsonaro-2019-12-03-1301064229 (3 décembre 2019) Le Brésil a enregistré une hausse meilleure qu'attendue de son PIB au troisième trimestre, avec une croissance de 0,6%. La reprise au Brésil devrait commencer à se confirmer l'an prochain: le marché a récemment relevé légèrement sa prévision de croissance pour 2020, de 2% à 2,2% L'examen au Congrès de la réforme de l'administration, qui prévoit notamment de lourds dégraissages et requiert pas moins de trois amendements constitutionnels, a été repoussé à 2020, à la demande du président Jair Bolsonaro. Les analystes font également valoir que les réformes risquent d'être difficiles à faire approuver en raison des divisions entre alliés dans le clan de Jair Bolsonaro, qui vient de quitter le parti avec lequel il a conquis le pouvoir, le PSL, pour fonder sa propre formation, l'Alliance pour le Brésil.