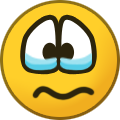-
Compteur de contenus
25 661 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://it.euronews.com/2025/10/20/la-lituania-inaugura-la-via-baltica-la-strada-strategica-per-la-nato-e-i-paesi-baltici (20 octobre 2025) La route européenne E67 qui relie les républiques baltes au reste de l'Union européenne a été inaugurée en Lituanie. Il s'agit d'un projet stratégique pour l'intégration européenne et pour l'approvisionnement de l'OTAN sur le front oriental. Le président polonais Karol Nawrocki s'est rendu lundi en Lituanie pour inaugurer, avec son homologue lituanien Gitanas Nausėda, un tronçon amélioré de la route européenne E67, également connue sous le nom de Via Baltica. Selon la chancellerie lituanienne, cet événement revêt également une dimension symbolique : il a lieu à la date anniversaire de la signature du pacte d'assistance mutuelle entre les deux nations, le 20 octobre 1791. Ce document avait représenté une avancée significative vers l'égalité entre Lituaniens et Polonais dans les structures étatiques de l'ancienne République de Pologne. La Via Baltica est un axe routier qui relie la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie à la Pologne et à d'autres pays de l'Union européenne. Il s'agit du principal corridor routier entre les pays baltes et le reste du continent. L'importance de cette route dépasse les frontières de la région : elle fait partie intégrante des réseaux transeuropéens de transport (également appelés RTE-T), qui relient la Baltique à la mer du Nord, à la mer Noire et à la mer Égée. La construction du tronçon polonais de la Via Baltica a duré plus de dix ans et a coûté plus de 11 milliards de zlotys, soit environ 2,6 milliards d'euros, dont environ 1,4 milliard provenait de fonds de l'Union européenne. Dans la situation géopolitique actuelle, cet axe revêt une importance stratégique supplémentaire. Il joue un rôle clé dans la mobilité des troupes de l'OTAN, en permettant le déplacement rapide des forces le long du flanc oriental de l'Alliance. Cela fait de la Via Baltica un élément important pour la sécurité de toute la région. Parallèlement à la Via Baltica, la Rail Baltica, une ligne ferroviaire moderne de 870 kilomètres qui assurera une liaison rapide entre les pays baltes et le reste de l'Europe, est également en cours de construction. L'achèvement des premiers tronçons est prévu pour 2030. Bien que les travaux de construction essentiels aient déjà été réalisés, le projet accuse un retard d'au moins cinq ans par rapport au calendrier prévu. La construction de la nouvelle ligne ferroviaire a débuté en 2019, mais elle a été marquée dès le départ par des retards et des controverses entre les gouvernements baltes concernant le tracé et d'autres aspects financiers. Les coûts estimés du projet Rail Baltica ont quadruplé, passant de 6 milliards d'euros initialement à 24 milliards d'euros. La Commission européenne les juge trop élevés et les auditeurs des États baltes ont également fait part de leurs inquiétudes. L'Union européenne couvre jusqu'à 85 % des coûts du projet Rail Baltica dans le cadre du programme Connecting Europe, qui soutient le développement des infrastructures de transport transfrontalières. Le reste du financement est assuré par la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. En cas d'agression russe, Rail Baltica devrait permettre le transport rapide de troupes et d'équipements lourds vers le front oriental. L'objectif principal du projet est toutefois d'améliorer les liaisons entre les villes baltes et le marché unique de l'Union européenne : des déplacements rapides pour les touristes et les entrepreneurs et un transport efficace des marchandises. Une fois achevé, le train à grande vitesse pourra parcourir la distance entre Tallinn et Vilnius (660 kilomètres) en trois heures et 38 minutes, ce qui représente une réduction significative du temps de trajet par rapport aux neuf heures actuelles en voiture ou en bus. écartements ferroviaires. Rail Baltica et ligne ferroviaire Est finlandaise Source : https://www.itarata.fi/en/east-railway-study-the-finnish-track-gauge-must-be-examined-as-part-of-the-european-transport-system/ (9 octobre 2024) Selon une étude, l'introduction de l'écartement européen des voies sur le réseau Ligne Ferroviaire Est [finlandaise] se justifie si l'on encourage parallèlement l'extension systématique de l'écartement des voies en Finlande et si l'objectif est d'améliorer les liaisons de transport internationales. https://www.rejlers.com/newsroom/news/2025/10/rejlers-wins-framework-agreement-for-major-east-railway-project-in-finland/ (7 octobre 2025) La ligne ferroviaire Est est un projet de liaison ferroviaire à grande vitesse reliant la région métropolitaine d'Helsinki à Kouvola via Porvoo. Le projet vise à moderniser le transport ferroviaire dans l'est de la Finlande, à améliorer la connectivité nationale et à renforcer l'intégration de la Finlande dans le réseau de transport européen. La phase de planification devrait s'achever au début des années 2030, et la ligne ferroviaire devrait être opérationnelle d'ici 2040. https://railway-news.com/east-railway-project-to-connect-finland-to-europe/ (12 mai 2025) Avec l'adhésion récente de la Finlande à l'OTAN, le besoin d'un transport militaire efficace est sans doute crucial. La ligne ferroviaire Est constituera donc une voie de transport essentielle pour les forces militaires, renforçant ainsi la sécurité et la préparation dans la région. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.geo.fr/geopolitique/rail-baltica-le-chantier-ferroviaire-a-24-milliards-deuros-qui-veut-proteger-leurope-de-poutine-226510 (14 mai 2025) Les chemins de fer de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie utilisent toujours le "gabarit russe" (1 520 mm), incompatible avec l’écartement standard européen (1 435 mm). En conséquence, en cas de crise ou de conflit, le transport rapide de troupes et de matériel allié vers cette région frontalière se transformerait en véritable casse-tête logistique. Pour pallier le problème, un chantier titanesque de plus de 24 milliards d’euros, destiné à intégrer les pays baltes dans le réseau ferroviaire européen, a été lancé. Le nom du projet ? Rail Baltica. Long de 870 kilomètres (540 kilomètres dans les États baltes eux-mêmes), le corridor reliera Tallinn (Estonie) à Varsovie (Pologne), en passant par Riga (Lettonie) et Klaipėda (Lituanie), avec une éventuelle connexion ultérieure vers Helsinki (Finlande) via un tunnel sous-marin. Les infrastructures actuelles, toujours intégrées au réseau soviétique, posent un problème immédiat car, aux frontières, les passagers doivent changer de train et le fret peut être bloqué jusqu’à huit heures. En situation de guerre, cette inertie logistique pourrait s’avérer désastreuse, alors que la Russie dispose de connexions directes vers les ports baltiques et peut déployer rapidement ses forces grâce à ce fameux écartement ferroviaire. D’où l’urgence de bâtir le réseau Rail Baltica qui, selon les estimations officielles, serait capable d’évacuer en une journée jusqu’à 143 000 personnes. [La stratégie serait donc "l'évacuation" des "personnes" ... ?] Lancé en 2014, Rail Baltica a subi les contrecoups de la pandémie, des lourdeurs bureaucratiques et des désaccords entre partenaires. Les coûts ont quadruplé, poussant les États baltes à diviser le projet en deux phases : la première, de plus de 15 milliards d’euros, se limitera à une seule ligne ferroviaire prioritaire, attendu pour 2030. Jusqu’ici, l’Union européenne a fourni 85% des 4,5 milliards déjà récoltés, mais la prochaine période budgétaire de l’UE, qui débute en 2028, obligera les pays concernés à redemander des fonds pour combler un manque estimé à 8 milliards d’euros. -

Portugal
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.nrc.nl/nieuws/2025/10/21/kabel-verongelukte-tram-in-lissabon-was-ongeschikt-voor-vervoer-passagiers-a4910234 (21 octobre 2025) Le câble qui a provoqué l'accident de funiculaire à Lisbonne n'était pas adapté au transport de passagers Le câble qui s'est détaché et a provoqué l'accident mortel de funiculaire à Lisbonne ne répondait pas aux exigences du transporteur Carris. Selon les enquêteurs, il n'est pas encore possible de déterminer avec certitude si cela est à l'origine de l'accident. Le câble qui s'est détaché, qui avait été remplacé près d'un an avant l'accident, ne répondait pas aux exigences fixées par le transporteur Carris pour l'utilisation du tramway à câble Glória, concluent aujourd'hui les enquêteurs. Non seulement le câble n'était pas adapté au transport de personnes, mais il n'était pas non plus adapté « à une installation avec des raccords rotatifs aux extrémités ». Or, c'est bien le cas du tramway à câble Glória, selon le rapport d'enquête. Selon les enquêteurs, il n'est pas encore possible de déterminer avec certitude si c'est la raison pour laquelle le câble s'est détaché. Des câbles identiques avaient déjà été utilisés sans problème sur les funiculaires Glória et Lavra. https://news.sky.com/story/report-reveals-failings-that-led-to-deadly-lisbon-funicular-crash-13454222 Lorsqu'il s'est cassé, les systèmes de sécurité ont coupé l'alimentation électrique de la voiture, ce qui signifie que le frein pneumatique ne fonctionnait plus. Le frein manuel n'était pas suffisant pour l'empêcher de dévaler la pente raide. Le rapport décrit également cinq cas dans lesquels les normes d'entretien du funiculaire étaient « inexistantes, inapplicables ou obsolètes ». Les enquêteurs ont précisé que le rapport n'avait pas pour objectif de déterminer les responsabilités ou les fautes. Un rapport plus complet est attendu pour l'année prochaine. https://www.lemonde.fr/international/article/2025/10/20/accident-de-funiculaire-a-lisbonne-le-cable-reliant-les-deux-cabines-n-etait-pas-aux-normes_6648297_3210.html Mais les points de fixation du câble aux cabines ne sont visibles qu’au moment de leur remplacement, tous les deux ans, a expliqué à l’Agence France-Presse (AFP) l’expert Carlos Neves, président du collège d’ingénierie mécanique de l’ordre des ingénieurs. Les enquêteurs du GPIAAF ont en outre mentionné dans leur rapport que les opérations régulières d’entretien avaient bien été « enregistrées comme exécutées », sauf qu’ils ont également « recueilli des éléments selon lesquels ce registre ne correspond pas aux tâches réalisées effectivement ». Les éléments préliminaires du rapport ont également établi que le conducteur de la cabine avait bien activé les deux systèmes de frein dont elle dispose, mais ceux-ci n’étaient pas conçus pour arrêter le wagon sans l’aide de l’effet de contrepoids. « C’est une faille structurelle de sécurité », résume M. Neves. Cet ingénieur s’étonne qu’un déraillement sans gravité survenu en 2018 n’ait pas conduit à un renforcement des dispositifs de sécurité du funiculaire de Gloria. https://theportugalpost.com/posts/fatal-glria-crash-forces-lisbon-to-ground-iconic-funiculars Les premières conclusions du GPIAAF mettent en évidence un « point de défaillance unique » au niveau de l'ancrage du câble, aggravé par des mécanismes de freinage conçus pour un câble entièrement tendu. [Le maire Carlos] Moedas a ordonné à Carris, la société de transport publique de la ville, d'arrêter les funiculaires de Bica, Lavra et Graça, trois autres funiculaires construits par l'ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier de Ponsard, et de procéder à des audits de sécurité approfondis. Jusqu'à la semaine dernière, le réseau affichait un bilan de sécurité enviable ; le dernier accident mortel survenu dans un funiculaire de Lisbonne remontait à 1963. Cependant, le statut qui leur vaut d'être représentés sur des cartes postales dignes de l'UNESCO les exempte également de la surveillance normale de l'autorité portugaise chargée de la sécurité ferroviaire. Ils sont plutôt contrôlés par un ensemble disparate de réglementations patrimoniales, municipales et maritimes (!), un arrangement qui, selon les critiques, a permis aux outils modernes d'analyse des risques de passer entre les mailles du filet bureaucratique. Moedas insiste sur le fait que « la nostalgie ne peut primer sur la sécurité » et laisse entendre que la ligne Glória ne pourrait rouvrir qu'avec un système presque entièrement nouveau, dissimulé sous une façade rétro. https://www.bbc.com/news/articles/c20pg8pzp2no [Le rapport] a également recommandé de combler un vide juridique qui permet aux funiculaires historiques de Lisbonne d'échapper à la surveillance juridique et réglementaire qui s'applique aux autres moyens de transport à câbles. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a été réélu le 12 octobre malgré les accusations de l'opposition selon lesquelles il aurait manqué à son devoir de surveillance des funiculaires de la ville. -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20251021-de-l-usine-à-la-plage-les-tribulations-d-un-granulé-de-plastique-qui-fait-pleurer-les-sirènes "Entre 52.140 et 184.290 tonnes de granulés [de plastique] ont été perdus dans l'environnement au sein de l'UE en 2019", selon la Commission européenne. Une régulation pour empêcher les pertes doit être votée jeudi par le Parlement européen. L'Organisation maritime internationale (OMI) a émis des recommandations, non contraignantes, mais déjà suivies par des poids lourds du secteur. Du côté des transformateurs, "on peut arriver au zéro fuite" avec ces nouvelles règles, estime Caroline Chaussard. -

Israël et voisinage.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de loki dans Politique etrangère / Relations internationales
https://elpais.com/television/2025-10-06/alemania-amenaza-con-retirarse-de-eurovision-si-se-veta-a-israel-es-un-escandalo-que-se-este-discutiendo-siquiera.html (6 octobre 2025) L'Allemagne est favorable à un retrait de la prochaine édition du Concours de l'Eurovision si Israël en est exclu. C'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand, Friedrich Merz, dans une interview accordée à la chaîne publique ARD. Interrogé sur la question de savoir si l'Allemagne devrait renoncer volontairement à participer au concours qui se tiendra en mai à Vienne au cas où Israël ne serait pas autorisé à y participer, il a assuré dimanche qu'il « soutiendrait » le retrait de l'Allemagne. « Je trouve scandaleux que cela soit même discuté. Israël doit être présent », a déclaré M. Merz. Ces déclarations tendent la situation au sein de l'Union européenne de radio-télévision (UER), où d'autres pays comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Islande, la Slovénie et l'Irlande ont déjà fait part de leur décision de quitter le festival si Israël y participe. La décision sera votée lors de la réunion qui se tiendra en novembre à l'UER, l'organisme chargé d'organiser le concours européen de la chanson. Jusqu'à présent, seuls quelques pays ont publiquement exprimé leur position à l'égard de ce vote. L'Espagne a été le premier pays du Big Five (les cinq pays qui apportent la plus grande contribution financière à l'UER) à confirmer son opposition à la participation d'Israël. Et l'Allemagne a été le premier de ce même groupe à lui apporter son soutien, ce qui a accru les tensions au sein de l'organisation. La Grèce, l'Italie et l'Autriche, pays hôte, se sont déclarés favorables à la participation d'Israël, tandis que d'autres pays ne se sont pas encore prononcés. Dans le même temps, la KAN, la télévision publique israélienne, a annoncé le lancement de la présélection qui permettra de choisir son représentant et a rendu publique la couverture qu'elle assurera de l'Eurovision sur ses différentes chaînes. https://www.timesofisrael.com/carney-says-canada-will-arrest-netanyahu-if-he-visits-in-keeping-with-icc-warrant/ (20 octobre 2025) Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il respecterait le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale à l'encontre du premier ministre Benjamin Netanyahu et qu'il le ferait arrêter s'il se rendait au Canada. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.eurotopics.net/fr/346901/ukraine-un-sommet-trump-poutine-peut-il-avoir-un-impact# Marco Rubio et Sergueï Lavrov, se sont entretenus lundi par téléphone, il n'est pas certain qu'ils se rencontreront personnellement lors d'une réunion préparatoire. Selon la chaine d'information américaine CNN, les différends seraient trop importants. Moscou a indiqué que la tenue d'un sommet n'avait pas encore été convenue. Dans The Moscow Times (Pays-Bas, 20 octobre 2025), le sociologue Viktor Nebochenko estime que les motivations de Trump sont tout autres : Le but de Trump n'est pas de régler le conflit ukrainien, mais de tenter à nouveau d'amener Poutine à trahir Pékin. C'est à juste titre que l'UE n'est pas invitée, estime le média pro-Fidesz Vasárnap (Hongrie, 21 octobre 2025) : Alors que Bruxelles cherche à obtenir la victoire de l'une des parties au conflit, l'administration américaine veut voir s'installer la paix en exhortant les deux camps à faire des concessions et à céder sur certains points. Et ne nous faisons pas d'illusions : c'est la seule position réaliste aujourd'hui. Des Européens, Zelensky ne peut pas attendre grand-chose, estime le quotidien Die Welt (Allemagne, 20 octobre 2025) : Pour le moment, les propos prétentieux de garanties de sécurité ne servent qu'à appâter la galerie en Ukraine et en Europe. Les engagements des Européens à livrer des armes se sont effondrés de façon dramatique cet été. Par des tours de passe-passe, Bruxelles cherche maintenant à racler des milliards supplémentaires pour soutenir l'Ukraine en mettant à disposition des avoirs russes gelés (prêts dits de réparation). Si l'Europe ne passe pas rapidement à l'action, Poutine risque de gagner cette guerre dans peu de temps. -

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/world/2025/oct/21/pm-sanae-takaichi-japan-prime-minister Des reportages suggèrent que les partisans du PLD de Takaichi ne sont pas susceptibles d'accepter l'ensemble des 12 points du programme d'Ishin, notamment une réduction de 10 % du nombre de sièges à la Chambre basse – une mesure qui lui donnerait plus de poids au sein de la chambre –, une suspension de deux ans de la taxe à la consommation de 8 % sur les denrées alimentaires et l'interdiction des dons politiques des entreprises. Elle n'a pas évoqué la réforme constitutionnelle – un projet cher à son mentor belliciste, Shinzo Abe – et a renoncé à se rendre au festival d'automne du Yasukuni, un sanctuaire controversé dédié aux guerriers à Tokyo, apparemment pour éviter une dispute avec la Chine. « L'ère de la domination du PLD est révolue et nous entrons dans l'ère du multipartisme », a déclaré Chiyako Sato, commentatrice politique et rédactrice en chef du quotidien Mainichi Shimbun. Masato Kamikubo, professeur à l'université Ritsumeikan, a déclaré que Takaichi serait trop contrainte par la nature transactionnelle de sa coalition. « Takaichi n'a aucune marge de manœuvre pour montrer ses véritables couleurs. Tout ce qu'elle peut faire, c'est [chercher] à obtenir la coopération sur chaque politique. C'est une situation pathétique. » -

Japon
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20251021-japon-sanae-takaichi-une-première-ministre-face-à-une-montagne-de-défis Le PLD, affaibli par des scandales et des revers électoraux, a perdu la majorité absolue dans les deux chambres et ne peut plus compter sur son partenaire traditionnel, le parti centriste du Komeito, qui a rompu leur alliance historique. Le refus du PLD de mieux encadrer les financements politiques est la cause principale de ce divorce, mais aussi les positions ultraconservatrices de Takaichi qui ont placé le Komeito dans une situation inconfortable. Takaichi - qui a multiplié les discussions en vue d'une alliance alternative - a fini par signer un accord de coalition avec le Parti japonais pour l'innovation (Ishin), formation réformatrice de droite. Le PLD contrôle 196 sièges à la chambre basse du Parlement, et Ishin 35 sièges. Si cela leur permet d'obtenir 231 sièges à la chambre basse du Parlement, soit deux de moins que la majorité, cela signifie que la nouvelle coalition aura toujours besoin du soutien d'autres partis pour faire passer des lois. [mathématiquement, c'est pas pire que le Komeito qui n'a que 24 sièges ; mais on peut comprendre que le Komeito, éreinté aux dernières élections : il possédait 32 sièges antérieurement - cherche à se refaire une santé en passant dans l'opposition] La Première ministre - qui a travaillé deux ans aux États-Unis dans les années 1980 - cherchera dans un premier temps à préserver une relation « chaleureuse » avec le président américain, s’appuyant sur la proximité idéologique et l’héritage d’Abe. -
14 octobre 2025. Trois historiens, Niall Ferguson, Victor Davis Hanson et Stephen Kotkin débattent de l'importance de l'ère Trump dans l'histoire américaine. Qu'est-ce que la postérité retiendra de cette époque ? Il est question en particulier de la Chine et Taïwan, de la dette, des universités. Le présentateur, Peter Robinson, est une ancienne plume de Ronald Reagan.
-

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
En fait les eurodéputés ne sont guère différents de leurs homologues chinois, répétant les éléments de langage de la propagande de leur camp. On est comme dans 1984 d'Orwell où l'état de guerre profite aux différents régimes, et donc il est plutôt dans l'intérêt des régimes que l'état de guerre perdure, et que l'incompréhension entre les différents empires perdure. Donc il est hors de question de dire des choses qui permettraient de comprendre ce qui se passe. Il faut maintenir le peuple dans l'ignorance et la "servitude volontaire" comme dirait La Boétie. -

Chypre un conflit gelé ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Connorfra dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.eurotopics.net/fr/347002/reunification-de-chypre-une-nouvelle-opportunite Changement au pouvoir à Chypre-Nord : le leader de l'opposition, le social-démocrate Tufan Erhürman (CTP), a remporté l'élection présidentielle. Il s'était clairement opposé dans la campagne à Ersin Tatar, un proche du chef d'Etat turc Tayyip Erdoğan, et le président sortant de la république non reconnue internationalement. Erhürman entend relancer les négociations sur la question chypriote et se dit favorable à un rapprochement avec l'UE. Naftemporiki (Grèce, 20 octobre 2025) évoque le vainqueur du scrutin : «Erhürman, un universitaire et ancien 'Premier ministre' du pseudo-Etat, avait privilégié dès le départ une rhétorique de modération, de dialogue et de prise de distance vis-à-vis d'Ankara. Pendant la campagne électorale, il a souligné la nécessité du 'respect et de l'équité' dans les relations avec la Turquie et d'un retour à la table des négociations, dans le but d'établir une fédération bizonale et bicommunale. Ce message a trouvé un écho favorable dans une société lassée par la politique de Tatar et l'influence croissante d'Ankara sur les affaires intérieures des Chypriotes turcs. Ce scrutin pourrait permettre de sortir de l'impasse diplomatique, qui perdure depuis [l'échec des négociations de l'ONU en 2017 à] Crans-Montana.» L'espoir ressurgit, se réjouit Politis (Chypre, 20 octobre 2025) : «Les Chypriotes turcs ont clairement rejeté la solution à deux Etats et se sont clairement opposés aux tentatives visant à oblitérer leur identité séculière. Dans les territoires occupés, le leader de l'opposition, le président du Parti républicain turc (CTP), Tufan Erhürman, a été élu président des Chypriotes turcs, avec 62 pour cent des voix contre 35 pour son rival. Une victoire écrasante qui envoie un message sans ambages des Chypriotes turcs dans tous les domaines de leur existence, aussi bien dans les questions qui concernent leur quotidien, que dans la question centrale, qui est évidemment la question chypriote.» -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.eurotopics.net/fr/347000/trump-suit-il-de-nouveau-la-ligne-de-poutine Die Presse (Autriche, 18 octobre 2025) déplore que l'UE ne se soit pas attelée à élaborer son propre plan de paix : « Il n'y a toujours pas de canal diplomatique existant avec le Kremlin. Cela rend l'Europe tributaire du locataire de la Maison-Blanche. Le fait que le prochain sommet Trump/Poutine ait lieu dans le pays de l'UE qui s'emploie à torpiller à chaque occasion une ligne européenne commune est un acte délibérément malveillant. Ce faisant, Trump et Poutine enfoncent un coin dans l'UE, qu'ils cherchent tous deux à affaiblir le plus possible. Le Premier ministre, Viktor Orbán, y concourt de bon gré. Mais personne n'a empêché l'UE d'élaborer elle-même un plan réaliste pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Désolé, on n'entrevoit aucune diplomatie, juste du vent ». -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
Comme si l'agression russe contre l'Ukraine aurait eu lieu si cette dernière n'avait pas fait acte de candidature à l'OTAN... -

Bolivie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Borisdedante dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/10/20/en-bolivie-le-candidat-de-centre-droit-rodrigo-paz-elu-president_6648183_3210.html Le candidat de centre droit Rodrigo Paz élu président Cet économiste de 58 ans, qui a battu au second tour son rival de droite Jorge Quiroga, doit faire face à une crise économique aiguë. Il ne disposera pas d’une majorité au Parlement, ce qui va le contraindre à former des alliances. Evo Morales n’a pas pu se présenter en raison de la limite des mandats. Il a ainsi encouragé le vote nul au premier tour. Les bulletins invalides ont atteint 19,8 % des suffrages, un record depuis 2002. Après avoir voté dans son fief du Chapare, l’ancien chef d’Etat, premier président amérindien du pays, a jugé que les propositions des deux candidats témoignaient d’un « manque de respect » envers le peuple bolivien. « Les crédits du FMI et de la Banque mondiale sont conditionnés à la privatisation des ressources naturelles », a-t-il dénoncé. « Penser que les prêts internationaux vont résoudre nos problèmes économiques est une erreur totale », a-t-il aussi déclaré, plaidant « pour une hausse des programmes sociaux ».- 159 réponses
-
- bolivie
- amérique du sud
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Voir aussi Jonathan Haslam : https://forum.air-defense.net/topic/26674-guerre-russie-ukraine-2022-g%C3%A9opolitique-et-%C3%A9conomie/page/1098/#comment-1766443 -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
On gagne à mieux connaître Joseph Kennedy. Cela nous vaccine de l'imagerie : les démocrates c'est les gentils, les républicains c'est les méchants. Par exemple c'est Barack Obama qui a dégagé le buste de Churchill de la Maison Blanche. (Et c'est Trump qui l'y a replacé). Pourquoi ? Parce que Barack Obama avait peut-être de la suite dans les idées et avait vraiment l'intention de faire un "pivot vers l'Asie", c'est à dire d'inverser la priorité du théâtre européen, par rapport à la lutte contre le Japon, la statégie "Europe First" décidée par Roosevelt et Churchill lors de la conférence de Washington dite "Arcadia", du 22 décembre 1941 au 14 janvier 1942. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
J'adore m'intéresser à des choses dont tout le monde se fout. On ne peut pas me faire un plus grand compliment. C'est la garantie de ne pas succomber à l'effet de mode : s'intéresser à quelque chose parce que tout le monde s'y intéresse. Peut-être parce qu'ils avaient compris que l'énergie est la clé de la civilisation - c'est la théorie de Joseph Tainter. Cela les place également du côté de Margaret Thatcher, grande défenseuse des tubes d'hydrocarbures russes : tenant tête à Ronald Reagan, elle était pour le gazoduc "parce qu'elle a vraiment envie de voir le problème comme un problème de souveraineté énergétique européenne" : Bref, « Ma conviction est que nous ne pouvons pas éviter de négocier avec la Russie ». « Nous avons un problème qui est que nous sommes un continent avec très peu de ressources » « Et le chemin que nous devons suivre a en fait une partie commune avec la Russie, parce qu'ils sont nos voisins » Jean-Marc Jancovici -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est à peu près la position de Joseph Kennedy, le père de John Fitzgerald, affilié au parti démocrate et ambassadeur des États-Unis à Londres. C'est aussi à peu près la position des historiens britanniques John Charmley et Maurice Cowling. Ou tout simplement celle de Neville Chamberlain : - Et ce n'est peut-être pas totalement un hasard si un petit-fils de Joseph Kennedy se retrouve dans l'administration Trump : J'ai appris récemment aussi que Joseph Kennedy avait aidé Erich Maria Remarque . Mais les deux époques, celle de la seconde guerre mondiale et la nôtre, sont incommensurables à cause de l'arme atomique. Nous savons maintenant que les superpuissances atomiques, quand elles se font la guerre par proxy interposé, doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de règles du jeu, pour que cela n'escalade pas jusqu'au conflit nucléaire. C'est ce qu'a appris John Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. À ce sujet, il y a une scène très brève mais significative dans le film "Un Parfait Inconnu" sur Bob Dylan, où l'on voit les embouteillages lorsque les New-yorkais qui en ont les moyens fuient la ville car ils pensent qu'elle va imminamment être anéantie par une bombe atomique. Les Américains ont une psyché très particulière vis à vis des Russes et on ne peut pas se contenter, comme l'auteur de la caricature, de leur plaquer nos propres projections. Ils ont leur propre image de la Russie, marquée par leur histoire. C'est aussi une histoire de business deals, comme l'achat de l'Alaska. https://www.liberation.fr/international/amerique/trump-juge-interessante-lidee-dun-tunnel-reliant-la-russie-a-lalaska-20251018_XXZQUN7IUZAGRA5KHVBSCHWAJU/ Donald Trump a évoqué vendredi 17 octobre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky la construction d’un tunnel sous-marin reliant la Russie à l’Alaska. Cette idée farfelue, suggérée la veille par un haut responsable russe au multimilliardaire Elon Musk, venait tout juste d’arriver aux oreilles du président américain via la question d’un journaliste. Trump l’a jugée «intéressante», mais a ajouté qu’il allait «devoir y réfléchir». -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Et pour achever d'horrifier les anti-russes primaires, ajoutons qu'Angela Merkel avait mis un portrait de Catherine la Grande dans son bureau à la chancellerie. Probablement parce que c'était une femme, une allemande, une chef d'État d'un grand État européen. Angela Merkel parle parfaitement le russe et elle remporté de nombreux prix de russe quand elle l'étudiait dans sa jeunesse. Elle s'exerçait en dialoguant avec les soldats russes postés en Allemagne de l'Est. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/lettonie-1gnrl.htm La Lettonie apparaît aujourd'hui comme un pays scindé, avec peu de contacts entre, d'une part, la population lettonophone, d'autre part, la population russophone. Celle-ci est surtout présente dans les grandes villes, comme Riga ou Daugavpils, et elle ne parle pas nécessairement la langue officielle de son pays, et ce, d'autant plus que les membres de cette communauté travaillent généralement dans le secteur privé. Or, la maîtrise du letton n'est obligatoire que dans la fonction publique. Le même cloisonnement est valable du côté lettonophone. Pourtant, une meilleure reconnaissance de la minorité russophone pourrait apaiser les tensions entre les deux grands groupes linguistiques, surtout si la minorité russophone acceptait d'apprendre le letton comme langue seconde. La Lettonie aurait à gagner à reconnaître des droits linguistiques étendus aux russophones, sans nécessairement accorder le statut de co-officialité à la langue russe, car le letton n'est pas le poids qu'il lui faudrait pour affronter le russe sur un pied d'égalité. Néanmoins, les arguments avancés par les partisans de l’officialisation du russe ne manquaient pas de bien-fondé. Le russe est une des langues les plus importantes du monde par sa diffusion. Le poids démographique des russophones en Lettonie, près de 30%, justifierait la reconnaissance du russe comme langue co-officielle. D'ailleurs, la Belgique, l’Irlande, Malte, la Norvège et la Suisse sont des États officiellement bilingues ou trilingues. En Finlande, la minorité suédophone, qui représente seulement 5% de la population, bénéficie de la co-officialité avec le finnois. Toutefois, la situation linguistique en Lettonie semble très différente dans la mesure où la langue officielle est très vulnérable. En effet, le letton est une petite langue parlée par deux millions de locuteurs, alors que le russe est parlé par 154 millions de locuteurs comme langue maternelle et par 100 millions de locuteurs comme langue seconde pour un total de 254 millions. Dans un cas d'égalité juridique, le letton serait nécessairement en péril face à la force de la langue russe. C'est pourquoi il faut accorder au letton plus de poids juridiques pour compenser son inégalité numérique. La situation en Lettonie a bien changé au cours des dernières années, car la plupart des russophones du pays ne s'opposent pas ouvertement à la réforme scolaire qui vient d'être adoptée. D'ailleurs, les parents russophones envoient de plus en plus leurs enfants dans des écoles lettonnes afin qu'ils puissent s'exprimer aisément dans la langue officielle. Pour ce qui est des autres minorités, notamment les communautés ukrainiennes et juives, non seulement elles ne s'opposent pas à la réforme scolaire, mais elles l'appuient. On peut y déceler une attitude revancharde des Lettons à l'égard de la langue russe, et on aurait raison. Mais l'invasion de la Russie en Ukraine a traumatisé les Lettons qui appuient massivement les Ukrainiens. Lorsque, au journal télévisé en soirée, les Lettons regardent les horreurs de la guerre en Ukraine, ils revoient l’occupant soviétique dans leur pays et se rappellent la mise au rancart de leur langue, de leur culture réduite à un rôle folklorique et des milliers de personnes envoyés au goulag. Toutes les chaînes de télévision en provenance de la Russie sont aujourd'hui interdites. Les symboles de l’Union soviétique sont maintenant perçus comme des signes d’agression; beaucoup de monuments rappelant cette époque honnie sont aujourd'hui détruits. Le gouvernement letton a complètement fermé ses frontières avec la Russie, y compris les touristes et les jeunes hommes qui fuient leur pays de crainte d'être transformés en chair à canon. Les plus grandes victimes de cette guerre en Lettonie sont les russophones [donc y compris des Ukrainiens !] qui voient fondre leurs droits comme neige au soleil ! https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/lettonie-3polminor.htm Bien que certaines communes aient embauché des traducteurs, les dispositions de la Loi sur la langue officielle peuvent défavoriser les membres des minorités lorsqu'ils veulent communiquer avec l'Administration publique. Beaucoup de Russes, de Biélorusses, d'Ukrainiens et de Polonais ne maîtrisent pas suffisamment la langue officielle, le letton, pour pouvoir soumettre des documents dans cette langue. Rappelons que les documents soumis dans d’autres langues que le letton sont refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction en letton, certifiée devant notaire. Pour un grand nombre des membres des communautés minoritaires, le coût de la traduction et de la certification devant notaire peut paraître trop lourd à assumer. De plus, certains groupes sont particulièrement plus vulnérables, comme les prisonniers et les personnes russophones faisant l’objet de poursuites judiciaires; les pétitions, plaintes ou autres documents rédigés en russe sont simplement refusés par les instances administratives. C'est pourquoi la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_européenne_contre_le_racisme_et_l'intolérance ] demande aux autorités lettones de surveiller l'application de la loi et de veiller à ce que les dispositions régissant l’emploi de la langue dans les communications avec les organismes publics ne limitent pas l’accès à ces organismes, en particulier aux personnes maîtrisant mal le letton et n’ayant que de faibles ressources financières. La législation en vigueur ne précise rien en ce qui a trait aux communications orales dans l'administration de l'État, hormis pour la langue de travail des employés (en letton). Il n'y a pas de bilinguisme officiel autorisé dans les rapports oraux avec les administrés, mais ce n'est pas interdit, du moins dans un bureau et en personne. Cependant, il arrive que les employés de l’État doivent connaître la langue d’une minorité nationale si cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. Par exemple, un policier en exercice dans une grande ville à majorité russophone doit pouvoir s’exprimer en russe auprès des citoyens. Dans les demandes orales, les fonctionnaires ne sont pas formellement tenus de répondre en une autre langue qu’en letton. Toutefois, la très grande majorité des fonctionnaires utilisent quand même le russe, d’une part, parce qu’ils le connaissent, d’autre part, parce qu’il est inutile de demander aux personnes âgées non lettones d’apprendre le letton. En 2002, la transition vers le letton dans les écoles secondaires était soutenue par environ 41% des enseignants, des élèves et des parents; en 2004, elle était soutenue par 15% des élèves, 30% des enseignants et 13% des parents. Les élèves étaient bien conscients de la nécessité de la langue lettone, mais la plupart la rejetaient comme langue d'étude. Ce programme national ne tient plus! Depuis février 2022, la Lettonie voit avec horreur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine, ce qui suscite une certaine animosité à l'égard des russophones. Néanmoins, à la fin du mois de janvier 2018, le gouvernement avait déjà approuvé les modifications législatives à la Loi sur l'éducation de 1998; le Parlement avait commencé à discuter des projets de loi sur cette question. Les législateurs ont également rejeté la pétition appelant à la préservation de l'enseignement bilingue en Lettonie, signée par plus de 10 000 citoyens lettons. Après la réforme, la proportion des matières enseignées en letton dans les écoles des minorités ethniques devra atteindre au moins 50 % de la 1re à la 6e année ; 80 % de la 7e à la 9e année et 100 % de la 10e à la 12e année. Les écoles pourront toujours enseigner la langue, la littérature, ainsi que les matières liées à la culture et à l'histoire dans les langues maternelles des minorités. L’introduction progressive de la langue officielle dans les programmes d’enseignement pour les minorités semble avoir amélioré sensiblement la maîtrise du letton. Ainsi, en 1989, soit dans les dernières années de l’Union soviétique, seuls 23% des habitants non lettons pouvaient communiquer en letton, mais en 2009, cet indicateur atteignait plus de 90%. Les controverses C'est évidemment sur la communauté russophone que l'impact de la réforme en éducation pèse le plus, car les russophones représentent de loin la première minorité de Lettonie, représentant 24% de la population de ce petit pays de 1,8 million d'habitants, loin devant les autres minorités (Polonais, Juifs, Ukrainiens et Bélarusses) dans un État où les Lettons, eux, ne forment que 62% de la population. Pour les russophones, la réforme du système d'éducation en Lettonie a pour effet d'abandonner l'enseignement secondaire dans les langues minoritaires, lequel a existé dans le pays durant un siècle, y compris la période de l'indépendance avant la Seconde Guerre mondiale. Cette réforme est perçue par les membres de la minorité russophone comme une violation de leurs droits et une discrimination manifeste. Les représentants de la minorité russophone affirment que l'application de la nouvelle législation norme 60/40 en matière d'éducation publique a un impact négatif sur la capacité des élèves à recevoir leur enseignement. Ils croient que cette modification privera les 10 000 élèves russophones de ces écoles secondaires de bénéficier d'un environnement culturel favorable à leur langue maternelle. De plus, le gouvernement russe, les médias russes et le parti pro-Kremlin Latvijas Krievu savienība (Union lettone-russe) capitalisent sur cette question comme un exemple clair de discrimination contre les minorités russes, le Parlement russe allant jusqu'à menacer de sanctions la Lettonie si les réformes étaient mises en œuvre. L'un des principaux arguments utilisés est que l'enseignement de la langue lettone était autorisé à l'époque soviétique, il est donc juste que les russophones bénéficient des mêmes droits aujourd'hui. L'argument souvent utilisé contre ce droit est que la Lettonie n'a pas choisi d'être illégalement occupée et annexée par l'Union soviétique, mais cette interprétation rend la question encore plus épineuse, car le gouvernement russe et certains russophones en Lettonie rejettent l'idée que l'occupation lettone était illégale. 6 Les médias, la vie économique et sociale En janvier 2023, la Lettonie vivait encore dans un espace d'information dans lequel la langue russe était absolument dominante, selon le Conseil national des médias électroniques de masse (NEPLP). On comptait alors 252 médias disponibles en Lettonie, dont 127 d'entre eux diffusaient en russe et seulement 42 en letton. Plusieurs stations de radio russophones qui ne tenaient pas compte des dispositions juridiques furent suspendues par le Conseil national des médias électroniques. Le même conseil a souvent reproché aux chaînes de télévision lettones de diffuser trop de films en russe. En cas d'infractions répétées, le Conseil peut aussi intenter une action contre la chaîne ou la station, et demander le retrait de la licence. Le résultat immédiat des restrictions linguistiques dans les médias électroniques a eu pour effet d'inciter les russophones de se tourner vers la télévision par câble ou par satellite dont les stations émettent en russe. Bref, c'est un effet pervers qui fait perdre à la fois des revenus aux médias lettons et limite l'intégration sociale tant désirée par les autorités lettones. Des citoyens russophones ont contesté devant les tribunaux le système des quotas imposés par la loi. Après avoir refusé d'entendre la cause pour des raisons de procédure, la Cour constitutionnelle de Lettonie a annulé, le 6 juin 2003, les restrictions sur l'usage des «langues étrangères» (celles des minorités) à la radio et la télévision nationales. Dans leur réponse écrite, les juges ont estimé que les minorités nationales avaient le droit reconnu de préserver et de développer leur langue et que la législation devait garantir l'usage illimité de leur langue le secteur public des médias électroniques. À leur avis, l'État a le devoir de garantir que le susdit droit est mis en œuvre et protégé contre toute violation. À l'heure actuelle, la quatrième station de radio, Latvijas Radio 4, diffuse la plupart de ses émissions en russe. La même station de radio diffuse, en raison d'une demi-heure par semaine, une émission (''Doma Laukums'') en latgalien. Latvijas Radio 4 diffuse des émissions d'information d'une demi-heure quotidienne dans les langues suivantes: en biélorusse, en ukrainien, en polonais, en lituanien, en estonien, en allemand, en arménien, en azéri, en géorgien, en grec, en yiddish et en tatar. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, toutes les chaînes de télévision en provenance de la Russie sont aujourd'hui interdites. [Conclusion] La politique linguistique pratiquée par la Lettonie à l'égard de ses minorités demeure ambiguë. L'objectif de vouloir intégrer les communautés minoritaires au sein de la société lettone est fort louable, mais cet objectif a entraîné aussi une grande hostilité entre les communautés lettone et russophone. Les Russes accusent la Lettonie de pratiquer une politique nationaliste et russophobe. Certes, la situation ethnique ne se compare nullement à celle de la Bosnie-Herzégovine ni à celle du Caucase. Il ne fait pas de doute que les Lettons vivent mal les souvenirs hégémoniques du russe, ainsi que la place modeste du letton sous le régime soviétique. Mais le système a créé deux «solitudes» qui ne se croisent jamais. Ainsi, les quotas imposés à la radio et à la télévision ont eu un effet pervers dans la mesure où les russophones se sont rués vers la télévision par câble et la télévision par satellite, alors que les chaînes lettones voient réduire leur auditoire de façon constante. La politique linguistique nationaliste a renforcé les positions de méfiance de la part des Lettons à tel point que les russophones ne veulent plus participer à la vie politique du pays. Ces derniers ont été marginalisés, pour ne pas dire exclus au sein de l'État letton. Il n'y a presque pas de russophones dans les structures hiérarchiques de l'État, pas plus que dans l'administration publique ou dans le monde judiciaire. Cette participation des russophones dans l'administration et la justice est estimée respectivement à 4% ou à 6%, pour ne pas dire à moins de 3%. De plus, le taux des chômeurs russophones est deux fois plus élevé que chez les Lettons. Alors que les détenus russophones forment 66 % des prisonniers, le taux est de 30 % pour les Lettons. Or, les russophones de la Lettonie sont là pour rester et ne s'en iront pas en Russie où ils ne seraient pas les bienvenus, et ils le savent trop bien! La plupart d’entre eux considèrent la Lettonie comme leur pays et ils ne connaissent pas la Russie, pourtant si proche. Dans un avenir peu lointain, on ne voit pas comment les Lettons accepteraient de restreindre leurs velléités nationalistes et de cesser leur lutte contre la langue russe. Par ailleurs, beaucoup de jeunes Lettons en ont assez d'être « contaminés » par la propagande nationaliste et revancharde; ils considèrent même que le discours des ultranationalistes est carrément « fanatique ». Dans l'état actuel des choses, le dialogue entre les deux principaux groupes linguistiques semble peu probable. Certains propos de l'ex-présidente de la Lettonie, Mme Vaira Vike-Freiberga (de 1999 à 2007) sont révélateurs de l'idéologie actuelle: «Il faut qu'ils comprennent que c'est un pays indépendant et que, s'ils deviennent des Lettons d'origine russe, ils seront avant tout des Lettons. S'ils veulent rester russes, qu'ils partent en Russie.» Lorsque le chef de l'État refuse verbalement qu'une minorité de 24% ait droit à sa langue, ses traditions et sa culture, l'exemple vient de haut. Il semble bien que la présidente du pays, qui a vécu quelques décennies au Canada (Montréal), ait oublié que le Québec traitait avec plus d'égard sa minorité anglophone. L'ex-présidente de la Lettonie, Mme Vaira Vike-Freiberga, déclarait en entrevue à un journaliste québécois : Il y a seulement un million et demi de Lettons au monde. C'est le seul endroit ici où l'on peut parler notre langue. À plus forte raison, on doit la protéger. On ne peut pas avoir deux langues officielles. Ce n'est pas possible. Ce point de vue est tout à fait légitime, mais l'unilinguisme officiel peut laisser la place à des accommodements tout à fait raisonnables en matière de langue. Le modèle letton est celui de l'unilinguisme, non le bilinguisme. Soucieux de conserver une image positive dans l’opinion publique internationale, notamment au Conseil de l’Europe, le gouvernement letton a intérêt à préserver les droits linguistiques des minorités nationales. Il conviendrait probablement que le gouvernement explique davantage sa politique linguistique dans des émissions de radio ou de télévision, ainsi que dans les médias écrits. Quant aux russophones, il leur faudra finir par accepter leur nouveau statut de minoritaires et oublier leurs réticences à l’égard de la Lettonie, leur «pays d’accueil». On peut certes soupçonner les raisons qui amènent les russophones à s'opposer à leur lettonisation, il ne faudrait quand même pas s'en étonner. Quelle communauté accepterait sa liquidation sans rien dire? Il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour les autorités lettones avant de parvenir à réussir l'intégration sociale de ses minorités, surtout la russophone. Les deux solitudes risquent de continuer à se tourner le dos! Pour le moment, la Lettonie doit encore composer avec les fantômes de son passé soviétique, car elle n'a pas réussi à tourner la page. Il faut admettre que l'invasion de la Russie en Ukraine a traumatisé les Lettons qui appuient massivement les Ukrainiens. Lorsque, au journal télévisé en soirée, les Lettons regardent les horreurs de la guerre en Ukraine, ils revoient l’occupant soviétique dans leur pays et se rappellent la mise au rancart de leur langue, de leur culture réduite à un rôle folklorique et des milliers de personnes envoyés au goulag. En un sens, la Russie de Vladimir Poutine conforte les Lettons à réduire les droits des russophones dans ce petit pays. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Distribution des Russes, Biélorusses et Ukrainiens en 2011 Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Latvia#Ethnic_groups -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Peut-être pour la même raison qu'il y a des Irlandais qui sont nés en Irlande et qui mourront en ne sachant pas parler irlandais. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.bbc.com/news/live/cy85d9613zxt (16 octobre 2025) Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait Vladimir Poutine en Hongrie pour poursuivre les discussions sur la fin de la guerre en Ukraine, à la suite d'un entretien téléphonique « très productif » entre les deux hommes. Trump a déclaré que de nouvelles discussions auraient lieu la semaine prochaine entre des « conseillers de haut niveau », menées du côté américain par le secrétaire d'État Marco Rubio. Un conseiller du Kremlin a déclaré que les discussions avaient été « substantielles » et avaient eu lieu à la demande de la Russie. La date n'est pas connue, mais Trump a déclaré que la réunion aurait lieu « dans environ deux semaines, assez rapidement ». Le Premier ministre hongrois déclare que les préparatifs du sommet sont déjà en cours. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2025-10/losverfahren-bundeswehr-strack-zimmermann-ablehnung (17 octobre 2025) La présidente de la commission de la défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a averti que l'Allemagne ne devait pas « être défendue au hasard ». Il ne faut « pas jouer à un jeu de hasard, mais élaborer un concept clair, équitable et conforme à la Constitution », a-t-elle déclaré. Le président de l'association des réservistes de la Bundeswehr, Patrick Sensburg, s'est prononcé en faveur d'une procédure de remplacement plutôt que d'un tirage au sort si le nombre de réservistes recrutés s'avérait insuffisant. « Ce serait la solution la plus simple et la plus équitable », a-t-il déclaré au RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). En effet, cela permettrait de sélectionner les candidats les plus qualifiés. Néanmoins, le tirage au sort n'est pas exclu : « Une sélection aura lieu de toute façon. » Reinhold Robbe, ancien commissaire aux forces armées du Bundestag allemand, a fait remarquer que les recrues tirées au sort pourraient se sentir perdantes. Elles pourraient alors être peu motivées pour servir, a déclaré le politicien du SPD, « ce qui serait catastrophique ». Un tirage au sort serait tout à fait inapproprié. M. Robbe s'est prononcé en faveur d'attendre de voir si le modèle prévu par le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) aboutirait au succès escompté. Ce dernier prévoit une réforme du service militaire sur le modèle suédois. Depuis 2017, les hommes et les femmes âgés de 18 ans doivent remplir un questionnaire sur la base duquel les candidats et candidates appropriés sont contactés. D'un point de vue juridique, ce modèle s'apparente au service militaire obligatoire, mais jusqu'à présent, le nombre de volontaires s'est toujours avéré suffisant. Pistorius prévoit de faire remplir un questionnaire aux jeunes Allemands, puis d'inviter les recrues potentielles à se présenter à la visite médicale. Cependant, seuls les hommes seront tenus de remplir ce questionnaire. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.russkije.lv/en/lib/read/schools-in-independent-latvia.html Les écoles pour les minorités russes dans la Lettonie de l'entre-deux-guerres En décembre 1919, le Conseil populaire de Lettonie (parlement provisoire du nouvel État) adopta des lois sur les établissements d'enseignement en Lettonie et sur l'organisation des écoles pour les minorités dans le pays, selon lesquelles les minorités nationales avaient le droit à l'autonomie dans la création et la gestion de leurs écoles. Des départements nationaux furent créés au sein du ministère de l'Éducation, dont le département russe. Le professeur Ivan Yupatov a dirigé ce département pendant 10 ans. Pendant une brève période, des écoles lettones, russes, biélorusses, allemandes, juives, polonaises, lituaniennes et estoniennes ont vu le jour en Lettonie. Le droit des minorités à l'éducation a ainsi été respecté, y compris le droit à l'enseignement secondaire dans leur langue maternelle. Seules l'histoire et la géographie de la Lettonie étaient enseignées en letton dans les écoles minoritaires à partir de la 5e année de l'école primaire. Dans les années 1920 et 1930, le taux d'alphabétisation de la population russe a augmenté de manière constante. Si en 1920, seuls 41,32 % des Russes lettons âgés de plus de 10 ans étaient alphabétisés, en 1930, ce pourcentage était passé à 62,74 %. Cette augmentation du taux d'alphabétisation a été facilitée par la création d'un réseau d'écoles primaires russes, en particulier dans les régions reculées de l'est de la Lettonie, en Latgalie. Cependant, tous les enfants russes n'ont pas terminé leur scolarité primaire. Seul un enfant sur 22 quittant l'école primaire poursuivait ses études dans le secondaire. Après le coup d'État du 1er mai 1934, les tendances nationalistes lettones se sont renforcées. Les relations des autorités avec les minorités nationales se sont fortement détériorées. La loi sur l'éducation nationale a supprimé l'autonomie des écoles. Elle a été suivie de directives sur la répartition des écoliers en fonction de leur appartenance ethnique, qui ont restreint le droit des parents de choisir la langue d'enseignement. Alors qu'au début des années 1930, il existait cinq lycées russes (à Riga, Daugavpils, Lūdza, Rēzekne et Jaunlatgale), à la fin des années 1930, il n'en restait plus que deux : à Riga et à Rēzekne, ainsi que le département russe du deuxième lycée de Daugavpils. En 1936, le dernier des nombreux lycées privés russes de l'époque, le O. Lishina Gymnasia, a été fermé. Au cours de l'année scolaire 1939/40, les écoles secondaires russes restantes comptaient 568 élèves, ce qui était clairement insuffisant pour répondre à la demande croissante des jeunes Russes en matière d'éducation. Les lycées lettons étaient surchargés et n'étaient pas en mesure d'accueillir de nouveaux élèves. https://www.russkije.lv/en/lib/read/oasis-of-russian-culture.html Une oasis de culture russe Dans le contexte de l'indépendance de la Lettonie entre les deux guerres mondiales, Riga est devenue l'un des centres culturels pour les Russes vivant à l'étranger. La population russe de Lettonie pouvait mener une vie riche en culture et en spiritualité. Le journal Segodnya était l'une des plus grandes publications en russe imprimées hors de Russie. Le seul théâtre russe fonctionnant en permanence hors de Russie, avec une brillante troupe d'acteurs, se trouvait à Riga. Tout comme les écoles russes minoritaires de Lettonie, le théâtre russe était financé par le budget de l'État letton. Des artistes russes talentueux ont créé leurs œuvres en Lettonie. De nombreux représentants célèbres de l'élite culturelle et scientifique russe ont visité Riga. Ivan Bounine, qui a reçu le prix Nobel en 1933, est venu à Riga, tout comme Ivan Chmelev. Fiodor Chaliapine a fait plusieurs tournées à Riga. Les habitants de Riga ont eu l'occasion de découvrir les œuvres du poète Alexandre Vertinsky. Les représentations du Chœur des Cosaques du Don ont laissé une impression inoubliable. De nombreux scientifiques russes de renom ont donné des conférences, parmi lesquels les philosophes Nikolaï Berdiaev, Ivan Il'ine et Semion Frank. La proximité avec la Russie et la présence d'une importante population russe locale ont attiré de nombreux émigrés russes de premier plan. « Grâce à sa position géographique, Riga, située à la jonction de deux mondes – celui de la Russie et celui de l'Europe occidentale –, invitait volontiers des artistes venus tant de l'Est que de l'Ouest. Les artistes russes qui voyageaient vers l'ouest ne pouvaient pas passer à côté de Riga, avec son accueil chaleureux et enthousiaste. À Riga, des solistes renommés du Théâtre Bolchoï ont donné des représentations : Barsova (soprano colorature), qui a magnifiquement interprété le rôle de Rosina dans « Le Barbier de Séville », Maksakova (Carmen), Sobinov, Zhadan – dans le rôle de Lensky dans « Eugène Onéguine » et d'autres. De l'Ouest venait Chaliapine, qui chantait en russe le rôle de Boris Godounov à l'opéra et apparaissait dans « La Sirène » ainsi qu'en concert. Les billets étaient vendus plusieurs mois à l'avance. Ses représentations étaient des événements auxquels les habitants de Riga de tous âges et de toutes nationalités se préparaient et dont ils se souvenaient longtemps », se souvient Natalya Sinayskaya, témoin oculaire des événements de ces années-là.