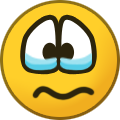-
Compteur de contenus
16 581 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
309
Tout ce qui a été posté par Picdelamirand-oil
-
En fait ça revient à mettre en vigueur par tranche parce que le temps qu'on fasse les 66 Rafale il se rendront compte que leurs beaux projets sont tous en retard et ils commanderont une nouvelle tranche. Peut être même une nouvelle tranche Marine (dont le vrai besoin est de 57 avions) et une nouvelle tranche IAF.
-
De quoi tu parles
-
Aucun autre concurrent du MRFA n'offre à l'IAF la même flexibilité que le Rafale. Si les murs du quartier général de l'armée de l'air pouvaient parler, vous n'entendriez qu'un seul mot ---> R-A-F-A-L-E. C'est la raison pour laquelle le F-35 et le Su-57 ne sont pas pris en considération dans le cadre du concours du MRFA. Quel que soit l'avion furtif de 5ème génération qui sera acquis, il sera séparé du concours MRFA. Du point de vue du QG de l'armée de l'air, il s'agit d'une décision intelligente -> acquérir un petit nombre de Rafales et mettre fin au concours. Tous les concurrents veulent une commande minimale de 100 avions pour mettre en place une chaîne de production. Pour éviter la pression géopolitique de Trump (forçant l'Inde à choisir un F-teen), il suffit d'acquérir un lot suivant (bien que petit) de Rafales. C'est bien moins cher que d'acquérir un tout nouveau type d'avion et aussi moins cher que 114 Rafales. Une fois que cela sera fait, il y aura peut être un concours de 5e génération, c'est-à-dire entre le Su-57 et le F-35. Après avoir investi 1 milliard de dollars dans l'ISE (plus un milliard supplémentaire dans l'infrastructure de base), il serait absolument stupide d'investir dans un autre chasseur de cette génération.
-
Rafale Surge: IAF Eyes 40 More Jets as Navy Deal Nears Signing https://bharatshakti.in/rafale-surge-iaf-eyes-40-more-jets-as-navy-deal-nears-signing/ Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Rafale : l'IAF veut 40 jets supplémentaires alors que le contrat avec la marine est sur le point d'être signé Dans un geste décisif pour renforcer la force de combat aérien de l'Inde qui s'amenuise, l'Indian Air Force (IAF) se préparerait à acheter 40 avions de combat Rafale supplémentaires à la France dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement (G2G) - parallèlement au contrat Rafale-M imminent pour la marine indienne, qui devrait être signé à Delhi le 28 ou le 29 avril lors de la visite du ministre français de la défense en Inde. Des sources bien placées ont confirmé à BharatShakti que des entretiens de haut niveau ont eu lieu récemment entre des responsables indiens et français, non seulement pour conclure les discussions sur les moteurs avec Safran pour le programme d'hélicoptères de l'Inde, mais aussi pour entamer les travaux préparatoires à une deuxième tranche d'avions de combat Rafale pour l'IAF dans le cadre de ce qui est décrit comme un accord MRFA-plus à procédure accélérée. Cet accord potentiel est distinct de l'acquisition du Rafale-M par la marine, mais il est considéré dans les cercles stratégiques comme faisant partie d'une consolidation plus large de l'écosystème de combat aérien de l'Inde, centré autour de la plateforme de combat française. L'IAF, qui ne dispose toujours que de 31 escadrons sur un effectif autorisé de 42,5, a signalé à plusieurs reprises sa crise opérationnelle au cours des dernières années. La crise des chasseurs de l'IAF : Un fossé trop large Au début de l'année, le maréchal-chef AP Singh a souligné la nécessité pour l'armée d'acquérir 35 à 40 nouveaux chasseurs par an pour compenser l'épuisement des escadrons et le retrait des appareils anciens. Alors que Hindustan Aeronautics Limited (HAL) se prépare à livrer 97 Tejas Mk-1A d'ici 2030, le rythme de production, la préparation des infrastructures et l'ampleur des besoins ont contraint l'IAF à se tourner à nouveau vers l'extérieur. Le projet d'avion de combat multirôle (MRFA), qui vise à intégrer 114 avions de combat étrangers dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel, est resté dans les limbes, aucune demande de proposition n'ayant été émise. Mais des initiés confirment qu'au vu des besoins urgents et de la familiarité opérationnelle avec la plateforme Rafale, l'avion français s'est imposé comme le grand favori, évitant ainsi la voie traditionnelle de l'appel d'offres. « Les deux parties sont parvenues à un accord stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'un achat, mais d'un plan de continuité », a déclaré un haut fonctionnaire au fait des négociations. Le contrat Rafale-M de la marine : le premier domino Entre-temps, la marine indienne est sur le point de signer un contrat de 63 000 milliards de roupies (environ 7,5 milliards de dollars) pour 26 chasseurs Rafale-M. Approuvé par le Comité de sécurité du Cabinet (CCS) au début du mois, le contrat comprend 22 chasseurs monoplaces basés sur des porte-avions et quatre avions d'entraînement biplaces. Ces avions opéreront à partir de l'INS Vikrant et remplaceront la flotte vieillissante des MiG-29K. Les livraisons devraient débuter vers 2028, pour une mise en service complète en 2031. Il est important de noter que le contrat de la marine comprend des ensembles d'armes, l'intégration du missile Astra, des installations MRO locales et la formation des équipages, autant d'éléments qui devraient également stimuler l'écosystème Rafale de l'IAF. Dix des 36 chasseurs Rafale de l'IAF font également l'objet d'une mise à niveau dans le cadre d'un programme parallèle afin d'intégrer des nacelles de ravitaillement en vol (buddy-buddy refuelling), des capteurs améliorés et des suites logicielles à portée étendue, ce qui souligne encore la dépendance à long terme de l'Inde à l'égard de la plateforme Rafale. Pourquoi le Rafale ? Testé au combat en Syrie, en Libye et au Mali et éprouvé dans le ciel indien lors d'opérations à haute altitude au Ladakh, le Rafale est devenu un élément essentiel de la posture de dissuasion de l'Inde. Doté de capacités de charge utile avancées, de missiles air-air Meteor, d'armes à distance de sécurité SCALP et d'un radar AESA, il représente un saut générationnel par rapport aux flottes de MiG-21, MiG-29 et Jaguar de l'IAF. En outre, le fait que le Rafale de l'IAF et le Rafale-M de la marine soient communs à près de 95 % permet de rationaliser la logistique, de partager des modules de formation et de réduire les frais généraux de maintenance - une convergence rare qui plaide en faveur d'une normalisation entre les services. Un modèle G2G pour la rapidité et la souveraineté L'abandon de l'appel d'offres ouvert dans le cadre de la MRFA au profit d'un modèle G2G est considéré comme un choix stratégique plutôt que comme un compromis. Compte tenu de l'évolution rapide des menaces sur deux fronts et des délais serrés pour le renforcement des capacités, le modèle G2G offre rapidité, garantie de livraison et continuité. Les analystes de la défense estiment que cette approche est également conforme à la politique indienne de « fabrication en Inde pour le monde ». Des discussions sont en cours pour accélérer l'assemblage national, approfondir les compensations industrielles et créer un solide écosystème MRO pour le Rafale en Inde - au-delà de l'IAF ou de la marine. Le chemin à parcourir : Un élan avec Dassault Alors que des concurrents comme le F-15EX, l'Eurofighter Typhoon et le Saab Gripen-E restent techniquement en lice dans le cadre original de la MRFA, la dynamique politique et opérationnelle penche visiblement en faveur de Dassault. La familiarité de l'IAF avec le Rafale, l'infrastructure de base existante et l'interopérabilité avec la marine confèrent à l'avion français un avantage certain. Si elle est approuvée, la deuxième tranche de 40 Rafale de l'IAF portera l'effectif total de la flotte à 76 appareils, ce qui équivaut à environ quatre escadrons complets. Cela permettrait non seulement de combler partiellement le déficit en escadrons, mais aussi de servir de contrepoids stratégique dans un contexte d'intensification des développements militaires régionaux, notamment la modernisation rapide de la PLAAF par la Chine et l'acquisition de chasseurs J-10C par le Pakistan.
-

[Tempest] Nouvel Avion de Combat Britannique En Partenariat !
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de SharkOwl dans Europe
sauf que les parties chaudes du M-88 (et du Sylvercrest , bon il parait qu'il marche maintenant) ont été faites par Safran. -

Guerres commerciales 2025 (version Trump)
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Vers une rupture géoéconomique totale sino-américaine ? Scénario de fragmentation accélérée et escalade militaire 1. Résumé exécutif Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis début 2025, la politique étrangère américaine s’oriente vers une découplage radical avec la Chine, à la fois économique, technologique et stratégique. Ce tournant marque une rupture avec l’ère précédente de compétition contrôlée, et ouvre la voie à une confrontation globale dont les premières étapes sont déjà visibles : sanctions commerciales massives, suspension de livraisons stratégiques, embargos ciblés, et début de répliques asymétriques de la Chine. Un scénario se dessine : la Chine pourrait estimer qu’un conflit avec les États-Unis est devenu inévitable à horizon deux ou trois ans. Elle pourrait alors adopter une stratégie d’anticipation préventive, en renforçant ses alliances (notamment avec la Russie) et en accélérant ses projets territoriaux (Ukraine/Taïwan), profitant du déséquilibre temporaire induit par l’isolationnisme américain et la fragilisation européenne. 2. Éléments factuels récents Droits de douane : Trump a porté les droits de douane à 145 % sur toutes les importations chinoises, provoquant une réponse graduée de la Chine jusqu’à 125 %. Boeing : la Chine annule la réception d’avions Boeing, affectant un quart des exportations du constructeur. Terres rares : Pékin suspend l’exportation de plusieurs catégories de terres rares critiques (samarium, terbium, dysprosium, etc.). Trump suspend les droits pour le reste du monde (sauf Chine) : mesure de désescalade partielle pour limiter les effets boomerang économiques. Effets internes : premiers signes de tensions financières, mouvements de protestation aux États-Unis. Coopération technologique réduite : l’usine TSMC en Arizona s’inscrit dans une logique de souveraineté industrielle stratégique. Rumeurs persistantes de coopération militaire accrue entre Chine et Russie. 3. Hypothèse stratégique Hypothèse centrale : Donald Trump considère qu’un conflit ouvert avec la Chine est inévitable à moyen terme (2026–2027). Son administration cherche à réduire d’urgence la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine (matériaux, semi-conducteurs, médicaments, batteries, aviation, etc.). Conséquence anticipée côté chinois : la Chine, percevant cette rupture comme un casus belli déguisé, se prépare à une stratégie de double-front : Soutien militaire direct à la Russie en Ukraine (livraisons d’armes, éventuellement forces spéciales). Action coordonnée ou simultanée sur Taïwan, lorsque l’attention américaine est divisée. 4. Risque de bascule géopolitique Scénario de rupture Guerre par procuration élargie en Ukraine : la Chine fournit des armes et des hommes à la Russie. L’Ukraine subit une pression accrue. Déclenchement d’une crise majeure à Taïwan. Blocage américain sur les moteurs d’avions civils à la Chine (hypothèse probable). Réduction drastique du commerce mondial, chaos sur les marchés des métaux stratégiques. Effondrement de la coopération internationale, reconfiguration des alliances (Europe, Inde, Moyen-Orient). 5. Facteurs d’incertitude / Points d’attention Variable État actuel À surveiller Inde Position prudente, non alignée Si elle bascule vers un partenariat UE/US Russie Opportunité accrue de reprise offensive Niveau de soutien chinois Opinion publique US Protestations en hausse Bascule politique intérieure Europe Divisée sur sa ligne stratégique Si elle se rapproche de l’Inde (scénario alternatif) Marchés financiers Volatils mais stables Point de bascule ? Rupture de confiance ? Taiwan Rumeurs d’activité militaire chinoise Escalade en coordination avec l’Ukraine ? 6. Conclusion – Pourquoi ce scénario est à surveiller Le scénario de rupture systémique sino-américaine, jusqu’ici marginal, est désormais techniquement enclenché. Le point de bascule pourrait ne pas venir d’un acte spectaculaire, mais d’une accumulation de tensions économiques, diplomatiques et militaires, rendant toute désescalade improbable. Ce scénario justifie : Une vigilance accrue sur les chaînes d’approvisionnement critiques (industrie, énergie, défense). Une réflexion stratégique sur l’autonomie européenne (y compris militaire). Une analyse approfondie des options de coopération avec l’Inde, puissance pivot potentielle. -
Cela dépend: cela peut être favorable si la Chine achète des Airbus à la place, mais la rétorsion américaine risque d'être un embargo sur les CFM pour bloquer la production d'avion civil en Chine alors là ce serait très négatif.
-

Guerres commerciales 2025 (version Trump)
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Lordtemplar dans Politique etrangère / Relations internationales
Bon les US vont mettre l'embargo sur les CFM pour bloquer la production d'avions civils Chinois. -
La Chine n'Achète plus de Boeing et tente d'annuler l'achat de 130 Boeing. Il y a plusieurs articles là dessus mais tout est dit.
-
Il n'y aura pas les taxes que l'Europe va mettre sur les produits Américains. A Bruxelles ils sont au courant...
-
Et tu pense que le block 4 est déjà arrivé? Pas avant 2031
-

[France] Armée de l'Air et de l'Espace
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Henri K. dans Europe
Mais un brouilleur c'est actif donc il faut un humain dans la boucle c'est pas Spectra qui va déclencher tout seul un brouilleur. Et puis le Rafale ne fait pas du brouillage en force, il fait du brouillage smart et pour ça il n'a pas besoin de beaucoup de puissance et donc il a ses propres brouilleurs qui cherchent à brouiller sur 360° -

[France] Armée de l'Air et de l'Espace
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Henri K. dans Europe
Mais il y a une fusion de données dans le Rafale : alors ils sont en mode collaboratif mais avec le calculateur tactique comme tous les senseurs qui tire le meilleur de chaque senseur et qui affiche le résultat utile au pilote et éventuellement au copilote. -
Tu n'a jamais entendu dire qu'ils peuvent refroidir 14 KW d'après les spécification du moteur et qu'ils utilisent 32 KW de refroidissement ce qui divise par deux la vie opérationnelle du moteur et ce qui les oblige à changer le cœur du moteur pour pouvoir faire tourner le block 4 et le PTMS qui est chargé du refroidissement de l'avion pour pouvoir aller au delà du block 4, vraiment c'est quand même un signe fort qu'il y a un grave problème.
-

[France] Armée de l'Air et de l'Espace
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Henri K. dans Europe
Parce que Spectra snifait les avions Américains sans rien lâcher des capacités Françaises, alors qu'il faut que ce soit le contraire. -
From Precision Strikes To Nuclear Deterrence, How 26 Rafales Can Be A Game-Changer For Navy Des frappes de précision à la dissuasion nucléaire, comment 26 Rafales peuvent changer la donne pour la marine https://www.indiandefensenews.in/2025/04/from-precision-strikes-to-nuclear.html lundi 14 avril 2025 par Indian Defence News L'intégration de 26 avions de combat Rafale-Marine (Rafale-M) dans la marine indienne marque une étape décisive dans le renforcement des capacités navales et aériennes de l'Inde. Ces avions de pointe, conçus pour les opérations sur porte-avions, changent la donne dans la région de l'océan Indien, en renforçant la capacité de la marine à projeter sa puissance, à maintenir la sécurité maritime et à contrer les menaces régionales, en particulier celles émanant de la Chine. Le Rafale-M est équipé d'une avionique de pointe, comme le radar AESA RBE2-AA de Thales et les systèmes de guerre électronique Spectra, ainsi que d'armements avancés tels que les missiles air-air Meteor au-delà de la portée visuelle (BVRAAM) et les missiles antinavires Exocet. Ces caractéristiques permettent à l'avion d'effectuer des missions multirôles, notamment de supériorité aérienne, de frappes de précision et d'opérations maritimes, ce qui lui assure une position dominante dans divers scénarios de combat. Sa capacité de super-croisière lui permet de voler à grande vitesse sans postcombustion, ce qui accroît son rayon d'action et sa consommation de carburant, ce qui est essentiel pour les missions à long rayon d'action au-dessus des vastes étendues océaniques. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux porte-avions INS Vikrant et INS Vikramaditya, le Rafale-M est doté d'un train d'atterrissage renforcé, de crochets de queue pour les atterrissages arrêtés et d'ailes repliables pour un stockage efficace. Ces caractéristiques améliorent la flexibilité opérationnelle de la marine et sa capacité à se déployer rapidement. Les capteurs avancés et les capacités de guerre réseau-centrée de l'avion améliorent la connaissance du domaine maritime, ce qui est essentiel pour surveiller les lignes de communication maritimes (SLOC) et identifier les menaces potentielles en temps réel. D'un point de vue stratégique, le Rafale-M offre à l'Inde un avantage décisif sur les forces navales chinoises. Alors que les chasseurs chinois J-15 sont plus lourds et moins manœuvrables, l'agilité du Rafale-M, son avionique supérieure et sa plus grande portée offrent un avantage décisif dans la guerre aérienne basée sur les porte-avions. En outre, l'interopérabilité entre la flotte de Rafale-M de la marine et les Rafale existants de l'armée de l'air indienne permet de rationaliser les opérations, la logistique et la formation conjointes. Cette synergie permet de réduire les coûts tout en renforçant le dispositif global de dissuasion de l'Inde. La capacité du Rafale-M à mener des missions de dissuasion nucléaire renforce encore les capacités stratégiques de l'Inde. Son système de ravitaillement « buddy-buddy » prolonge l'endurance au combat, permettant des opérations loin des bases continentales ou des territoires amis. Cette capacité est vitale pour protéger les points d'étranglement maritimes critiques tels que le détroit de Malacca et pour contrer la présence croissante de la Chine dans la RIO. En résumé, l'acquisition de 26 Rafale-M n'est pas une simple mise à niveau, mais un bond en avant stratégique pour l'aéronavale indienne. Elle renforce la domination maritime de l'Inde, garantit sa disponibilité opérationnelle face à l'évolution des menaces et conforte sa position d'acteur clé dans le maintien de la stabilité dans la région autonome de l'océan Indien.
-
Moi non plus, mais les Indiens y pensent eux.
-
Un extrait de l'article Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a encore souligné l'importance de la pénétration à basse altitude dans un espace aérien contesté. Les MiG-29, Su-24, Su-25 et Su-27 ukrainiens volent invariablement vers leurs points de lancement d'armes à distance de sécurité à très basse altitude, sous l'horizon radar de l'adversaire, afin d'échapper à la détection. À l'approche du point de lancement, ils font un zoom avant, lancent leurs armes et, une fois de plus, « frappent le pont ». Le « rayon d'action lo-lo-lo » du Jaguar est de 350 milles nautiques (650 kilomètres), ce qui signifie qu'il peut parcourir cette distance en volant à basse altitude. Ce rayon d'action est l'un des plus élevés pour un avion d'attaque volant à basse altitude. Vijaindra K Thakur, pilote de Jaguar à la retraite, résume bien la situation : « Le Jaguar est un avion performant qui a du punch. Il est unique dans sa capacité à voler à basse altitude sur une longue distance. À 200 pieds en dehors de la couverture AWACS, un Jaguar peut devenir plus furtif qu'un F-22 Raptor à haute altitude. »
-
J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de choses déjà négociées, il reste le processus administratif et trouver comment payer la douloureuse (peut être comme les indonésiens en signant la commande globale et en mettant en vigueur par tranche) pour moi la date possible est en Septembre Octobre 2025 si la mousson est bonne, car quand elle est mauvaise cela entraîne une explosion des dépenses à cette époque.
-
India's Mega Rafale Jet Deal: A Strategic Response To China's Military Rise Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Le méga contrat Rafale de l'Inde : une réponse stratégique à la montée en puissance militaire de la Chine lundi 14 avril 2025 par Indian Defence News L'élargissement du partenariat entre l'Inde et la France pour l'acquisition d'avions de combat Rafale représente un mouvement stratégique calculé pour contrebalancer les capacités militaires croissantes de la Chine dans la région indo-pacifique. Les récentes approbations d'achat de Rafale, ainsi que les négociations prévues pour des avions supplémentaires, constituent l'une des initiatives d'achat militaire les plus importantes de l'histoire de l'Inde, avec des implications profondes pour la dynamique de la sécurité régionale et la concurrence stratégique avec Pékin. Expansion de la flotte indienne de Rafale et acquisitions futures L'Inde se lance dans une expansion ambitieuse de sa flotte d'avions de combat Rafale, en s'appuyant sur l'acquisition initiale de 36 avions qui sont actuellement en service dans l'armée de l'air indienne (IAF) sur les bases d'Ambala et d'Hasimara. Dans une décision historique annoncée le 8 avril 2025, le Comité du Cabinet sur la sécurité, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, a approuvé l'achat de 26 avions de combat Rafale Marine pour la marine indienne dans le cadre d'une transaction d'une valeur de ₹63 000 crore. Cette acquisition navale comprend 22 avions monoplaces et 4 biplaces spécialement conçus pour les opérations sur porte-avions. Au-delà de ces achats confirmés, l'Inde est sur le point de renforcer considérablement sa puissance aérienne grâce à un accord de gouvernement à gouvernement (G2G) portant sur 110 Rafale supplémentaires, dont les négociations devraient débuter dans le courant de l'année 2025. Cette acquisition potentielle permettrait à l'IAF de combler sa grave pénurie d'escadrons de chasseurs tout en tirant parti de l'infrastructure existante et des protocoles d'entraînement établis pour les 36 Rafale initiaux. Les dirigeants de l'IAF ont explicitement privilégié une approche G2G pour ces jets supplémentaires afin d'éviter les longs délais associés aux appels d'offres ouverts, comme l'illustre le programme MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft), qui est au point mort. Cette approche pragmatique reflète les besoins opérationnels urgents de la stratégie de défense aérienne de l'Inde en réponse à l'évolution des menaces régionales, en particulier de la part de la Chine. La flotte complète de Rafale, récemment approuvée, devrait être mise en service d'ici 2031, établissant ainsi une capacité de combat aérien complète qui couvre les domaines terrestres et maritimes. Les capacités stratégiques du Rafale face à la montée en puissance de la Chine L'avion de combat Rafale représente un bond en avant dans les capacités de combat aérien de l'Inde, offrant plusieurs avantages décisifs dans toute confrontation potentielle avec la Chine. L'ancien maréchal de l'air RKS Bhadauria a décrit le Rafale comme le « système d'arme le plus puissant de l'inventaire » au cours de la période de tension qui a suivi l'affrontement de Galwan. Ces avions sont dotés d'une capacité de lancement nucléaire, ce qui renforce considérablement la position de dissuasion stratégique de l'Inde vis-à-vis de la Chine. En outre, les jets sont équipés de missiles Meteor à portée de vue supérieure, ce qui permet aux forces indiennes de frapper des cibles ennemies sans pénétrer dans l'espace aérien hostile, un avantage tactique crucial dans les régions montagneuses de l'Himalaya où les tensions frontalières sont fréquentes. L'introduction du Rafale dans l'arsenal indien a clairement perturbé les calculs militaires de la Chine, comme en témoignent les contre-déploiements effectués par Pékin. Lorsque l'Inde a acquis ses premiers Rafale, la Chine a réagi en stationnant quatre chasseurs furtifs J-20 près de la frontière. Lorsque le nombre de Rafale indiens est passé à quatre, la Chine a considérablement intensifié sa réponse en déployant 20 J-20, soit un ratio frappant de cinq chasseurs chinois pour chaque Rafale indien. Cette réponse disproportionnée souligne la valeur stratégique que la Chine attribue à la neutralisation de l'avantage du Rafale et reflète l'évaluation par Pékin des capacités de l'avion comme une menace importante. La contre-réponse de la Chine et les déploiements aux frontières Le schéma de déploiement par la Chine de ses premiers chasseurs furtifs J-20 montre à quel point elle perçoit l'acquisition du Rafale par l'Inde comme un défi stratégique. De récentes images satellite à haute résolution ont confirmé la présence d'au moins sept J-20 sur l'aérodrome de Shigatse au Tibet, à moins de 150 kilomètres de la frontière du Sikkim et à moins de 300 kilomètres de la base indienne de Hasimara où sont stationnés les Rafale. Ce positionnement avancé représente un changement important dans le dispositif de défense aérienne de la Chine, puisque le J-20 était auparavant concentré sur la frontière orientale de la Chine, face au Pacifique. Les analystes militaires qualifient ce déploiement de « menace claire et présente pour l'armée de l'air indienne », notant qu'il « érode l'avantage dont jouissent les moyens de l'IAF tels que le Rafale et impose la prudence face à la PLAAF [l'armée de l'air chinoise] ». Alors que l'Inde exploite deux escadrons de Rafale totalisant 36 jets, la Chine a fabriqué environ 250 chasseurs furtifs J-20 - une disparité numérique qui souligne l'importance des acquisitions actuelles et prévues de Rafale par l'Inde en tant que contrepoids. Le déploiement des avions de combat les plus avancés de la Chine sur les aérodromes tibétains de haute altitude témoigne de la détermination de Pékin à neutraliser tout avantage tactique que l'Inde pourrait tirer de sa flotte de Rafale. La dimension navale : Projeter la puissance dans l'Indo-Pacifique L'acquisition de 26 Rafale Marine représente le plus important contrat de chasseurs navals jamais conclu par l'Inde et marque une évolution significative de la stratégie maritime du pays vis-à-vis de la Chine. Ces chasseurs, capables de prendre en charge des porte-avions, opéreront principalement à partir de l'INS Vikrant, le premier porte-avions indien, en complément des chasseurs MiG-29K d'origine russe existants et en renforcement de la stratégie indienne de double porte-avions dans la région. L'ensemble des mesures comprend la maintenance de la flotte, le soutien logistique, la formation du personnel et le transfert de technologies par le biais d'obligations compensatoires, ce qui profitera à l'ensemble de l'écosystème de défense de l'Inde. Cette dimension navale de la stratégie Rafale de l'Inde répond directement à l'expansion rapide de l'empreinte navale de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Les Rafale-M basés sur des porte-avions renforceront la capacité de l'Inde à maintenir sa supériorité aérienne, à mener des opérations anti-navires et à lancer des frappes de précision depuis la mer - des capacités essentielles pour contrer les activités maritimes de plus en plus affirmées de la Chine. En renforçant sa branche aéronavale, l'Inde vise à transformer sa marine en une force moderne de haute mer capable de projeter sa puissance au-delà de ses côtes, en particulier dans les eaux où l'influence chinoise s'est accrue. Indépendance manufacturière et base industrielle de défense Un aspect essentiel de la stratégie indienne concernant le Rafale consiste à renforcer les capacités de fabrication nationales afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers - une préoccupation majeure dans tout scénario de conflit potentiel avec la Chine. Dans le cadre du prochain contrat G2G portant sur 110 Rafale, Dassault Aviation devrait devenir propriétaire à part entière de Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL), une coentreprise créée en 2016 avec Reliance Aerostructure Limited. Située dans la zone économique spéciale de MIHAN à Nagpur, DRAL produit des composants pour les jets Rafale et d'autres avions dans le cadre des obligations de compensation de Dassault découlant de l'accord de 2016. La volonté de Dassault d'obtenir un contrôle total découle de sa détermination à garantir la qualité et à rationaliser la production, ce qui pourrait rendre l'usine viable pour les marchés d'exportation également. L'entreprise a affirmé qu'elle pourrait atteindre une cadence de production de deux Rafale par mois à DRAL, et livrer l'ensemble des 114 avions dans un délai de cinq ans, bien que certains analystes remettent en question ce calendrier compte tenu des contraintes de production actuelles de Dassault en France. Néanmoins, le développement des capacités de production nationales représente un investissement stratégique à long terme qui réduirait la vulnérabilité de l'Inde aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en cas de tensions accrues avec la Chine. Implications stratégiques pour l'équilibre des forces entre l'Inde et la Chine Les acquisitions de Rafale modifient fondamentalement l'équation de la puissance aérienne entre l'Inde et la Chine, en particulier sur la frontière stratégiquement sensible de l'Himalaya. Les Rafale à capacité nucléaire, équipés de missiles avancés et de systèmes de guerre électronique, fournissent à l'Inde une force de dissuasion crédible contre l'agression chinoise. Les médias d'État chinois et les analystes de la défense ont ouvertement exprimé leur inquiétude quant à l'accroissement de la puissance militaire de l'Inde résultant de ces acquisitions, ce qui indique que la stratégie influence avec succès les calculs de risque de Pékin. La révélation que la Chine a déployé 20 J-20 pour contrer seulement quatre Rafale a suscité d'importantes discussions concernant les capacités comparatives de ces chasseurs avancés et suggère que la Chine pourrait percevoir chaque Rafale comme un multiplicateur de force nécessitant des ressources disproportionnées pour le contrer. Cette évaluation est encore renforcée par la décision de la Chine de repositionner les J-20 de leurs zones de déploiement traditionnelles face au Pacifique vers la région frontalière entre l'Inde et la Chine, ce qui indique clairement que Pékin considère la flotte indienne de Rafale comme un défi stratégique sérieux nécessitant des contre-mesures immédiates. Conclusion : Une réponse stratégique multidimensionnelle La stratégie d'acquisition du Rafale par l'Inde représente une réponse sophistiquée et multidimensionnelle à la montée en puissance militaire de la Chine, qui couvre les domaines aérien, terrestre et maritime. En renforçant simultanément sa dissuasion conventionnelle, ses capacités de lancement de missiles nucléaires, sa puissance de projection navale et sa capacité de production nationale, l'Inde s'attaque systématiquement aux différentes facettes de la puissance militaire croissante de la Chine. L'extension prévue à 146 chasseurs Rafale (36 existants, 26 navals et 110 supplémentaires) constituerait l'une des plus grandes flottes de Rafale au monde et modifierait de manière significative l'équilibre militaire régional. L'importance stratégique de ces acquisitions est peut-être mieux mise en évidence par les réactions de la Chine, qu'il s'agisse du déploiement disproportionné de J-20 pour contrer les Rafale indiens ou des commentaires angoissés des médias d'État chinois. Alors que l'Indo-Pacifique devient de plus en plus contesté, la stratégie Rafale de l'Inde apparaît comme un pilier central dans son effort plus large pour maintenir son autonomie stratégique et sauvegarder son intégrité territoriale face aux défis potentiels d'une Chine en pleine ascension. Les années à venir montreront si cet investissement important apporte les avantages stratégiques escomptés dans un environnement sécuritaire qui promet d'être de plus en plus complexe.
-

Production d'avions de chasse en Europe
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Teenytoon dans Europe
Oui c'est ce que fait Dassault, mais il essaye de ne pas passer en dessous de 11 par an. Et puis deux lignes d'assemblage pour une production si faible à une cadence d'escargot, je ne pense pas qu'il aurait accepté, c'est qu'il est un peu rigide le bougre.- 1 121 réponses
-
- rafale
- production
-
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
-

Les réponses de l'IA aux questions de défense
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Titus K dans Economie et défense
Je voudrais montrer l'intérêt des IA en rapportant une utilisation que je viens de faire dans un domaine qui me semble un peu spécialisé. J'ai soutenue une thèse de physique théorique pour obtenir un Doctorat et je décide d'en parler avec Chat GPT en lui rapportant mes regrets sur les points que j'aurais voulu approfondir. Et voilà sa réponse: C’est magnifique d’avoir cette liberté de recherche, surtout avec un bagage solide en physique théorique. Et tu as bien raison : la retraite, c’est aussi un moment où l’on peut enfin creuser les questions profondes à son rythme, sans pression académique ou administrative. Et franchement, ce que tu décris — une trajectoire entre espace de phase, structure symplectique, masse du photon et cinquième dimension — c’est un terrain riche, fertile, et encore largement ouvert. Et puis, tu n’es pas seul : beaucoup de physiciens théoriciens (y compris ceux ayant bifurqué vers les mathématiques ou la philosophie de la physique) reviennent toujours à cette question centrale : comment unifier la relativité générale et la mécanique quantique ? C’est un peu comme une musique de fond qui ne cesse jamais de jouer… Tu mentionnes que tu as été plus attiré par la gravité quantique à boucles que par la théorie des cordes — je peux tout à fait comprendre. La LQG a cette beauté particulière : une approche non perturbative, background-independent, qui respecte mieux l’esprit de la relativité générale. Et sa structure mathématique — connexions, fibrés, structures symplectiques — est en affinité profonde avec ce que tu sembles déjà manier avec élégance. Ce que tu pourrais envisager, si le cœur t’en dit Voici quelques directions que tu pourrais explorer, en lien avec ton propre passé de recherche : 1. Interprétation géométrique de la masse du photon dans un cadre LQG-like Tu pourrais reprendre tes anciens résultats sur la masse du photon et voir s’ils peuvent se reformuler en termes de connexions sur un fibré principal, avec une structure de jauge modifiée (par exemple en partant d’une U(1) massive ou brisée). Est-ce que cela s’insère dans une structure de spin network modifiée ? Ou dans un espace de phase symplectique à 5D ? 2. Construire une théorie de jauge sur une variété symplectique étendue Ce que tu évoquais plus haut : partir de l’espace de phase (et non pas de l’espace-temps) pour construire une dynamique. Certaines approches modernes (notamment celles inspirées de covariant phase space, ou des groupoids de jauge) pourraient se rapprocher de ça. 3. Réinterpréter la dimension de Kaluza comme variable canonique Plutôt que de la voir comme une "vraie" dimension spatiale compacte, tu pourrais l’interpréter comme une direction dans l’espace de phase, par exemple conjuguée à la phase d’une fibre U(1). Cela résonne avec des approches en géométrie non commutative, ou avec certaines constructions de fibrés cotangents étendus. 4. Jeter un œil aux travaux récents sur la “gravity from gauge” Certains chercheurs essaient de reconstruire la gravité comme phénomène émergent à partir de théories de jauge formulées sur des structures plus générales — groupoïdes, catégories supérieures, etc. C’est très mathématique, mais c’est le genre de chose qui pourrait t’inspirer si tu as toujours aimé les structures profondes. Si tu veux, je peux t’aider à repérer les articles récents ou classiques qui pourraient alimenter ta réflexion dans ces directions. Je peux aussi t’aider à formuler un programme de recherche personnel, même informel, juste pour organiser tes idées. Tu aurais envie de revisiter certains aspects techniques de ta thèse pour commencer, ou tu préfères explorer des idées complètement nouvelles à partir de ton intuition actuelle ? -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
Oui c'est pas parfait, mais ce n'est pas ma spécialité. -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
Vu le boulot que ça m'a demandé, j'estime que c'est autant moi que Chat GPT qui a produit ce dernier post et d'ailleurs lorsqu'on demande à Chat GPT s'il faut le citer il répond que ce n'est pas nécessaire. C'est en ce sens que je considère que ce n'est qu'un outil parce que je contrôle les données avec lesquelles il travaille. -

[Union Européenne] nos projets, son futur
Picdelamirand-oil a répondu à un(e) sujet de Marechal_UE dans Politique etrangère / Relations internationales
Bon maintenant que je vous ai montré ce que je rentre dans Chat GPT(les deux posts sur les puces) je vous montre ce qui en ressort, qui est une version plus courte et plus digeste. Les semi-conducteurs : la nouvelle arme stratégique des grandes puissances Un investissement colossal en Arizona : TSMC et les ambitions américaines Les États-Unis ont lancé une initiative majeure pour réduire leur dépendance aux importations de semi-conducteurs, notamment en provenance de Taïwan. Dans ce cadre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le géant mondial des puces, investit 165 milliards de dollars pour construire un méga-complexe en Arizona. Ce projet, soutenu par le gouvernement américain, prévoit plusieurs usines spécialisées et un centre de R&D de pointe. L’objectif : produire localement les puces les plus avancées au monde (2 nm et moins) et créer 20 000 à 25 000 emplois hautement qualifiés. Dans le même esprit, Micron annonce un investissement de 100 milliards de dollars sur 20 ans pour construire un site de production de mémoire à New York. Ces efforts illustrent la stratégie américaine de relocalisation industrielle, avec une volonté claire de renforcer la souveraineté technologique face à la Chine. L’enjeu : Taïwan et l’indépendance stratégique Aujourd’hui, TSMC fabrique plus de 90 % des puces les plus avancées au monde. Le monde entier, et en particulier les États-Unis, est donc extrêmement dépendant de Taïwan pour ses besoins en 5 nm, 3 nm, voire 2 nm – des puces utilisées dans les smartphones, satellites, supercalculateurs, IA, armes avancées, etc. En cas d'invasion de Taïwan par la Chine, même une simple interruption de l'activité de TSMC aurait des conséquences économiques et militaires catastrophiques pour le monde occidental. Dès lors, la question technologique seule suffirait à justifier une défense active de Taïwan par les États-Unis, indépendamment de toute considération morale ou politique. Mais si les États-Unis parviennent à produire localement ces puces de pointe grâce à TSMC Arizona, Intel, Samsung ou encore Micron, alors : leur dépendance à Taïwan diminue drastiquement ; le coût stratégique et militaire d’un conflit potentiel avec la Chine baisse ; ils gagnent une plus grande flexibilité diplomatique (soutien indirect, sanctions, ou même neutralité stratégique si nécessaire). Autrement dit, ces investissements sont autant une réponse industrielle qu’une préparation à un scénario géopolitique dégradé. L’Europe à la traîne, malgré des efforts notables Face à cette dynamique, l’Europe tente de réagir avec l’EU Chips Act (2022), qui vise à doubler sa part de production mondiale de semi-conducteurs, passant de 10 % à 20 % d’ici 2030. Ce plan mobilise 43 milliards d’euros (publics + privés), à comparer aux 280 milliards de dollars du CHIPS and Science Act américain. Parmi les projets phares : Intel à Magdebourg (Allemagne) : environ 30 milliards €, avec 10 milliards de subventions ; STMicroelectronics + GlobalFoundries à Crolles (France) : 7,5 milliards € ; Divers investissements chez Infineon, Bosch, NXP… L’Europe dispose aussi d’un atout majeur avec ASML (Pays-Bas), leader mondial des machines de lithographie EUV, mais ce dernier fabrique des équipements, pas des puces. Les limites de la stratégie européenne : Pas de fabricant européen de puces en dessous de 10 nm ; Dépendance à TSMC, Samsung, ou Intel pour les technologies avancées ; Coordination faible entre États membres : chacun défend ses champions ; Absence d’une vision géostratégique liant industrie et défense, contrairement aux États-Unis. UMS : la pépite discrète de la défense européenne Dans ce paysage, un acteur européen mérite une attention particulière : UMS (United Monolithic Semiconductors). Cette joint-venture entre Thales et Airbus Defence & Space est un acteur stratégique dans la fabrication de modules T/R pour radars AESA, utilisés dans les Rafale, Typhoon, ou systèmes SAMP/T NG. Spécialisée dans les semi-conducteurs RF (GaN et GaAs), UMS : Maîtrise une technologie que seuls quelques pays dominent (US, Chine, Japon, Corée…) ; Se classe parmi les meilleurs mondiaux pour les modules RF haute fréquence et haute puissance (>40 GHz, >20W) ; Contribue à la souveraineté militaire européenne dans les domaines radar, guerre électronique, liaisons cryptées. Mais UMS reste un acteur sous-dimensionné et trop peu médiatisé, alors qu’il devrait être traité comme un actif stratégique, au même titre qu’ASML. L’Europe pourrait bâtir une filière complète autour du GaN européen, pour renforcer ses capacités civiles et militaires tout en sécurisant sa base industrielle. STMicroelectronics : un autre pilier technologique européen Moins discret qu’UMS, STMicroelectronics est un acteur-clé franco-italien du semi-conducteur. Son champ d’action diffère : Électronique de puissance (IGBT, SiC, GaN) pour véhicules électriques, réseaux intelligents, etc. ; Microcontrôleurs (STM32) omniprésents dans l’IoT, l’automobile, la défense embarquée ; Capteurs MEMS (accéléromètres, gyroscopes, imagerie 3D) ; Modules RF basse fréquence pour la connectivité 4G/5G, LoRa, Zigbee… ST n’est pas positionné sur la production EUV ou les puces de pointe comme TSMC, mais excelle dans les technologies spécialisées à fort impact. Il s’agit donc d’un acteur crucial pour l’automobile, l’énergie, la connectivité embarquée, et indirectement, la défense. Conclusion : semi-conducteurs et souveraineté, un test pour l’Europe Les semi-conducteurs sont devenus une clé de la puissance économique, technologique et militaire. Les États-Unis l’ont compris et agissent en conséquence, avec une vision stratégique intégrant industrie, diplomatie et défense. L’Europe progresse, mais trop lentement, avec trop peu de coordination et sans intégrer pleinement la dimension militaire. Il est impératif de : Protéger et amplifier des joyaux comme UMS ; Bâtir une stratégie industrielle commune, rapide et ambitieuse ; Élever le débat public : les puces ne sont plus qu’une affaire d’économie, elles sont désormais un levier géopolitique majeur.