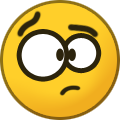-
Compteur de contenus
1 678 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
14
Tout ce qui a été posté par Manuel77
-
Politique étrangère de la France
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
Je lis peut-être trop dans ma bulle, mais l'impression est que Macron a prôné une équidistance de l'Europe entre les Etats-Unis et la Chine. Pas très habile diplomatiquement, alors que la moitié de l'Europe prie le soir pour la santé de Papa Joe, car elle ne contrôle pas son propre continent, comme d'habitude. -
Politique étrangère de la France
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce à cause de Pâques, ou pourquoi l'interview de Macron dans Politico n'est-elle pas abordée ici ? Est-ce un tabou national que je ne comprends pas en tant qu'étranger ? En tout cas, son interview a fait l'effet d'une bombe dans les milieux intéressés allemands, et ce de manière négative. Les transatlantiques crachent du poison et de la bile, même les francophiles se grattent la tête et lèvent les yeux au ciel. L'opinion majoritaire est qu'il est allé trop loin. https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-incite-europeens-etats-unis-chine/ -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Tu ne dois pas être triste du tout. We will all go together when we go. https://www.youtube.com/watch?v=TIoBrob3bjI Joyeuses Pâques ! -
Ce forum a de nombreuses qualités, mais la discussion sur le F-35 ici est aussi productive que les discussions sur la limitation de vitesse dans un forum BMW allemand ou sur les lois sur les armes dans un forum d'éleveurs de bétail texans. Comment discute-t-on en fait en Italie de l'avenir de la participation nucléaire ? EDIT (Je parle de l'utilisation militaire, pas de l'utilisation civile). Y a-t-il eu un changement avec la guerre en Ukraine ? En fait, ce n'est pas le bon fil pour cela, si quelqu'un peut me donner une indication, ce serait intéressant.
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Je dois malheureusement affirmer que les hauts fonctionnaires ont bien plus peur de Pistorius que de Scholz. Scholz joue plutôt ce rôle dans l'augmentation de la force de frappe de la Bundeswehr : De grands discours, peu d'actions. Pour le reste, je trouve cette mise en scène ridicule, mais je vois bien d'où cela vient. Ingo Gerhartz, le chef de la Luftwaffe et donc du "commandement spatial", est un homme qui a le goût de la publicité. Et la Bundeswehr a actuellement d'énormes problèmes de personnel, on voudrait attirer les adolescents. -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
Même si les Pays-Bas n'étaient qu'un proxy de la Chine (ce qu'ils ne sont pas, c'est un proxy du pétrole), pour l'ensemble de l'UE, il ne faut pas surestimer la Chine : Volume du commerce extérieur UE 2022 : env. 5500 milliards Dont avec la Chine en 2021 : env. 700 milliards. Cela représente environ 12%. N'hésite pas à rappeler aux Allemands l'importance de l'UE, parfois ils l'oublient. Et bien sûr, une crise dans le plus grand pays de l'UE serait une crise de l'UE, cela n'a absolument rien à voir avec l'ancien empire. C'est peut-être différent en France, mais en Allemagne, les partis qui représentent l'État ont lié leur destin à l'empêchement de la victoire des Russes. Si les Russes l'emportaient, il y aurait une grande crise de légitimité des forces politiques constructives. En ce qui concerne la migration, si je vois bien les données, la France a connu une légère tendance à la hausse depuis 2006, avec un maximum de 390000 en 2018. Elle a ensuite chuté. Le minimum de l'Allemagne depuis 2006 était de 660000, avec un maximum de 2000000 en 2015. En 2021, il y avait 1300000. Pour ne pas se tromper, l'Allemagne a besoin de l'immigration. Mais en comparaison avec les fluctuations extrêmes qu'elle connaît, la France navigue en eaux calmes. -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
Tu surestimes l'importance du commerce avec la Chine du point de vue allemand. Le volume des échanges commerciaux avec la Chine et l'Allemagne était de 300 milliards d'euros en 2022. Mais rien qu'avec les Pays-Bas, il était de 233 milliards d'euros. La croissance en Chine, c'est bien pour l'Allemagne, mais la base, c'est l'Europe. Sans cette base, l'Allemagne ne peut pas vivre, personne n'échappe à sa géographie. -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : Opérations militaires
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
13 millions d'Ukrainiens sont déplacés. 8 millions à l'étranger, 5 millions à l'intérieur de l'Ukraine. 20 pour cent de l'Ukraine sont occupés par la Russie. A combien de réfugiés faut-il s'attendre si nous supposons que la Russie conquiert 50 pour cent de l'Ukraine en trois ans au prix de combats considérables et que le pays s'abandonne/ s'effondre ensuite ? L'Allemagne est dans le pétrin, elle ne peut guère accueillir plus de réfugiés, mais elle ne peut pas non plus les refouler. Si la Russie gagne cette guerre, nous aurons une crise insoluble en Allemagne, tu peux calculer l'importance pour l'Europe. -
Il n'y a pas de fil spécial pour MGCS, n'est-ce pas ? Tiré d'un important journal économique allemand. Le journal avait eu un entretien avec la patronne de Renk, un fabricant de boîtes de vitesses pour chars. https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/ruestung-killt-der-leo-europas-superpanzer/29082072.html Le Leo va-t-il tuer le super char de l'Europe ? Le système européen de combat au sol MGCS prévu est déjà en difficulté. C'est justement le char allemand Léopard 2, vieux de 40 ans, qui pourrait désormais lui donner le coup de grâce, craint la patronne du constructeur de boîtes de vitesses Renk. Des systèmes de protection quasiment inviolables, une vue d'ensemble parfaite de tous les dangers qui s'approchent et un canon particulièrement puissant pour la défense - le nouveau système européen de combat au sol MGCS doit résister à presque tous les agresseurs. Telle était la promesse des constructeurs de chars européens lorsque la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, et le président français, Emmanuel Macron, ont annoncé en 2017 le lancement du Main Ground Combat System, un ensemble de chars, d'obusiers, de véhicules d'accompagnement sans pilote et d'un nuage de combat numérique en réseau. C'est désormais un rival vieux de 40 ans, le Leopard 2, qui pourrait bien détrôner le super char européen, comme le craint Susanne Wiegand, la patronne du groupe Renk d'Augsbourg. Du point de vue de la manager, depuis l'attaque de la Russie sur l'Ukraine il y a un peu plus d'un an, tant de pays européens ont commandé pour leurs forces armées les véhicules de combat appelés Leos du constructeur munichois KMW qu'il pourrait ne plus y avoir de place pour le MGCS pour le moment. "Au total, nous prévoyons un besoin d'au moins 300 chars Leopard. Et ils seront à nouveau en service pendant 40 ans", explique Wiegand. "Il faudra évaluer politiquement ce que cette nouvelle évolution signifie pour la poursuite de la mise en œuvre du MGCS". En clair : Wiegand s'attend apparemment au moins à un report prolongé du programme. En effet, les pays MGCS que sont l'Allemagne et la France ainsi que les pays intéressés - selon les informations, l'Italie, le Portugal ou la Finlande - doivent se demander s'ils ont encore besoin du nouveau système - et si oui, quand. Le char Leopard, explique encore Wiegand, restera probablement encore un bon moment le produit de choix. Un report ou même une fin du MGCS ne serait pas tout à fait surprenant. En tant que projet franco-allemand, MGCS devait certes inaugurer une nouvelle ère de coopération paneuropéenne en matière d'armement avec le nouveau système de combat aérien FCAS. De plus, grâce à un chiffre d'affaires pouvant atteindre 100 milliards d'euros lors de la construction, il promettait 100 000 emplois hautement qualifiés pour des décennies et devait, après son lancement à partir de 2040, assurer aux forces terrestres européennes une avance de trois à quatre décennies sur les fournisseurs des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine ou de la Corée. Mais l'euphorie est vite retombée. "Le moins que l'on puisse dire, c'est que les négociations initiales n'incitent pas à l'optimisme", a commenté le président permanent du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE), le général Robert Brieger. Alors que dans le cas du FCAS, la politique et les entreprises sont en bonne voie de parvenir à un compromis après environ cinq ans de querelles, le MGCS n'a guère progressé depuis 2021, rapportent les initiés. Etant donné qu'outre la société franco-allemande KNDS, mère de KMW et Nexter, Rheinmetall devrait également faire partie de MGCS, les planificateurs seraient confrontés au problème de la répartition du travail de manière à ce que l'Allemagne n'obtienne pas plus d'affaires que la France. "Trois moitiés d'un poulet, il n'y a que les restaurateurs douteux de l'Oktoberfest de Munich qui y sont parvenus", se moque un observateur. De plus, les groupes KMW et Rheinmetall, y compris leurs chefs, sont traditionnellement liés par une certaine aversion. Mais contrairement à ce qui s'est passé avec FCAS, les pays concernés ont hésité à faire entendre leur voix. Ces problèmes n'existent pas avec le Leopard, laisse entendre la directrice de Renk Wiegand, "parce qu'il est disponible et peut être développé techniquement". Et il y a encore un tiers qui ne dit pas son nom. Même si de nombreuses nouvelles techniques doivent encore être développées, si le Léo du futur doit conserver son rang de meilleur char du monde : "Même avec des améliorations au niveau des systèmes de protection, de l'arme principale ou de la mise en réseau numérique, il coûte dans un premier temps nettement moins cher à l'unité qu'un système nouvellement développé", fait savoir un initié. En effet, KMW et Rheinmetall, son principal fournisseur, ont déjà testé de nombreuses mises à niveau possibles. Outre une meilleure protection périphérique ou une tourelle automatique, il s'agit surtout d'un canon avec une plus grande force de pénétration. KMW tire cette puissance d'une nouvelle technique de tir pour des projectiles plus massifs, tandis que Rheinmetall mise sur une plus grande circonférence pour son Panther présenté l'été dernier, avec un tube lisse de calibre 130 millimètres - dix de plus que le Leopard 2 A7+ le plus moderne à ce jour. Et la sœur française du groupe KMW, Nexter, propose même un centimètre de plus pour la variante de démonstration d'un nouveau Leclerc, appelée "Terminateur", avec 140 millimètres. La querelle de leadership disparaît également. Comme la direction du Leopard revient clairement à KMW, les autres pays acheteurs se considèrent plutôt comme des partenaires juniors, explique Rolf Hilmes, auteur d'ouvrages spécialisés et ancien enseignant à l'Académie fédérale pour l'administration de la défense. "Les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont accepté que l'Allemagne prenne le rôle de leader dans le projet - et se contente de contribuer au projet en fournissant par exemple des composants individuels". Mais malgré tous les avantages pour le Léopard, les experts du secteur ne croient pas à la fin totale du MGCS. Car un nouveau char de combat n'est que la nouveauté la plus visible du programme, mais pas la plus importante. "Ce qui est décisif, ce sont plutôt des choses comme les véhicules d'accompagnement autonomes et surtout les applications informatiques autour de l'utilisation du cloud computing et de l'intelligence artificielle", estime un cadre dirigeant. "Et celles-ci doivent être développées dans tous les cas, que ce soit pour le Leo ou pour un successeur".
-
(Re)structuration du tissu industriel européen de défense
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Economie et défense
France, Naval Group : public Espagne, Navantia : public Je ne sais pas si le gouvernement allemand apprécierait que TKMS soit vendu à un autre "État". L'industrie de la défense allemande fonctionne un peu comme l'industrie américaine : il n'y a pas de participation de l'Etat, le gouvernement souhaite une concurrence privée dans laquelle il peut ensuite choisir. Dans le cas allemand, c'est bien sûr fictif, car les chiffres d'affaires et les investissements sont bien trop faibles. Les politiques ont fini par s'en rendre compte, ils ont alors parlé de "champions" nationaux ou européens. Mais le fédéralisme allemand entre alors à nouveau en jeu, ainsi que les syndicats. Le débat est sans fin.- 296 réponses
-
- 3
-

-

-
- acquisition
- fusion
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-
Là, vous les Français, vous êtes un peu durs avec le think tank. C'est plutôt comme un champion de Formule 1 qui passe dans une assez bonne écurie, qui a de grandes ambitions. Tout comme Schumacher a dû passer chez Ferrari pour que les Italiens puissent eux aussi devenir une fois de plus champions du monde. Son fesses délicates ont fait la moitié du travail.
- 2 572 réponses
-
- 1
-

-
Oui, l'activité sous-marine de TKMS se porte bien. Mais dans l'image globale du conglomérat, il s'agit de savoir ce que cette entreprise ThyssenKrupp est censée être. Comme le dit l'article de journal que j'ai posté dans le fil "Industrie de l'armement". Le syndicat veut faire en sorte que TK reste ce qu'elle était au départ : un producteur d'acier. Mais cela ne permet pas de faire des bénéfices en Allemagne. L'espoir est maintenant que l'on passe de la cuisson de l'acier à la chimie de l'hydrogène. Que la cuisson de l'acier se fait à l'aide de l'hydrogène. Pour cela, il faut beaucoup d'argent et le syndicat souhaite que l'argenterie soit vendue pour faire un pari sur l'avenir de la production d'acier. Mais on a déjà joué l'atout avec la branche ascenseurs, qui a rapporté 17 milliards. TKMS est estimé à 2 milliards par TK, mais le marché financier ne l'évalue qu'à un milliard. Ce sont des petits poissons. La désorientation de TK est depuis des années le running gag des journalistes économiques allemands.
-
(Re)structuration du tissu industriel européen de défense
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Economie et défense
Fincantieri n'appartient-il pas à 70 pour cent à l'État italien ? L'Allemagne n'a pas de parts dans le conglomérat ThyssenKrupp. Le plus gros actionnaire individuel est une fondation qui sert des objectifs caritatifs. Je ne sais pas quelle vente est politiquement opportune : A l'Etat italien via Fincantieri ? A une société d'investissement ? A Rheinmetall ? Au groupe NVL ? Ils sont probablement trop petits.- 296 réponses
-
- acquisition
- fusion
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-
J'avais déjà posté un article plus long dans le fil "Industrie européenne de l'armement". Les acheteurs potentiels pourraient être Rheinmetall ou des investisseurs financiers. Politiquement difficile. Depuis des décennies, les analystes financiers disent que Thyssen dans son ensemble vaut moins que ses pièces détachées. Ils ont déjà vendu la division ascenseurs, c'était le morceau de choix. Le secteur des ascenseurs est une mine d'or. Les sous-marins par contre...
-
Une analyse des conséquences de l'achat des F35 par l'un des grands think tanks allemands. Je ne poste que la conclusion, car elle serait trop longue. La plupart des arguments devraient être connus. https://www.swp-berlin.org/publikation/die-entscheidung-zum-kauf-von-f-35-kampfjets-fuer-die-luftwaffe ----- Les défis de l'avenir F-35 L'achat de ces avions renforcera les relations bilatérales de l'Allemagne avec les États-Unis. En utilisant le même système, les deux forces aériennes collaboreront plus étroitement. En Europe, la décision de sélection du F-35 est accueillie avec certaines attentes. Paris souhaite obtenir des garanties claires que l'acquisition du F-35 ne mettra pas en péril le projet commun "Future Combat Air System" (FCAS) et les plates-formes volantes NGWS qui le composent. Si le développement commun d'un avion de combat de 6e génération devait être inférieur aux attentes, l'armée de l'air allemande disposerait d'une option de repli avec le F-35. Paris et Madrid, avec qui le développement est commun, auraient alors un sérieux problème. Ils devraient compenser l'échec en très peu de temps et contre des résistances de politique industrielle dans leur propre pays. Il s'agit ici de s'en tenir à la position claire de l'Allemagne selon laquelle l'acquisition du F-35 n'a pas d'impact sur le développement européen des avions de combat. Ces répercussions ne pourront toutefois être évitées que si des ressources financières et humaines suffisantes sont disponibles à long terme pour les tâches de planification. L'achat de l'avion américain et le développement européen du FCAS ne peuvent toutefois pas être totalement dissociés. La question de l'intégration du F-35 dans le système FCAS doit donc être résolue. Pour permettre cette intégration, de nombreuses données sensibles de l'avion de combat américain sont nécessaires, mais la partie américaine ne les partage pas actuellement. Seule une documentation complète et détaillée de ces données peut garantir qu'une intégration complète pourra être réalisée. Si cela n'est pas possible, les partenaires allemands pourraient renverser l'équation et exiger l'intégration du FCAS et de son NGWS dans le développement du Combat-Cloud du F-35. Cela pourrait probablement être initié du côté américain par le biais d'une standardisation de l'OTAN, car l'industrie américaine travaille intensivement avec les forces armées américaines au développement des systèmes d'armes du futur. Parallèlement, ces dernières étudient comment les systèmes et informations pertinents pour le champ de bataille pourraient être réunis dans un réseau similaire au FCAS. Eurofighter Dans le cadre de son développement, l'Eurofighter, qui vole depuis des années au sein de l'armée de l'air, doit être enrichi de deux capacités essentielles. Premièrement, il doit être équipé de meilleurs capteurs pour la détection des positions ennemies et d'un missile adapté pour la suppression de la défense aérienne au sol. Deuxièmement, il doit être capable de brouiller les forces ennemies dans le spectre électromagnétique ("Jamming"). Pour cela, il doit disposer de systèmes de brouillage permettant d'interférer avec les radars et les systèmes de communication des forces ennemies dans différentes gammes de fréquences. De cette manière, des technologies clés et des développements importants dans le domaine de la guerre électronique pourraient être établis en Europe. Ces technologies pourraient être utilisées dans le cadre de développements ultérieurs tels que le NGWS. Parallèlement, ces mesures de développement comportent des risques. L'intégration de systèmes appropriés dans un avion existant est techniquement très complexe et prend beaucoup de temps en raison de la certification nécessaire. Il faut tenir compte non seulement de l'installation et de la fixation sur l'aéronef, mais aussi de l'architecture logicielle complète du système. L'Eurofighter est exploité avec des partenaires internationaux. Il ne serait donc pas judicieux que l'Allemagne fasse cavalier seul dans le développement décrit ci-dessus. Il reste à déterminer les incitations qui permettraient d'intégrer les autres utilisateurs. L'industrie, en collaboration avec l'armée de l'air, doit maintenant élaborer des solutions à la pointe de la technique, réalisables et utiles sur le plan militaire. Il n'existe pas d'expérience globale sur laquelle s'appuyer. Si les développements n'aboutissent pas, la question se posera de savoir pourquoi on n'a pas eu recours à un système établi aux États-Unis. Un tel système aurait été disponible sur le marché avec l'EA-18G Growler, basé sur l'avion de combat polyvalent F-18 qui a fait ses preuves. Conclusion Avec la combinaison des avions de combat F-35 et des Eurofighters, l'armée de l'air allemande est bien positionnée pour l'avenir. L'acquisition des avions de combat polyvalents américains est plus qu'un simple signe visible adressé aux alliés, car la décision d'acheter des F-35, y compris un important pack d'armes, assure le développement des capacités actuelles. Le projet de développement de 15 Eurofighter pour le combat électronique est une tâche exigeante pour l'industrie et l'armée de l'air dans le contexte de l'interconnexion des systèmes visée. Il offre des opportunités, mais comporte également des risques. Dans le cadre du développement commun du FCAS, l'armée de l'air allemande sera la seule des trois partenaires à pouvoir apporter à l'avenir des expériences tirées de l'utilisation d'un avion de combat de dernière génération. Parallèlement, il s'agit d'éviter que l'achat des avions F-35 n'augmente les risques d'échec du FCAS. Une concertation précoce avec les États-Unis et les alliés européens sur les possibilités d'intégration des différents systèmes est une tâche exigeante, mais qui doit être entreprise. La décision d'acheter le F-35 a des conséquences à moyen terme sur le financement de la Bundeswehr. Dans les conditions actuelles, le budget de la défense doit connaître des augmentations significatives afin d'assurer l'exploitation des systèmes coûteux tout comme l'entraînement du personnel. Sinon, il y a un risque de conflit entre l'exploitation du F-35 et le développement du FCAS, qui, selon les calculs actuels, devrait coûter au total 100 milliards d'euros. A l'avenir, l'Allemagne devra définir plus clairement ses propres intérêts afin de mieux préparer des décisions de grande envergure. Le changement d'époque désigné par le chancelier allemand Olaf Scholz offre la possibilité de penser et d'agir avec plus d'assurance qu'auparavant en matière de politique de sécurité.
- 2 572 réponses
-
- 2
-

-
L'un de mes plus grands plaisirs sur ce forum est de lire les contributions d'Hirondelle. Il y a une densité poétique et linguistique, comme si on lisait Hamlet en anglais. J'étudie chaque ligne avec application. Puis-je vous demander ce que signifient ces termes ? balayer ses atterrages Mektub PM l’Her tout rouille embarquer la bourgeoise PHA
-
Le problème, c'est que depuis la mission Atalanta, la marine allemande voulait en fait aller dans une autre direction. Ils ont commandé quatre "frégates" F126 inhabituellement grandes, qui devraient arriver à partir de 2028. Avec 9000t, elles ne sont plutôt pas faites pour la mer Baltique, mais pour des Opex en eaux profondes avec des missions de longue durée.
-
Un documentaire sur deux missions de différents types d'avions. Un P3 Orion de Nordholz effectue une mission de reconnaissance au-dessus de la mer du Nord et de la mer Baltique. Ils s'entraînent au vol à basse altitude. À partir de 11:30, on voit une mission spéciale : ils doivent trouver avec quels capteurs et à quelles altitudes on peut détecter les mines marines qui flottent à la surface. C'est intéressant, car de tels objets apparaissent de plus en plus souvent dans la mer noire. A partir de 19:30, on voit que même la photographie normale avec un "appareil photo amateur" joue encore un rôle dans la reconnaissance maritime. Un ravitailleur (à partir de 14:40) A400M de Wunstorf survole la Lituanie. Un Rafale se ravitaille en carburant. Ils font l'éloge du pilote français, qui est très expérimenté. L'Eurofighter allemand, qu'ils doivent également ravitailler, ne s'est malheureusement pas présenté. https://www.youtube.com/watch?v=0aPYy_nzctQ
- 2 572 réponses
-
- 3
-

-

-
(Re)structuration du tissu industriel européen de défense
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Economie et défense
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/thyssenkrupp-marine-u-boote-verkauf-stahl-aufsichtsrat-merz-1.5779953 Le groupe industriel Thyssenkrupp fabrique également des sous-marins et des navires de guerre - une activité dont il veut désormais se débarrasser. Le projet est politiquement délicat. L'entreprise est, selon ses propres dires, le leader mondial des sous-marins à propulsion non nucléaire, elle emploie 6900 personnes dans le nord de l'Allemagne - et elle pourrait bientôt avoir de nouveaux propriétaires : Le groupe industriel Thyssenkrupp, basé à Essen, veut séparer la division d'armement Thyssenkrupp Marine Systems du groupe afin de trouver des acheteurs, des partenaires ou des investisseurs. Lors d'une réunion spéciale vendredi, le conseil de surveillance a soutenu ce projet de la présidente du directoire Martina Merz. C'est ce qui ressort d'un procès-verbal envoyé par les représentants des salariés au conseil de surveillance aux comités d'entreprise et dont le Süddeutsche Zeitung a eu connaissance. La division fabriquant également des navires de guerre, la vente pourrait être politiquement délicate. Mais le conseil de surveillance du groupe M-Dax n'y voit apparemment pas de grands obstacles : "Nous percevons que le gouvernement fédéral soutient la création d'une entreprise nationale forte de construction navale", peut-on lire dans le procès-verbal. La présidente du directoire Merz avait déjà déclaré lors de l'assemblée générale de février qu'elle était "en dialogue avec le gouvernement fédéral pour se concerter sur la marche à suivre". Le groupe d'armement Rheinmetall, basé à Düsseldorf, est considéré comme un partenaire possible. Mais Merz a récemment rejeté de telles spéculations dans une interview accordée au Spiegel : "Si l'on regarde ce que les entreprises produisent respectivement, ce n'est pas évident". Des investisseurs financiers pourraient également faire partie des intéressés. Merz cherche des acheteurs ou des investisseurs pour plusieurs secteurs. Le groupe, qui emploie 96 000 personnes, est un magasin général : C'est le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, mais il est également actif dans la sous-traitance automobile, la construction mécanique, le négoce de matières premières et l'exploitation de chantiers navals militaires. Peu après l'entrée en fonction de Merz à l'automne 2019, elle a déjà vendu l'activité ascenseurs pour 17 milliards d'euros afin de réduire la charge de la dette de l'entreprise. Merz veut encore céder d'autres domaines ou du moins chercher des partenaires, car le groupe seul n'a pas assez d'argent pour pouvoir investir partout suffisamment dans la croissance. Ainsi, le manager souhaite introduire en bourse une part minoritaire de la filiale Nucera. Cette entreprise construit des électrolyseurs, c'est-à-dire des installations qui produisent de l'hydrogène à l'aide d'électricité - un marché d'avenir, car l'hydrogène respectueux du climat devrait remplacer à l'avenir le gaz naturel dans l'industrie et les centrales électriques. Mais en raison de la crise de Covid et de la guerre, le contexte boursier n'a pas été favorable jusqu'à présent. Les choses avancent tout aussi difficilement dans le secteur de l'acier, pour lequel Merz cherche également des acheteurs ou des partenaires. Elle n'est pas la première : au tournant du millénaire déjà, le président du directoire de l'époque, Gerhard Cromme, voulait introduire cette activité en bourse, mais cela n'a pas abouti. Plus tard, des fusions avec les rivaux Tata et Liberty Steel ont échoué. Pour la dernière tentative, des investisseurs financiers ou des concurrents étrangers comme le brésilien CSN sont considérés comme intéressés. Merz évoque également la possibilité que de grands producteurs d'hydrogène, par exemple arabes, puissent y participer. Enfin, les aciéries de Thyssenkrupp à Duisbourg auront besoin dans quelques années d'énormes quantités d'hydrogène pour pouvoir produire de l'acier dans le respect du climat et sans coke ni charbon. Le groupe reçoit d'énormes subventions Ce n'est qu'en mars que le groupe a passé commande d'une installation dite de réduction directe, qui remplacera l'un des quatre hauts-fourneaux et produira du fer à l'aide d'hydrogène. Les coûts s'élèvent à plus de deux milliards d'euros. Le gouvernement du Land soutient cette opération à hauteur de 700 millions d'euros, ce qui représente la subvention la plus élevée jamais versée par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le gouvernement fédéral verse à l'entreprise plus du double de cette somme. Cela doit non seulement couvrir une partie des coûts de construction, mais aussi subventionner l'exploitation pendant les premières années. La Commission européenne n'a pas encore approuvé ces gros chèques, mais cela devrait être fait d'ici l'été. Cependant, une partie de la direction et des représentants des travailleurs semblent s'opposer à la séparation de l'acier. Ils préféreraient au contraire que les aciéries - à l'origine du groupe traditionnel - constituent à l'avenir le centre de Thyssenkrupp et que d'autres branches soient vendues à la place. Dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance, les syndicalistes d'IG Metall écrivent qu'ils sont "toujours prêts à examiner une éventuelle autonomisation". Il est toutefois important que la branche dispose d'une "dotation financière suffisante". En outre, compte tenu des subventions élevées, "les décisions concernant l'avenir doivent être prises en accord avec la politique dans le Land et à Berlin". Les syndicalistes critiquent aussi sévèrement la présidente du directoire, Mme Merz, parce que la restructuration du groupe n'avance pas. "Rien n'a bougé depuis l'automne dernier et on a encore perdu du temps inutilement. C'est inacceptable !" Merz doit "enfin" présenter un nouveau concept global. Pas de doute : le top manager aurait bien besoin d'une annonce de succès dans le secteur de l'armement en ce moment.- 296 réponses
-
- 5
-

-

-
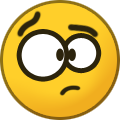
-
- acquisition
- fusion
-
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
-
Les choses bougent dans la réflexion sur l'avenir de la marine allemande. Voici un amiral de flottille qui explique la situation en mer Baltique. Il semble peu préoccupé par un débarquement russe à Rostock, mais il souligne la nécessité de développer une capacité de "seabed warfare". Il veut absolument des drones sous-marins. https://www.youtube.com/watch?v=tNFFrnC2PJU&t=199s Il souhaite également que le nombre de nageurs de combat soit doublé. https://marineforum.online/eckernfoerde-befehlshaber-flotte-stellt-neue-ksm-einheiten-auf/ Le chef de la marine, l'amiral Kaack, est prêt à renoncer à des frégates, des corvettes et des sous-marins pour acquérir davantage de drones. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/marine-2035-mehr-unbemannte-einheiten-weniger-schiffe-18782364.html Cela ressemble beaucoup pour moi à une focalisation sur l'infrastructure sous-marine qui relie l'Allemagne et la Scandinavie.
-
Allemagne
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Retour du soft power anglais : le roi Charles a été très convaincant lors de sa visite en Allemagne. Beaucoup d'Allemands sont très intéressés par la famille royale, on a remarqué qu'il pouvait se déplacer de manière détendue entre amis. En fait, il devait se rendre en France, mais on l'avait menacé de le faire tomber. Les Allemands sont flattés que la rumeur dise que le roi Charles aurait de toute façon préféré visiter l'Allemagne en premier. Quoi qu'il en soit, il a été le premier roi à s'exprimer devant le Bundestag. Il a prononcé environ la moitié de ses discours en allemand, pas aussi bien que son père, mais de manière convaincante. Nos médias trouvent qu'il a trouvé la bonne dose de politique, également une bonne combinaison d'humour et de sujets sérieux. Les thèmes : l'histoire commune (le bien et le mal), l'Ukraine, le déploiement commun de l'Eurofighter dans les pays baltes, la culture (Haendel, Shakespeare, Turner), les énergies renouvelables, le changement climatique. Il n'a pas prononcé le mot Brexit, mais il est perçu comme devant symboliser un rapprochement avec l'Allemagne et l'Europe, sur ordre du Premier ministre. Il y est en tout cas parvenu. https://www.watson.de/unterhaltung/royals/448448358-koenig-charles-eindeutiges-fazit-zu-seinem-deutschland-besuch https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw13-koenig-charles-rede-940994 -
Italie
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
Cette annonce étonnante a également été commentée très négativement en Allemagne, mais elle n'a pas été très souvent rapportée. Je n'en avais jamais entendu parler. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/keine-auslieferung-italienischer-linksterroristen-aus-frankreich-18786190.html https://www.sueddeutsche.de/meinung/frankreich-kassationsgericht-mitterrand-doktrin-aldo-moro-luigi-calabresi-kommentar-1.5777802?reduced=true Qu'est-ce qui a poussé Mitterrand à l'époque à mener une politique aussi amicale à l'égard des terroristes de gauche italiens ? Pourquoi n'a-t-il pas également hébergé des terroristes de gauche allemands ? -
Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Je ne comprends pas exactement quelle est la problématique entre Rheinmetall et "les Français". Que dit l'article mis en lien par Boule ? L'entreprise française Eurenco produit de la poudre explosive. Pour cela, ils ont besoin d'acide nitrique. Celui-ci est actuellement difficile à obtenir. Cela n'a rien à voir avec les nationalités. Eurenco fournit la poudre à Rheinmetall et à d'autres entreprises. Celles-ci fabriquent des grenades. Or, l'article dit ceci : Parfois, l'approvisionnement souffre d'élans de souveraineté ou d'alliés à géométrie variable. Par exemple, l'Allemagne, fournisseur de poudres de gros calibre pour la France, a priorisé ses besoins du jour au lendemain lorsque le conflit russo-ukrainien a éclaté. Si la Belgique ne pose pas de problème politique, la Suède peut de son côté privilégier ses propres besoins souverains. Toute sa production dans le secteur de la défense reste soumise à des contrôles à l'exportation. En d'autres termes, "l'autorisation du gouvernement suédois est nécessaire, même pour livrer un produit de notre usine suédoise à une usine française". Un mécanisme qui peut soudainement s'enrayer pour des raisons géopolitiques. Comment faut-il comprendre cela ? Est-ce que Rheinmetall livre de la poudre de gros calibre à Eurenco ? Ou la livre-t-elle directement aux fabricants français d'obus ? Rheinmetall veut construire une usine de poudre explosive en Hongrie. Je suppose qu'ils fabriquent déjà eux-mêmes des explosifs et qu'Eurenco est donc à la fois un fournisseur et un concurrent. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestung-rheinmetall-soll-sprengstoffwerk-in-ungarn-bauen/28903982.html Sinon, Rheinmetall est tout simplement intéressé par l'argent. Je ne vois pas quel lien particulier ils peuvent avoir avec les États-Unis. C'est une SA allemande dont les actions sont essentiellement détenues par les grands organismes collecteurs de capitaux. Bien sûr, elles sont souvent américaines (Fidelity, Vanguard), mais c'est aussi français par exemple (Amundi, Lyxor). L'actionnariat est largement diversifié et n'est pas dominé par des protagonistes isolés. Le manager en chef Armin Pappberger est d'ailleurs un malin, puisqu'il a investi à temps à titre privé dans ces actions et passe maintenant à la caisse. Il a acheté pour 14 millions d'euros d'actions à partir de 2017, qui valent maintenant plusieurs fois plus, environ 40 millions. Pour lui, il ne s'agit pas de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis, mais de la maximisation des profits. -
énergie Avenir du nucléaire civil en France et dans le monde ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de LBP dans Economie et défense
Actuellement, Greenpeace ne joue plus aucun rôle dans le débat allemand. Chez nous, le grand sujet environnemental est un groupe appelé "Dernière génération", qui se colle sur l'autoroute pour protester contre le changement climatique. On craint qu'ils ne fondent un parti et ne prennent des voix aux Verts "établis et repus", ou qu'ils ne deviennent des terroristes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Soulèvement_de_la_dernière_génération Au sein du parti vert, c'est aussi une question de génération et d'âge. Ceux qui sont actuellement au gouvernement ont grandi dans le mouvement anti-nucléaire. Les très jeunes pensent davantage au climat qu'au nucléaire. Bien sûr, il y a aussi une composante idéologique. Les Verts établis pensent que l'Allemagne de l'après-guerre a deux cadeaux à offrir à l'humanité : Les leçons du nazisme. Ce fut d'abord : plus jamais de guerre/pacifisme, puis une réinterprétation en une politique étrangère "guidée par des valeurs", une politique étrangère féministe. Et l'imposition d'une industrie photovoltaïque et éolienne mondiale avec des subventions énormes. L'image que les Verts ont d'eux-mêmes dit qu'ils sont devenus efficaces dans le monde entier en initiant ces industries. On entend rarement des ingénieurs pro-nucléaires dans les médias. La plupart du temps, on entend des calculs du genre : Il faut développer au maximum les énergies renouvelables. Bien sûr, on continuera à avoir le problème des fluctuations. Pour cela, on aura un parc assez important de turbines à gaz, ce qui est économiquement viable, car elles demandent peu d'investissements et d'entretien et peuvent être mises en route rapidement. Elles produisent malheureusement du CO2, mais c'est une Brückentechnologie/ "technologie de transition" nécessaire (c'est un slogan politique allemand, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent français). https://de.wikipedia.org/wiki/Brückentechnologie Je pense que les Verts allemands sont sincèrement convaincus que le nucléaire n'est pas économiquement compétitif. Si la France impose le nucléaire par l'Etat, la dette se retrouvera d'une manière ou d'une autre dans le système de l'euro et l'Allemagne devra en assumer une partie de la responsabilité. -
énergie Avenir du nucléaire civil en France et dans le monde ?
Manuel77 a répondu à un(e) sujet de LBP dans Economie et défense
Comment dit-on sur le forum ? Tout ensemble, mon général ! Je pense que les principales raisons sont le risque de catastrophe, les déchets et le prix. Risque de catastrophe : une petite chronique 1985 : Le surgénérateur de Kalkar est achevé. La CDU/FDP est au gouvernement fédéral, le SPD gouverne le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce Land refuse l'autorisation d'exploitation, le gouvernement fédéral pourrait faire activer le réacteur par instruction, mais il hésite car il ne veut pas être le seul responsable en cas d'accident. En 1991, le réacteur est mis à l'arrêt. 1986 : la centrale nucléaire de Mühlheim-Kehrlich est mise en service. Il s'avère que le permis de construire était erroné, le risque sismique n'a pas été pris en compte de manière adéquate. Le gouvernement du Land était alors issu de la CDU et voulait absolument permettre l'exploitation. Le tribunal administratif en a décidé autrement. En 1988, la centrale est fermée. 1986 Tchernobyl. Le SPD devient un parti qui vise la sortie du nucléaire. Mais cela n'a pas encore d'effet politique. 1986 Un sociologue du nom d'Ulrich Beck écrit le livre "Die Risikogesellschaft" (La société du risque), ce sera un succès inhabituel pour un tel ouvrage spécialisé. Thème du livre : Ulrich Beck marque une rupture dans une époque avec le concept de "société du risque". Selon lui, les forces productives en croissance rapide ont certes largement aboli la misère matérielle, du moins dans ce que l'on appelle le premier monde. Mais en même temps, ce même processus libère des risques et des potentiels d'auto-menace d'une ampleur sans précédent. Le progrès technico-économique déchaîné a atteint un niveau où il menace de s'annuler lui-même. La logique de production de richesses est de plus en plus dépassée par la logique de production de risques. L'incertitude quant aux conséquences de l'action actuelle sur l'avenir immédiat ou lointain. La conséquence est la "situation paradoxale où l'on doit agir alors qu'il n'existe finalement pas les bases correspondantes". A partir de là, les centrales nucléaires continuent de fonctionner, mais aucune nouvelle n'est construite. 2000 : Le gouvernement rouge-vert décide de sortir du nucléaire par consensus avec les entreprises d'électricité. 2010 : Le nouveau gouvernement CDU/FDP sortie de la sortie du nucléaire. Les centrales continuent de fonctionner. 2011 : Fukushima : le gouvernement est toujours CDU/FDP, mais la sortie du nucléaire (durée jusqu'en 2022) est décidée, car Merkel a peur des prochaines élections. Déchets : chaque transport de déchets nucléaires a donné lieu à des situations de guerre civile. Il y a eu le dépôt final bâclé (Asse), qui doit être assaini à grands frais. Prix : je pense qu'il y a un sentiment largement répandu en Allemagne que les déchets et les ruines, s'ils sont traités selon les normes allemandes souhaitées, auront un coût pratiquement infini. Je ne dis pas que c'est un calcul rationnel. Je viens d'avoir une idée géniale. Si je me base sur la thèse d'Ulrich Beck sur la société du risque, la France se trouve encore dans les luttes de statut de la société industrielle. Le cri de détresse est : j'ai faim ! Mais l'Allemagne est déjà la "société du risque" revendiquée par Beck. Elle est égalitaire, car le risque nucléaire concerne les riches et les pauvres. L'appel à l'aide est : j'ai peur ! (Oui, ma thèse est un peu bancale, on peut sans doute aussi avoir peur de la faim). C'est anecdotique, mais les Allemands ont une forte aversion au risque. Ils dépensent 1000 euros par an pour l'inspection de leur voiture. Ils peuvent vivre avec le fait de mourir un peu chaque jour et de perdre un peu d'argent, car c'est prévisible. Mais ils ont peur de la seule grande catastrophe qui arrivera demain ou jamais. Il existe en allemand le mot "Hochrisikotechnologie" (technologie à haut risque). Il est toujours utilisé en rapport avec l'énergie nucléaire, presque jamais en rapport avec d'autres technologies. Il semble qu'il ait été inventé spécialement pour le nucléaire. Les Français, eux, laissent le bon Dieu être un homme bon. Ils se rendent à Antibes dans de petites voitures blanches sans freins. Ils n'ont pas peur, mais se mettent vite en colère. Je suis désolé, mais je ne peux pas donner de réponse logique, rationnelle et satisfaisante.