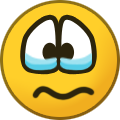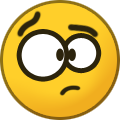-
Compteur de contenus
25 675 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.politico.eu/article/european-council-summit-eu-agrees-e90b-ukraine-loan-russian-assets-plan-fails/ (19 décembre 2025) Les gouvernements européens n'ont pas réussi à trouver un accord sur le transfert des avoirs gelés de la Russie vers l'Ukraine après un sommet de 16 heures à Bruxelles, ce qui constitue un revers majeur pour le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les pays ont été contraints de se mettre d'accord sur un plan de secours d'urgence basé sur la dette commune de l'UE, qui a été défendu pendant des semaines par le Premier ministre belge Bart De Wever et qui était considéré comme peu probable jusqu'à quelques heures avant la conclusion de l'accord. Portant un nouveau coup à l'unité de l'UE, trois pays ― la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ― ne participeront pas à cet accord. Bien que l'accord permette à chacun de crier victoire, ce n'était pas la solution que l'Allemagne et la Commission avaient défendue avant le sommet. « Bien sûr, certaines personnes ne l'ont pas apprécié... elles veulent punir [le président russe Vladimir] Poutine en lui prenant son argent », a déclaré M. De Wever, faisant référence au projet initial d'utiliser les actifs de la Russie. Mais « la politique n'est pas une affaire émotionnelle » et « la rationalité a prévalu ». Si cette option plaisait aux pays du sud, elle n'avait pas les faveurs de l'Allemagne et de ses alliés d'Europe du nord, qui se sont traditionnellement opposés à la garantie des obligations de leurs homologues fortement endettés. -

Relations et Rivalité Chine / Etats-Unis
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/washington-s-china-consensus-breaking (18 décembre 2025) Trump adhère à une conception étroite de la concurrence, avec peu de griefs persistants au-delà de l'ampleur de l'excédent commercial chinois et de ses exportations de précurseurs du fentanyl. Il semble considérer Xi non pas comme un autocrate impérial, mais comme un rival commercial, avec lequel il peut établir une relation durable et asseoir les relations bilatérales sur des bases plus stables. En effet, le respect de Trump pour Xi semble s'être accru au cours de l'impasse commerciale qui a dominé les relations entre les États-Unis et la Chine depuis qu'il a lancé son offensive tarifaire « Liberation Day » début avril. Avant leur rencontre à Pusan fin octobre, Trump a déclaré que le « G2 » se réunirait, faisant apparemment ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait envisagé – ou jugé nécessaire – d'accepter : reconnaître le statut de Pékin comme un égal de Washington. La nouvelle stratégie de sécurité nationale reflète cette conclusion, estimant que les relations entre les États-Unis et la Chine « se sont transformées en relations entre deux puissances quasi équivalentes ». Contrairement à la première NSS de l'administration Trump, qui mettait l'accent sur la « concurrence entre grandes puissances » avec la Chine et la Russie, et à la NSS de l'administration Biden, qui déclarait que la Chine était « le seul concurrent ayant à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et, de plus en plus, le pouvoir de le faire », les dernières orientations stratégiques ne donnent plus la priorité à la résurgence de Pékin, mais accordent plutôt la priorité aux menaces provenant de l'hémisphère occidental. Un nombre restreint mais croissant de travaux universitaires remettent en cause l'hypothèse largement répandue selon laquelle la Chine serait déterminée à remplacer les États-Unis en tant que première puissance mondiale et à établir un ordre sinocentrique [1]. Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a déclaré dans un discours prononcé ce mois-ci lors du Forum Reagan sur la défense nationale que Trump recherchait « une paix stable, un commerce équitable et des relations respectueuses ». Quelques jours plus tôt, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait déclaré que « la décision actuelle est... d'assurer la stabilité dans cette relation ». [1] https://direct.mit.edu/isec/article/50/1/46/132729/What-Does-China-Want (1er août 2025) En nous appuyant sur les données issues de 12 000 articles et de centaines de discours de Xi Jinping, nous analysons trois termes ou expressions tirés de la rhétorique chinoise afin de discerner les intentions de la Chine : « lutte » (斗争), « ascension de l'Orient, déclin de l'Occident » (东升西降) et « aucune intention de remplacer les États-Unis » (无意取代美国). Nos conclusions indiquent que la Chine est une puissance du statu quo soucieuse de la stabilité du régime et davantage tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur. Les objectifs de la Chine sont clairs, durables et limités : elle se soucie de ses frontières, de sa souveraineté et de ses relations économiques extérieures. Les principales préoccupations de la Chine sont presque toutes régionales et concernent des parties de la Chine que le reste de la région a reconnu comme chinoises : Hong Kong, Taïwan, le Tibet et le Xinjiang. Notre argumentation a trois implications principales. Premièrement, la Chine ne représente pas le type de menace militaire que la sagesse conventionnelle prétend qu'elle représente. Ainsi, une posture militaire hostile des États-Unis dans le Pacifique est imprudente et pourrait créer des tensions inutiles. Deuxièmement, les deux pays pourraient coopérer sur plusieurs questions négligées. Troisièmement, la vision conventionnelle de la Chine minimise les domaines économiques et diplomatiques auxquels une approche guerrière n'est pas adaptée. -

Inde : politique intérieure et internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-dispute-india-over-arunachal-pradesh (17 septembre 2025) À la fin du mois dernier, une citoyenne indienne nommée Prema Thongdok, qui voyageait de Londres au Japon, a été détenue pendant 18 heures lors de son escale à Shanghai. Les autorités chinoises ont déclaré que son passeport n'était pas valide car il indiquait comme lieu de naissance l'État indien d'Arunachal Pradesh, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire. L'intéressée a également rapporté que les autorités lui avaient dit qu'elle n'était pas indienne, mais chinoise, et qu'elle ne pouvait pas poursuivre son voyage vers le Japon. -

ZEE française La France d'Outre-mer et son voisinage
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2025/le-major-general-de-la-gendarmerie-nationale-en-deplacement-en-nouvelle-caledonie (18 décembre 2025) Le général de corps d’armée André Petillot, Major général de la Gendarmerie nationale (MGGN), s’est rendu en Nouvelle-Calédonie, du 12 au 15 décembre 2025 Afin d’assurer sa mission de sûreté publique, le Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, armé par quelque 700 militaires, s’appuie notamment sur quatre compagnies, une Section de recherches (S.R.), une Section d’appui judiciaire (SAJ), deux Brigades motorisées (B.Mo.), une Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA), une Brigade nautique (B.N.), un Peloton de surveillance et d'intervention à cheval (PSIC), une Cellule prévention technique de la malveillance (CPTM), ainsi qu’une Maison de protection des familles (MPF). Le COMGENDNC bénéficie du renfort de 17 EGM et de l’appui de nombreux réservistes. -

co² Effondrement écologique et civilisationnel en ce siècle ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Alexis dans Economie et défense
https://la1ere.franceinfo.fr/les-mangroves-de-wallis-et-de-nouvelle-caledonie-menacees-d-effondrement-1653368.html Les mangroves de Wallis sont en danger critique, le dernier stade avant l'effondrement, et celles de Nouvelle-Calédonie sont évaluées comme vulnérables, selon un rapport publié le 11 décembre. En cause : le changement climatique et l'urbanisation.- 2 408 réponses
-
- 1
-

-
- effondrement
- ecologie
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Personne ne sait ce que les Ukrainiens veulent. Cela fait des années qu'il n'y a pas eu d'élections. S'il y en a eu elles n'étaient pas forcément libres. Il y a des partis politiques interdits. Il y a des prisonniers d'opinion. Il y a un contrôle et une censure de l'information... -

Bielorussie. Présent et avenir.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tetsuo dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.eurotopics.net/fr/350038/belarus-loukachenko-libre-des-detenus-politiques L'assouplissement des sanctions américaines ne profitera que partiellement au pays, analyse Evropeïska Pravda (Ukraine, 15 décembre 2025) : « L'absence de port empêche Loukachenko de bénéficier pleinement de la levée des sanctions sur le potassium. En effet, le transport ferroviaire 'engloutit' les recettes, et les capacités d'accueil des ports maritimes russes ne suffisent pas pour venir en aide à la Biélorussie. La levée de ces sanctions pourrait avoir des effets plus tangibles si la Lituanie acceptait d'autoriser à nouveau le transit des engrais biélorusses vers Klaipėda, ce qui permettrait à Loukachenko d'augmenter considérablement ses exportations. Mais Vilnius a déjà fait savoir qu'aucune concession ne serait faite au régime biélorusse. » Sur Facebook, l'historien Andreï Zoubov (13 décembre 2025 ; russe exilé en République Tchèque ?) explique comment Loukachenko en profitera : «Le dictateur bélarusse a indéniablement amélioré son image politique et celle de son régime. Désormais, il apparaît presque comme un humaniste et un homme sensé. D'autant qu'il a décidé de ne pas s'impliquer dans la guerre de la Russie en Ukraine. … La levée des sanctions ciblant le principal secteur d'exportation du pays – l'extraction et le traitement du potassium –, ravivera cette production, créera des milliers de nouveaux emplois et apportera des recettes considérables au pays, via la vente aux Etats-Unis et, de là, vers le monde entier. … Cette disposition favorable au dialogue avec l'Occident permettra au régime de Loukachenko de se stabiliser et de réduire sa dépendance vis-à-vis de Poutine.» Dans un post Facebook repris par Censor.net, le politologue Serhiy Taran (Ukraine, 13 décembre 2025) explique quelles sont, selon lui, les motivations de Trump : «L'accord entre le Bélarus et les Etats-Unis doit théoriquement éloigner Loukachenko de Poutine et lui donner une marge de manœuvre. Loukachenko est prêt à jouer le jeu. … Trump croit toutefois que le Bélarus aura ainsi davantage de souveraineté et que les options de Poutine seront restreintes. Les Etats-Unis partent du principe qu'il est préférable d'avoir à faire à deux petits dictateurs plutôt qu'à un seul grand – ce que Poutine deviendrait s'il absorbait définitivement le Bélarus de Loukachenko.» -

Italie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de alexandreVBCI dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ft.com/content/616d7c24-fbb6-4830-aa6c-77d362b5fddb (18 décembre 2025) Putin’s retaliation threat over frozen assets rattles EU capitals Italy, Belgium and Austria worry about Russia moving against their companies Selon l'Institut KSE, bien que 1 903 entreprises étrangères se soient retirées de Russie ou aient réduit leurs activités dans ce pays depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a près de quatre ans, 2 315 restent actives dans le pays. Parmi celles-ci figurent les succursales russes de banques telles que l'autrichienne Raiffeisen et l'italienne UniCredit, qui ont généré d'importants bénéfices en temps de guerre qu'elles ne peuvent rapatrier en raison de l'interdiction de verser des dividendes. Selon l'Institut KSE, les entreprises étrangères ont réalisé 19,5 milliards de dollars de bénéfices en Russie l'année dernière. Andrea Orcel, directeur général d'UniCredit, a déclaré lors d'une audition devant le Sénat italien le mois dernier que la banque n'avait pas l'intention de se retirer de Russie, même si elle y avait environ 3,5 milliards d'euros de capitaux bloqués. « S'ils me nationalisent, c'est une violation de la loi, et je conserve un crédit à perpétuité auprès de la Fédération de Russie », a déclaré M. Orcel. La semaine dernière, le gouvernement italien a soutenu la décision de l'UE de geler indéfiniment les avoirs russes, mais a également fait part de ses inquiétudes quant aux risques potentiels liés à leur utilisation pour financer l'Ukraine. Le sénateur italien Claudio Borghi, membre du parti d'extrême droite Ligue, partenaire pro-business et pro-russe de la coalition de Giorgia Meloni, a mis en garde contre les répercussions si l'UE allait de l'avant avec ses projets. « Comment pouvez-vous penser que voler l'argent d'un autre pays n'entraînera pas d'autres catastrophes ? », a déclaré M. Borghi au FT. « La première conséquence est que la Russie se sentira libre de confisquer tous les actifs étrangers. » L'Autriche craint également que Moscou ne décide de saisir Raiffeisen, la plus grande banque du pays, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars en Russie l'année dernière. « Il s'agit d'un domaine juridique inexploré, et franchement, on comprend de moins en moins pourquoi la Commission ne communique pas davantage avec les États membres et ne leur donne pas au moins le sentiment que leurs préoccupations sont prises au sérieux », a déclaré un responsable autrichien. Ces saisies pourraient affecter les investisseurs occidentaux qui détenaient des titres russes cotés en bourse avant l'invasion, ainsi que les entreprises occidentales ayant des participations dans des sociétés russes ou des activités dans le pays. Après que les pays occidentaux ont gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes au début de la guerre, Moscou a réagi en interdisant aux investisseurs occidentaux de vendre leurs titres russes et d'en retirer les bénéfices. Les dividendes et les coupons sont conservés dans des comptes dits de type C sous le contrôle de la Russie. La Russie a autorisé certains investisseurs occidentaux à retirer une partie des fonds. Mais la valeur des comptes de type C a probablement augmenté de manière significative depuis mars 2023, date à laquelle la Russie a révélé que 500 milliards de roubles (6,3 milliards de dollars) d'actifs occidentaux gelés y étaient détenus, selon Alexandra Prokopenko, ancienne responsable de la banque centrale. La Sberbank, la plus grande banque russe, a déclaré avoir versé l'année dernière environ 25 % de ses 787 milliards de roubles de dividendes pour 2024 sur des comptes de type C. Les sommes ont continué à s'accumuler même si de nombreuses entreprises occidentales ont amorti leurs investissements. Les dividendes de BP provenant de sa participation de 19,75 % dans Rosneft s'élèvent probablement à environ 340 milliards de roubles, a déclaré Mme Prokopenko, tandis qu'une décision de justice de 2024 a établi que JPMorgan détenait 243 milliards de roubles d'actifs russes « principalement » dans des comptes de type C. « C'est l'un des atouts de Moscou. Si l'Europe décide de s'attaquer aux réserves russes, la Russie peut simplement transférer les fonds des comptes de type C vers le budget », a déclaré Mme Prokopenko. « Cela lui procure une source de revenus directs alors qu'elle est en déficit et dépense trop dans le domaine de la défense. » Cette mesure montrerait également que la Russie est « prête à rendre la pareille », a-t-elle ajouté. « Contrairement à l'Europe, le Kremlin peut agir rapidement sans s'empêtrer dans des procédures judiciaires. » -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Y avait-il une alliance militaire ? Une coopération militaire entre l'Ukraine et la Russie ? En 1998, le parti communiste ukrainien gagne les élections : https://en.wikipedia.org/wiki/1998_Ukrainian_parliamentary_election Cela constitue un fort désalignement avec la Russie qui, suite à l'élection controversée de 1996 (1) a mis le parti communiste en minorité. Si l'Ukraine avait voulu faire plaisir à Boris Eltsine, elle n'aurait pas voté communiste. (1) voir le documentaire de Madeleine Leroyer "1996, hold-up à Moscou" et les autres références que j'ai postées ici : - B https://www.facebook.com/mdesarnez/videos/audition-dhélène-carrère-dencausse-secrétaire-perpétuel-de-lacadémie-française-s/10155968761522184/ Hélène Carrère d'Encausse A 00:25:55 (B 10:35) "Il [Boris Eltsine] a été réélu [en 1996] tout simplement parce que les Etats-Unis ont manipulé l'élection aux Russes, et je crois que c'est le moment de le dire puisqu'on s'intéresse à qui manipule les élections". A 00:30:30 "On peut raconter ce qu'on veut, mais et le chancelier Kohl et James Baker avaient admis que oui, l'OTAN n'aurait pas de raison de s'élargir à l'Est, dès lors que tout le système changeait". A 43:30 "les révolutions de couleur ont été ressenties dès 2003-2004 comme des révolutions manipulées, c'est à dire non pas directement par les Etats-Unis mais par les ONG... enfin l'argent américain a largement circulé, largement de George Soros aussi, et caetera". A 43:50 "2014 c'est beaucoup plus flagrant : j'ai été à Maidan... l'argent se distribuait, la spontanéïté était largement entretenue par une aide, l'aide à la démocratie étant le prétexte officiel". - -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Certains sont d'avis que la solution pour des pays complexes comme l'Ukraine c'est non pas des choix binaires (comme c'est le cas dès qu'on fait des référendums d'autodétermination), mais un fédéralisme qui compose avec la pluralité des identités : https://en.wikipedia.org/wiki/Viacheslav_Chornovil Le 16 février 1989, l'Union des écrivains a publié un projet de programme pour son groupe proposé dans Literary Ukraine, dans lequel elle appelait à l'établissement de l'ukrainien comme langue officielle de la RSS d'Ukraine, à un renouveau national et culturel, à l'autonomie ukrainienne, ainsi qu'au renforcement des droits linguistiques des minorités en Ukraine. [Chornovil] a publié son programme électoral en août 1989, avant les élections au Soviet suprême de mars 1990, dans lequel il appelait à « l'indépendance, la démocratie et l'autonomie », à la coopération avec les non-Ukrainiens ethniques et au fédéralisme. Le concept d'une Ukraine fédérale proposé par Chornovil reposait sur douze « pays » (en ukrainien : землі, romanisé : zemli), dont les frontières internes étaient grossièrement définies par les provinces de la République populaire ukrainienne, plus une terre distincte pour le Donbass. La Crimée devait exister soit comme un État indépendant, soit comme une république autonome de l'Ukraine, et la Rada centrale devait être rétablie en tant qu'organe bicaméral comprenant des députés élus en nombre égal par représentation proportionnelle et provenant des pays. Le 8 septembre 1989, le Mouvement populaire d'Ukraine (en ukrainien : Народний рух України, romanisé : Narodnyi rukh Ukrainy, abrégé en « Rukh ») a été créé sur la base du programme de l'Union des écrivains. Chornovil a continué à défendre le fédéralisme, déclarant lors d'une conférence de presse en mai 1990 que le « centralisme de Kiev » conduirait à l'émergence d'un nationalisme russe dans le Donbass et d'une identité ruthène dans l'oblast de Transcarpatie[108]. L'historien Stepan Kobuta a avancé que le rejet des lois soviétiques par la Galicie était l'expression des convictions fédéralistes de Chornovil. Lors des élections de [1998], le Rukh a changé d'avis sur le fédéralisme, Chornovil affirmant que les appels en faveur de la transformation de l'Ukraine en république fédérale relevaient du « fédéralisme clanique ». Lors du neuvième congrès du Rukh [uk], qui s'est tenu les 12 et 13 décembre 1998, Chornovil a annoncé la stratégie du parti pour l'élection présidentielle de 1999. Intitulée « En avant, vers l'est », cette stratégie appelait à se concentrer davantage sur les populations de l'est et du sud de l'Ukraine tout en maintenant son opposition à l'établissement du russe comme langue co-officielle avec l'ukrainien.[168] Plus grave encore, Chornovil a été accusé d'ignorer les réalités politiques au profit du « romantisme » et d'avoir une attitude naïve envers la politique, comme le souligne le philosophe et écrivain Petro Kraliuk dans un article publié en 2017 dans Radio Liberty [uk]. Kraliuk note en particulier que la croyance de Chornovil dans le fédéralisme et son refus de travailler avec Kravtchouk après sa défaite électorale de 1991 sont contre-productifs. [198] -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
C'est le statut dont a joui l'Ukraine jusqu'en 2004 ou 2005, date où l'Ukraine a mis l'adhésion à l'OTAN dans un article de sa constitution, lorsqu'auparavant figurait au contraire la neutralité. De 1991 à 2004 l'Ukraine a vécu en tant que pays neutre. Le même Arestovich expliquait dans son interview à Unherd qu'à Istanbul en mars 2022, ils ont sablé le champagne avec les Russes, parce qu'ils avaient réussi à se mettre d'accord sur presque tout, principalement la neutralité. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Citant Olivier Zajec dans l'Express : Les Russes considèrent qu’ils sont à proximité de leur barycentre stratégique ; que la perte de leur influence sur l’Ukraine signifierait leur sortie du groupe de polarités de premier niveau ; qu’ils ne feraient plus dialogue égal avec la Chine, les Etats-Unis, etc. Et ça, ils ne l’acceptent pas. Ils ont le sentiment d’avoir été "clochardisés" pendant dix ans après la chute de l’URSS. Ils ont vécu une période noire dont ils se souviendront toujours, et dont l’élection de Poutine était en partie une conséquence. Et donc, les deux nations considèrent cette guerre comme existentielle. L’Ukraine, qui a une identité historique, ne veut pas être avalée par la Russie. Elle ne veut pas, non plus, du destin de "zone tampon", c’est-à-dire de "zone neutre" à laquelle Poutine consentirait au mieux la réduire. J'ai une divergence avec Olivier Zajec s'agissant de "l'identité historique" de l'Ukraine. C'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs Ukraines, qui ensemble forment un tout, mais qui prises séparément ont des identités régionales et des histoires régionales assez différentes. Et donc parmi toutes ces identités, toutes ces facettes, Olivier Zajec opère un choix, en excluant les autres. Par exemple il ne fait guère de doute, aux vu du sondage Gallup d'avril 2014, que la Crimée "veut au contraire être avalée par la Russie" : D'autre part, la focalisation sur "l'identité historique" est maladroite, parce que au cours de l'histoire, les périodes où l'on a pu voir une entité ukrainienne indépendante, un État ukrainien indépendant, sont assez courtes comparé à des pays comme la Russie, la France, l'Angleterre, ou même la Pologne. Le coeur de l'identité ukrainienne est donc, je pense, plus culturel et linguistique, qu'historique. La culture, c'est ce qui reste quand vous n'avez plus d'État, comme le disait le pape Jean-Paul II à l'Unesco le 2 juin 1980 : https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html Je suis fils d’une Nation qui a véçu les plus grandes expériences de l’histoire, que ses voisins ont condamnée à mort à plusieurs reprises, mais qui a survécu et qui est restée elle-même. Elle a conservé son identité, et elle a conservé, malgré les partitions et les occupations étrangères, sa souveraineté nationale, non en s’appuyant sur les ressources de la force physique, mais uniquement en s’appuyant sur sa culture. Cette culture s’est révélée en l’occurrence d’une puissance plus grande que toutes les autres forces. Et donc si les périodes historiques où l'on a pu voir une Ukraine indépendante sont rares et courtes, en revanches celles où l'Ukraine a été intégrée à des empires sont longues et cette capacité d'adaptation aux empires peut, si l'on veut, être vue comme une caractéristique de l'identité ukrainienne, si l'on suit la réflexion de Josef Zissels, ancien dissident et intellectuel : Il y a également une portion de la société qui est prête à s’adapter à n’importe qui, aux Américains, aux Russes, aux Japonais, aux Chinois ! L’une des caractéristiques de l’identité ukrainienne est un potentiel très élevé d’adaptation. Les Ukrainiens se sont toujours adaptés, aux Polonais, aux Turcs, aux Russes... Ils n’ont jamais eu la force de vaincre tout ce qui les entourait. Mais l’élan vers la liberté existe également en eux. Je soupçonne pour ma part que le désir de l'Ukraine maïdaniste d'adhérer à l'OTAN n'est pas un véritable désir d'indépendance. C'est plutôt le reflet d'un désir inconscient d'intégrer un empire. C'est le "s'adapter (...) aux Américains" de Josef Zissels. -

La technologie contre la démocratie ?
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.bbc.com/news/articles/cn8er32715do (17 décembre 2025) La tricherie en matière de dissertation à l'université : un « secret de polichinelle » M. Littlewood travaillait comme avocat lorsqu'il a commencé à rédiger des dissertations pour d'autres personnes en 2003. Son entreprise affirme aujourd'hui faire appel à un réseau mondial de 3 000 rédacteurs indépendants, dont certains seraient des professeurs d'université, couvrant des domaines tels que le droit, le commerce et la sociologie. Il a déclaré que ses prix commençaient à 200 £, mais que les commandes plus importantes pour des essais de niveau doctorat ou master pouvaient coûter « jusqu'à 20 000 £ ». M. Littlewood a déclaré avoir désormais développé sa propre intelligence artificielle, en s'appuyant sur des centaines de milliers de dissertations rédigées par son entreprise. Cela signifie que les clients peuvent obtenir en quelques minutes une dissertation de niveau universitaire avec une « note garantie ». M. Foster a déclaré qu'il pensait que la tricherie était plus répandue chez les étudiants internationaux, car certains d'entre eux ne maîtrisaient pas suffisamment l'anglais. Il a donné l'exemple d'un étudiant étranger qui avait obtenu 2 % à un examen et 99 % à une dissertation. « Lorsque vous constatez un tel écart entre les notes, il est évident que l'étudiant a triché », a-t-il déclaré. « Lorsqu'un étudiant qui a clairement des difficultés avec la langue rend une dissertation dont William Shakespeare serait fier, cela éveille immédiatement les soupçons. » Sur les 53 établissements d'enseignement supérieur qui ont fourni des réponses exploitables, 48 ont signalé que les étudiants étrangers étaient surreprésentés dans les enquêtes pour fraude académique. Les établissements d'enseignement supérieur vérifient les dissertations à l'aide de programmes tels que Turnitin, conçus pour détecter le plagiat et la fausse paternité. Annie Chechitelli, directrice des produits chez Turnitin, a déclaré que l'essor de l'IA avait rendu la détection et la dissuasion « plus cruciales que jamais ». Dans plus d'un article sur dix examinés depuis 2023, Turnitin a déclaré que son outil de détection avait détecté qu'au moins 20 % du contenu avait été rédigé par une IA. Turnitin a déclaré que les usines à dissertations étaient toujours populaires en raison d'une demande croissante pour des services permettant d'échapper à la détection par IA, exploitant ainsi la crainte des étudiants d'être pris. Eve Alcock, directrice des affaires publiques de l'Agence d'assurance qualité, qui vise à améliorer les normes dans l'enseignement supérieur, a déclaré que les usines à dissertations restaient une « menace pour l'intégrité académique à travers le Royaume-Uni ». Elle a encouragé les universités à envisager de s'éloigner des évaluations basées sur des dissertations en réponse à l'essor des outils d'IA générative, afin de permettre des évaluations plus « authentiques ». -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Le titre du Washington Post est assez clair : https://www.washingtonpost.com/kidspost/2022/10/04/russia-annexation-ukraine-peace-talks/ L'Ukraine exclut des pourparlers de paix après que la Russie a revendiqué une partie du pays Le sous-titre du Guardian aussi : https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/ukraine-applies-for-nato-membership-after-russia-annexes-territory Volodymyr Zelenskiy qualifie la cérémonie de Moscou de farce et exclut toute négociation avec Poutine [c'est moi qui souligne] Dans son allocution vendredi, diffusée sur Telegram, Zelenskiy a qualifié la cérémonie à Moscou de « farce » insignifiante. Il a déclaré qu'aucune négociation de paix avec la Russie ne serait possible tant que Poutine serait président. « Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Nous sommes prêts à dialoguer avec la Russie, mais uniquement avec un autre président russe », a-t-il déclaré. Zelenskiy a promis que les forces armées ukrainiennes continueraient à libérer le territoire de l'occupation russe, malgré les insinuations de Poutine selon lesquelles Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre les terres qu'elle a saisies. « L'ensemble de l'Ukraine sera libéré de cet ennemi », a-t-il déclaré. Moscou est contre « la vie, la loi, l'humanité et la vérité », a-t-il ajouté. Le bureau du président a fait savoir qu'il n'avait pas regardé le discours de Poutine. Au lieu de cela, Zelenskiy a convoqué son conseil de sécurité nationale et rencontré le commandant en chef de ses forces armées, le général Valeriy Zaluzhnyi. Il a déclaré qu'ils avaient discuté des progrès sur le champ de bataille et des livraisons d'armes. Zelenskiy a ajouté : « Tout sera ukrainien. » Zelenskiy a déclaré que la volonté de Poutine de tuer et de torturer afin d'étendre sa « zone de contrôle » était de la folie. Les commentateurs ukrainiens ont approuvé. Ils ont qualifié le président russe de délirant et ont déclaré que son nouveau « traité » intégrant quatre régions de l'Ukraine à la Russie ne changerait rien à la situation sur le terrain, où les troupes ukrainiennes sont sur le point de remporter une victoire majeure. Quelques jours après, Elon Musk fait une proposition de paix : https://www.npr.org/2022/10/04/1126714896/elon-musk-ukraine-peace-plan-zelenskyy [Musk] a déclaré lundi dans un tweet que pour parvenir à la paix, la Russie devrait être autorisée à conserver la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014. Il a également déclaré que l'Ukraine devrait adopter un statut neutre et renoncer à sa candidature à l'OTAN après la mobilisation partielle des réservistes russes. Musk a également franchi une ligne rouge pour l'Ukraine et ses partisans en suggérant que les quatre régions que la Russie s'apprête à annexer à la suite des « référendums » orchestrés par le Kremlin et dénoncés par l'Occident comme étant une imposture devraient organiser de nouveaux scrutins sous l'égide des Nations unies. Musk a rappelé que la Crimée faisait partie de la Russie jusqu'à ce qu'elle soit cédée à l'Ukraine sous l'Union soviétique dans les années 1950, et a déclaré qu'une guerre prolongée ne se solderait probablement pas par une victoire éclatante de l'Ukraine. Ces positions sont un anathème pour Zelensky, qui les considère comme pro-Kremlin. Le dirigeant ukrainien s'est engagé à récupérer tous les territoires conquis pendant la guerre et considère que la Crimée appartient également à l'Ukraine. Musk a également lancé un sondage sur Twitter pour savoir si « la volonté du peuple » devait décider si les régions saisies devaient rester ukrainiennes ou devenir russes. Dans une réponse sarcastique, Zelenskyy a publié son propre sondage sur Twitter demandant « quel Elon Musk préférez-vous ? » : « Celui qui soutient l'Ukraine » ou « Celui qui soutient la Russie ». Musk a répondu à Zelensky : « Je soutiens toujours fermement l'Ukraine, mais je suis convaincu qu'une escalade massive de la guerre causera un grand préjudice à l'Ukraine et peut-être même au monde entier. » Andrij Melnyk, l'ambassadeur ukrainien sortant en Allemagne, a répondu au tweet original de Musk par une obscénité [1]. « La Russie procède à une mobilisation partielle. Elle passera à une mobilisation totale si la Crimée est menacée. Les pertes humaines seront dévastatrices des deux côtés », a écrit Musk dans un autre tweet. « La Russie a une population trois fois supérieure à celle de l'Ukraine, donc une victoire de l'Ukraine dans une guerre totale est peu probable. Si vous vous souciez du peuple ukrainien, recherchez la paix. » [1] 'F**k off' : https://au.news.yahoo.com/elon-musk-blasted-by-ukrainian-diplomat-060309919.html De la grande diplomatie, assurément. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Je crois que tu réécris l'histoire. Assortir ce "compromis" de l'exigence du départ du pouvoir de Vladimir Poutine, c'est à dire d'un changement de régime à Moscou, cela équivaut non pas à une volonté de compromis, mais à une volonté d'intransigeance : https://kyivindependent.com/didnt-zelensky-impose-a-ban-on-talks-with-putin-not-really/ (12 mai 2025) À l'automne 2022, Zelensky a signé un décret « déclarant l'impossibilité de mener des négociations avec le président russe Poutine ». Le décret concernant les négociations avec Poutine faisait suite aux cinq décisions approuvées par le Conseil national de sécurité et de défense le 30 septembre 2022. Quelques jours plus tard, le document a été signé par Zelensky. Bien que le décret ne mentionne pas explicitement l'interdiction de mener des pourparlers, beaucoup y ont vu une interdiction de facto des discussions directes avec Poutine. « Il (Poutine) ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Nous sommes prêts à dialoguer avec la Russie, mais avec un autre président russe », avait déclaré Zelensky à l'époque. Et donc l'Ukraine est restée guidée par cette forme d'intransigeance jusqu'en 2025 lorsque l'administration Trump l'a fait changer de position. -

Portugal
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.eurotopics.net/fr/350174/le-portugal-meilleure-economie-de-2025-# (15 décembre 2025) Le célèbre hebdomadaire britannique The Economist a élu le Portugal meilleure économie de l'année. -

Corée du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3336763/south-korea-reopens-bitter-debate-lifting-ban-north-korean-state-media (17 décembre 2025) Un groupe de législateurs du Parti démocratique au pouvoir en Corée du Sud cherche à assouplir l'interdiction vieille de plusieurs décennies qui frappe les sites web nord-coréens tels que le Rodong Sinmun en ligne, relançant ainsi le débat sur la sécurité nationale et la liberté d'information. La révision proposée, rédigée par le représentant Han Min-soo et 11 autres législateurs, permettrait aux citoyens sud-coréens de consulter librement les sites web nord-coréens, tout en maintenant les interdictions existantes concernant la distribution ou la promotion active de contenus qui enfreignent la loi sur la sécurité nationale. -

Corée du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3336787/vietnamese-womans-death-amid-raid-south-korea-spurs-demand-visa-policy-change (17 décembre 2025) Le décès d'une Vietnamienne à Daegu après avoir tenté d'échapper à une descente des services d'immigration sud-coréens a intensifié la remise en question des règles restrictives du pays en matière de visas de travail pour les étudiants internationaux diplômés des universités locales. Selon le journal Hankyoreh, Vu Tu Anh, 25 ans, est décédée après avoir fait une chute de trois étages depuis le climatiseur d'une usine de pièces automobiles où elle travaillait illégalement. Elle s'était cachée derrière l'appareil lorsque les agents de l'immigration ont lancé une opération de contrôle des résidents sans papiers le 28 octobre. Selon un rapport publié par ICEF Monitor, une source d'informations sur les marchés, le nombre d'étudiants étrangers inscrits en Corée du Sud a dépassé les 305 000 en août, soit deux ans avant l'objectif fixé par le gouvernement d'attirer 300 000 étudiants internationaux d'ici 2027. -

Malaisie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Kiriyama dans Politique etrangère / Relations internationales
Sarawak : https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2025/09/26/borders-politics-nations-states-society/ Le Sarawak, en particulier, est très différent de la péninsule, qu'il égale presque en superficie. Il abrite au moins 34 ethnies différentes, dont les Ibans, connus pour leurs longues maisons traditionnelles, qui représentent environ 30 % de la population. Ils ont leurs propres traditions, langues, culture et croyances spirituelles, et la plupart des habitants du Sarawak insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas importer les problèmes raciaux et religieux qui agitent souvent la péninsule. Pendant des décennies, cependant, le Sarawak a fini par être traité comme l'un des 13 États de Malaisie (tout comme le Sabah) pendant la longue période où le Barisan Nasional au pouvoir a remporté toutes les élections. Ainsi, après avoir été un partenaire proche de la Malaisie, l'ancien État souverain du Sarawak a fini par être considéré comme l'un des États constitutifs de l'ancienne Fédération de Malaisie. Tout cela a changé en 2018, lorsque le Barisan a perdu le pouvoir et que la politique malaisienne a été complètement bouleversée. Le Sarawak et Sabah ont pris conscience qu'ils étaient désormais des faiseurs de rois : le quart des sièges qu'ils détenaient au parlement malaisien était essentiel pour permettre à quiconque de former un gouvernement stable au niveau fédéral. Depuis lors, le Sarawak en particulier a réussi à obtenir de plus en plus d'autonomie, mais pas l'indépendance. En 2022, Fadillah Yusof est devenu le premier vice-Premier ministre malaisien originaire du Sarawak, et plus tôt dans l'année, Abang Johari Tun Openg est devenu le premier ministre en chef d'un État à porter un titre plus élevé, celui de premier ministre. -

Allemagne
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
Avec les bombes atomiques stockées à la base de Kleine-Brogel. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Cela fait plaisir de voir cela enfin écrit dans un média du courant principal de la presse. Sholto Byrnes : Indépendamment de la volonté plutôt cynique des dirigeants occidentaux belliqueux de se battre jusqu'au dernier Ukrainien afin d'affaiblir la Russie, cela signifie que les morts et les destructions catastrophiques de l'année dernière auraient peut-être pu être évitées. Si les États-Unis et leurs alliés finissent par exhorter Kiev à accepter un cessez-le-feu dans les mois à venir, ils devront justifier pourquoi ils ont fait le contraire en mars 2022. -

Serbie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/16/serbian-president-threatens-reprisals-belgrade-trump-tower Des manifestants et un procureur ont contrecarré le projet de construction d'une Trump Tower à Belgrade. Dans ce qui constitue un rare revers pour la campagne mondiale de la famille Trump visant à générer des profits, ce projet immobilier de 500 millions de dollars a été abandonné après la mise en accusation lundi d'un ministre serbe soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions pour soutenir le projet. -

Le Canada et sa place sur la scène internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Hornet62 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2211611/souverainete-jeunes-cegep-sainte-foy-debat-referendum (5 décembre 2025) La firme CROP dévoilait, en août, que 56 % des 18 à 34 ans – sur un échantillon de 1000 répondants – étaient favorables à l’indépendance du Québec. En juin, un sondage Léger révélait que 48 % des répondants du même groupe d’âge – sur un échantillon de 1056 personnes – appuyaient l’idée d’un Québec souverain. À leur avis, les réseaux sociaux rendent aussi la tendance plus accessible. Ça nous permet d’avoir un accès facile à des gens qui pensent comme nous. La génération auparavant n’avait pas accès à ces canaux de communication, alors que, maintenant, c’est facile rejoindre un groupe souverainisme. Tu envoies un courriel et "pouf" tu es lancé pour une marche, lance Zacharie Tremblay. « Les jeunes veulent un mouvement souverainiste profondément inclusif, vert, écologique, tourné vers l’avenir. Il ne veut pas haïr. Il ne veut pas fermer », souligne Alexandre Bilodeau. Trente ans après le référendum de 1995, cette nouvelle génération pourrait peut-être avoir à se prononcer sur la question dans les prochaines années. -

Le Canada et sa place sur la scène internationale
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Hornet62 dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/16/mark-carney-british-spellings-canada Mark Carney critiqué pour avoir utilisé l'orthographe britannique dans des documents canadiens Les linguistes affirment que l'utilisation du « s » à la place du « z » par le premier ministre enfreint les conventions nationales de la langue anglaise. -

Afrique du Sud
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/16/south-africa-russia-men-tricked-fighting-ukraine Le gouvernement sud-africain est en pourparlers avec la Russie afin de rapatrier 17 Sud-Africains combattant pour la Russie en Ukraine, après que ces hommes auraient été trompés et envoyés au front par une fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Duduzile Zuma-Sambudla a été accusée dans plusieurs procès d'avoir attiré les 17 Sud-Africains et les deux Botswanais en Russie en juillet, en leur disant qu'ils seraient formés comme gardes du corps pour le parti politique uMkhonto weSizwe de son père ou qu'ils suivraient un cours de développement personnel.