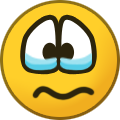-
Compteur de contenus
25 687 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par Wallaby
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Avec les achats chinois de gaz russe non ? -
https://nationalsecurityjournal.org/americas-great-enemy-isnt-china-or-russia-anymore/ (10 décembre 2025) Le rival le plus dangereux des États-Unis n'est ni la Chine ni la Russie, mais leur propre dette. Le Dr Andrew Latham soutient qu'une dette fédérale avoisinant les 100 % du PIB agit désormais comme une « gravité stratégique », détournant les ressources de la défense et limitant les options des États-Unis avant même que les crises ne commencent. La hausse des coûts d'intérêt met le Pentagone sous pression, affaiblit la structure des forces armées et fragilise la base industrielle de défense, alors même que la concurrence à long terme avec Pékin et Moscou exige de l'endurance et une capacité de montée en puissance rapide. La dette empoisonne également la politique intérieure, transformant la politique étrangère en une lutte budgétaire partisane. Le véritable danger n'est pas un effondrement soudain, mais une perte progressive de la liberté stratégique acquise à crédit. La Chine le sait. La Russie en tire parti. Aucune des deux n'a besoin de vaincre directement l'armée américaine si les dirigeants américains s'infligent une défaite à eux-mêmes par leur paralysie budgétaire. La concurrence avec la Chine, le « défi permanent » à long terme des États-Unis, concerne autant la production que les plateformes. Elle dépend de la capacité des États-Unis à construire, réparer et remplacer à grande échelle dans des conditions difficiles. L'endettement encourage les mesures budgétaires à court terme qui sapent cette capacité. Les chaînes de production ralentissent, la main-d'œuvre vieillit et les chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve. Il en résulte une force optimisée pour l'efficacité en temps de paix plutôt que pour l'endurance en temps de guerre. La Chine n'a pas besoin de « gagner » demain. La Russie n'a pas besoin d'une domination mondiale. Les deux pays ont tout à gagner si les États-Unis deviennent une puissance qui réagit plutôt que façonne, qui gère son déclin plutôt que d'imposer ses conditions. C'est là le danger silencieux. Non pas la faillite, mais une perte progressive de liberté stratégique. Les batailles les plus décisives se livreront dans les commissions budgétaires et les bureaux de planification industrielle, dans le cadre d'un travail lent et peu prestigieux consistant à aligner les moyens sur les fins. Les grandes puissances tombent rarement uniquement à cause d'ennemis extérieurs. Le plus souvent, elles sont terrassées par un épuisement stratégique financé à crédit. La question qui se pose aux États-Unis n'est pas de savoir s'ils peuvent dépenser plus que la Chine ou intimider la Russie. Il s'agit plutôt de savoir s'ils peuvent se gouverner suffisamment bien pour rester une puissance avec laquelle il faut compter et contre laquelle il faut s'opposer.
-

Bielorussie. Présent et avenir.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tetsuo dans Politique etrangère / Relations internationales
https://jamestown.org/u-s-belarus-bilateral-dialogue-slowly-resuming/ (4 décembre 2025) Reprise progressive du dialogue bilatéral entre les États-Unis et la Biélorussie La Biélorussie a engagé un dialogue confidentiel avec les États-Unis depuis fin 2024, suivi de réunions publiques de haut niveau et d'appels téléphoniques en 2025. Washington a assoupli certaines sanctions contre la Biélorussie, et Minsk a répondu par une série de gestes de bonne volonté, notamment plusieurs vagues de libération de prisonniers. Minsk considère ces premiers pas vers la normalisation comme une occasion d'obtenir des avantages à long terme, tels que la levée totale des sanctions, le renouveau des relations diplomatiques avec l'Occident et un meilleur accès aux marchés occidentaux. Les responsables biélorusses sont catégoriques : tout accord éventuel ne se fera pas au détriment de leurs relations étroites avec la Russie et la République populaire de Chine, tout en espérant qu'une amélioration des relations avec Washington pourrait faciliter de meilleures relations avec l'Occident en général. Le 9 novembre, le président américain Donald Trump a nommé l'avocat John Coale envoyé spécial des États-Unis en Biélorussie (Truthsocial/@realDonaldTrump, 9 novembre). Cette décision marque une nouvelle étape dans le processus de dialogue déjà mouvementé entre Washington et Minsk. La Biélorussie et les États-Unis ont entamé un dialogue confidentiel à huis clos fin 2024, lorsque le département d'État américain a tenu des « discussions préliminaires » avec ses alliés européens sur un éventuel assouplissement des sanctions contre la Biélorussie (The New York Times, 15 février ; voir EDM, 28 juillet). En janvier, à la demande de Washington et en signe de bonne volonté, Minsk a libéré un citoyen américain emprisonné (voir EDM, 29 janvier). Quelques semaines plus tard, une délégation américaine s'est rendue discrètement à Minsk et a tenu des pourparlers avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui ont abouti à la libération d'autres prisonniers (voir EDM, 21 février). Une autre visite confidentielle de responsables américains fin avril a conduit à la libération d'un autre citoyen américain et biélorusse (voir EDM, 28 juillet). Ces discussions à huis clos ont précédé la première réunion de haut niveau annoncée publiquement le 21 juin, au cours de laquelle le président biélorusse a reçu une délégation américaine dirigée par Keith Kellogg, assistant du président américain et envoyé spécial pour l'Ukraine. Après la réunion, Loukachenko a gracié 14 autres prisonniers, dont Siarhei Tsikhanouski, le mari de Sviatlana Tsikhanouskaya, la chef de l'opposition biélorusse en exil (voir EDM, 28 juillet). Le 11 septembre, le président biélorusse a reçu une autre délégation américaine, qui lui a annoncé que Washington avait levé les sanctions contre la compagnie aérienne nationale biélorusse Belavia (BelTA, 11 septembre). Minsk a libéré le plus grand groupe de prisonniers à ce jour, soit 52 personnes, dont de nombreux dirigeants et militants de l'opposition bien connus (Sb.by, 11 septembre). M. Coale, qui dirigeait la délégation américaine, a déclaré que « l'objectif premier de notre engagement est de normaliser les relations bilatérales [et] d'approfondir et de renforcer notre coopération économique et politique » (BelTA, 11 septembre). Il a ajouté que Washington souhaitait rouvrir son ambassade à Minsk et nommer un ambassadeur. -

Bielorussie. Présent et avenir.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tetsuo dans Politique etrangère / Relations internationales
https://jamestown.org/vilnius-downgrades-tsikhanouskayas-protection/ (23 octobre 2025) Vilnius réduit la protection accordée à Tsikhanouskaya Après avoir fui la Biélorussie en 2020, la leader de l'opposition Sviatlana Tsikhanouskaya a reçu un soutien sans précédent de la Lituanie et de ses partenaires occidentaux, notamment des privilèges diplomatiques et de sécurité au niveau des chefs d'État. En octobre, la Lituanie a réduit le niveau de sécurité accordé à Tsikhanouskaya, invoquant une diminution des menaces et des préoccupations financières. La réaction négative du public a conduit la Lituanie à rétablir temporairement le niveau de sécurité précédent de Tsikhanouskaya, tout en réévaluant les arrangements à long terme dans un contexte de désintérêt croissant de l'Occident pour la Biélorussie. L'opposition biélorusse dépend de financements extérieurs et sa pérennité dépend des priorités changeantes de la communauté démocratique internationale. Pendant plusieurs années, la Lituanie a assuré la sécurité de Tsikhanouskaya au niveau d'un invité diplomatique, grâce au Service de protection des dignitaires, qui lui a fourni une protection 24 heures sur 24, un logement sécurisé, des escortes à l'aéroport et des privilèges diplomatiques. Les coûts annuels s'élevaient à environ un million d'euros (1 159 450 dollars). Cependant, depuis le 1er octobre, Vilnius a transféré sa sécurité au Bureau de la police criminelle, qui offre un niveau de protection moindre, et lui a demandé de quitter dans quelques semaines le logement protégé qui lui était fourni par l'État (The Baltic Times, 7 octobre). Selon Vytenis Adriukaitis, président honoraire du Parti social-démocrate lituanien, « Tsikhanouskaya n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur l'opinion publique en Biélorussie aujourd'hui. La situation a changé, et elle n'est plus perçue comme une menace » pour Loukachenko (LRT, 9 octobre ; The Kyiv Independent, 18 octobre). Les critiques lituaniennes concernant la transparence et la responsabilité des organisations affiliées à Tsikhanouskaya se sont également intensifiées (LRT, 17 juillet). Tsikhanouskaya est la figure la plus éminente représentant l'opposition à Loukachenko en dehors de Biélorussie. Dans un contexte d'opposition fracturée en exil, certains militants biélorusses affirment qu'elle n'a que peu d'influence sur les processus politiques internes biélorusses et qu'elle s'est trop concentrée sur des activités symboliques depuis 2020 (Bolkunets.org, 16 janvier 2024 ; Belarus Partisan, consulté le 22 octobre). Selon Veronika Tsepkalo, une autre membre de l'opposition biélorusse en exil, elle-même et d'autres opposants à Loukachenko lors des élections de 2020 se sentent écartés de l'opposition dominante en exil (Radio Svaboda, 2 août 2023 ; Bolkunets.org, 16 janvier 2024). Pendant plusieurs années, la Lituanie a investi des ressources importantes dans les organisations de Tsikhanouskaya, qui étaient également financées principalement par les États-Unis et l'Union européenne (LRT, 17 juillet). Ce soutien a positionné la Lituanie comme un intermédiaire clé dans les activités de l'opposition biélorusse à l'étranger. -

Pays baltes
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2025-12-09/belarusian-balloons-prompt-emergency-situation-lithuania (9 décembre 2025) L'instauration de la situation d'urgence (qui n'est pas équivalent à l'état d'urgence) marque la dernière mesure prise par les autorités lituaniennes dans le cadre de leurs efforts pour contrer les ballons biélorusses. Le blocus des postes-frontières avec la Biélorussie, imposé en octobre et maintenu pendant trois semaines à titre de mesure de rétorsion, n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté. En réponse, les autorités de Minsk ont interdit aux camions lituaniens se trouvant en Biélorussie de rentrer chez eux. Vilnius affirme que la Biélorussie retient environ 280 véhicules, même si les postes-frontières lituano-biélorusses de Šalčininkai et Medininkai ont été rouverts le 20 octobre. Les autorités de Minsk ont conditionné la résolution de la question à la volonté de Vilnius d'engager des discussions plus larges sur la normalisation des relations bilatérales. Le 9 décembre, Loukachenko a exigé que la Lituanie « compense les pertes » subies par la Biélorussie à la suite des sanctions imposées après 2020. Il a également accusé le gouvernement lituanien de soutenir la communauté biélorusse en exil, y compris les formations paramilitaires volontaires. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maksim Ryzhenkov, s'est également exprimé à plusieurs reprises sur un ton agressif, suggérant que Vilnius aggrave le conflit uniquement pour obtenir « des fonds supplémentaires pour la protection des frontières » de la part de Bruxelles. La saisie de camions lituaniens, associée à des tentatives infructueuses pour les récupérer par le biais de négociations avec les autorités biélorusses, a déclenché des protestations de la part des entreprises de transport lituaniennes, qui menacent désormais le gouvernement de bloquer les routes. La première manifestation est prévue pour le 10 décembre. Des tensions au sein de la coalition au pouvoir sont également apparues, révélant que le gouvernement manque d'une stratégie cohérente à l'égard de Minsk, qui cible la frontière orientale de l'UE depuis 2021. -

Venezuela
Wallaby a répondu à un(e) sujet de tharassboulbah dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/11/maria-corina-machado-nobel-peace-prize-venezuela-escape Le Wall Street Journal a rapporté que Machado avait commencé sa fuite lundi, portant une perruque et un déguisement, alors qu'elle s'échappait de la cachette de Caracas où elle s'était réfugiée depuis que Maduro avait été accusé d'avoir volé l'élection présidentielle de juillet 2024 à son mouvement. Elle aurait ensuite entamé un voyage en voiture de 10 heures, traversant 10 postes de contrôle militaires, pour se rendre dans un village de pêcheurs où elle a pris un bateau en direction de Curaçao. De là, Machado a pris un avion d'affaires pour Bangor, dans l'État américain du Maine, avant de s'envoler pour Oslo. Le Venezuela a une longue histoire de leaders de l'opposition qui ont perdu leur influence après s'être exilés, parmi lesquels Leopoldo López et Juan Guaidó, le jeune député qui a mené la dernière tentative majeure pour destituer Maduro en 2019. Un éminent journaliste de la chaîne publique vénézuélienne Telesur a qualifié la cérémonie du Nobel de « funérailles politiques » pour Machado. -

ZEE française La France d'Outre-mer et son voisinage
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Gibbs le Cajun dans Politique etrangère / Relations internationales
La « route la plus chère du monde » à la Réunion https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_route_du_Littoral Cette route gagnée sur la mer d'une douzaine de kilomètres relie Saint-Denis à La Possession en remplaçant l'ancienne route du Littoral, trop exposée aux éboulis de la falaise au pied de laquelle elle se trouve et aux houles cycloniques et australes. L'avant-projet sommaire est approuvé le 5 juillet 2011 pour un coût du projet de 1 660 millions d'euros (base décembre 2011), soit 130 millions d'euros par kilomètre, à comparer aux 6 millions que nécessitent en moyenne un kilomètre d'autoroute en rase campagne[note 1],[8],[9]. Ce coût élevé vaut à la Nouvelle route du Littoral le surnom de « route la plus chère au monde »[10]. Le 28 août 2022, la nouvelle route est partiellement ouverte, sur une section de 8,7 km et dans un seul sens[21]. L'ouverture complète a lieu le 1ᵉʳ mars 2023, date qui acte également la fermeture de l'ancienne route du littoral sur cette portion[22]. À la mi février 2022, la nouvelle présidente du conseil régional Huguette Bello annonce sa volonté que la section La Possession-Grande Chaloupe prévue pour être construite sous la forme d'une chaussée le soit finalement sous la forme d'un viaduc similaire à celui de la section Le Barrachois-Grande Chaloupe[19]. Le coût de ce pont est estimé entre 500 et 700 millions d'euros et son ouverture est prévue sept ans après les démarches administratives et études préalables, soit au mieux pour 2029 ou 2030[19]. La nouvelle route du Littoral serait alors constituée d'une succession de trois viaducs, les chaussées se limitant aux portions de raccordement aux extrémités des différents viaducs[19]. L'un des arguments invoqués pour le choix de cette solution est notamment liée au passage du cyclone Batsirai début février 2022 dont les vagues ont en partie submergé la route du Littoral construite en remblai — obligeant à sa fermeture et à sa rapide remise en état[20] — alors qu'elles sont passées sans contrainte sous le viaduc du Littoral qui n'a pas été affecté par le passage du cyclone[19]. -

Venezuela
Wallaby a répondu à un(e) sujet de tharassboulbah dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.jean-jaures.org/publication/vox-carrefour-des-extremes-droites-americaines-europeennes-et-israelienne/ (3 juillet 2024) Jean-Jacques Kourliandsky - Vox, carrefour des extrêmes droites américaines, européennes et israélienne La première initiative « internationaliste » concrète prise par Vox a été l’appel à signer une missive, en 2020 : la « Lettre de Madrid » (la Carta de Madrid). Cette Lettre prétendait rassembler sur les principes et valeurs signalés précédemment, et afin de leur donner une légitimation internationale, des personnalités de deuxième rang, originaires de l’ibéro-sphère, mais aussi d’Europe et d’Amérique du Nord, susceptibles d’avoir un futur de gouvernement. Vox a sollicité à cet effet un éventail de figures d’avenir, en quête de notoriété, représentatives de l’espace des extrêmes droites européennes, ibéro-américaines et nord-américaines. Le choix qui a été fait s’est avéré grosso modo pertinent : ont en effet signé des Argentins, avec notamment Javier Milei, alors député, des Boliviens, des Brésiliens, avec le sénateur Eduardo Bolsonaro, des Chiliens, dont José Antonio Kast, des Colombiens, des Costariciens, des Cubains, avec la dissidente et écrivaine Zoe Valdés, des Équatoriens, des Honduriens, des Mexicains – du parti PAN pour l’essentiel –, des Paraguayens, des Péruviens, avec Rafael Lopez Aliaga, devenu maire de Lima, des Salvadoriens, des Uruguayens, des Vénézuéliens, avec Antonio Ledezma, ancien maire de Caracas, et Maria Corina Machado, qui est depuis 2023 la personnalité d’opposition la plus populaire. Des Européens ont également cosigné cet engagement, comme l’Espagnol Santiago Abascal, la Française Marion Maréchal, l’Italienne Giorgia Meloni, le Grec Emmanouil Fragkos (élu député européen en 2019), le Néerlandais Derk Jan Eppinkle (journaliste et ancien député européen), ou le Portugais André Ventura (président du parti Chega). https://fr.euronews.com/my-europe/2025/02/08/reunie-a-madrid-lextreme-droite-europeenne-sen-prend-aux-partis-traditionnels-de-lue (8 février 2025) Réunie à Madrid, l'extrême droite européenne s'en prend aux partis traditionnels de l'UE Ils ont également accueilli Kevin Roberts, président du groupe de réflexion conservateur américain The Heritage Foundation, et diffusé des messages vidéo de la politicienne vénézuélienne María Corina Machado et du président argentin Javier Milei. https://www.informnny.com/news/world-news/ap-venezuelan-opposition-leader-machado-will-not-attend-peace-prize-ceremony/ (11 décembre 2025) Des personnalités latino-américaines de premier plan ont assisté mercredi à la cérémonie [du prix Nobel à Oslo] en signe de solidarité avec Machado, notamment le président argentin Javier Milei, le président équatorien Daniel Noboa, le président panaméen José Raúl Mulino et le président paraguayen Santiago Peña. https://www.rfi.fr/fr/podcasts/débat-du-jour/20251210-maria-corina-machado-est-elle-l-avenir-du-venezuela (10 décembre 2025) Et si le régime chaviste tombe, est-ce Maria Corina Machado qui incarnera la transition ? Pour en débattre : - Yoletty Bracho, maîtresse de conférences contractuelle en Science Politique à l’Université d’Avignon, spécialiste du Venezuela et des migrations en Amérique Latine - Serge Ollivier, historien, chercheur associé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, spécialiste de l’histoire récente du Venezuela - Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine et des Caraïbes de la Fondation Jean-Jaurès. -
https://unherd.com/newsroom/california-job-cuts-will-hurt-gavin-newsoms-white-house-run/ (10 décembre 2025) Les employeurs de Californie ont annoncé plus de 170 000 suppressions d'emplois cette année, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière. Plus de 75 000 de ces suppressions ont été effectuées dans le secteur crucial des technologies. Aucun autre État en dehors de Washington DC n'a supprimé autant d'emplois, et la Californie souffre désormais du taux de chômage le plus élevé des États-Unis, à 5,5 %. Mais ce n'est pas une nouveauté. L'État subit une hémorragie d'emplois dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, la construction et les services aux entreprises depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Cette année, selon le LA Times, des milliers d'employés d'Amazon, Meta, Paramount et Warner Bros ont été licenciés. Pire encore, de nombreux emplois dans le secteur technologique sont délocalisés. Le Texas est en tête, suivi de la Floride, tandis que les États du sud, notamment le Tennessee et la Géorgie, enregistrent des gains importants. L'un des facteurs à prendre en compte est que les prix de l'énergie en Californie, parmi les plus élevés du pays, nuisent à son industrie de l'IA. Des entreprises telles que Nvidia et Samsung cherchent désormais à implanter des centres de données dans des endroits où les prix sont moins élevés, afin d'être mieux placées pour développer des puces et des processeurs avancés. Par exemple, l'université du Texas à Austin prévoit de créer un nouveau centre de calcul quantique de grande envergure, tandis que des États riches en énergie, comme la Pennsylvanie, cherchent désormais à développer l'IA afin de redynamiser les secteurs industriels traditionnels. Cela fait essentiellement de la Californie un modèle non pas de prospérité partagée, mais d'oligarchie, combinée à une pauvreté de masse, à une diminution des opportunités et à un déclin des infrastructures.
-
Cf
-

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Cela corrobore ce que disait Wolfgang Munchau : J'entends dire que les hôtels de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont remplis d'Américains qui espèrent conclure des accords lucratifs avec la Russie. C'est un ironique coup du sort, car ce sont les États-Unis qui ont tenté de forcer l'Allemagne à abandonner le gazoduc de la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Aujourd'hui, on parle de l'intervention des Américains en tant qu'intermédiaires pour vendre du gaz russe à l'Allemagne. Cela ne s'invente pas. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/12/10/en-ukraine-la-cession-du-donbass-le-dilemme-de-zelensky_6656752_3210.html Une source officielle, citée mardi dans un article du quotidien économique et financier britannique Financial Times, affirme ainsi que Donald Trump espérerait un accord « d’ici à Noël ». -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
https://responsiblestatecraft.org/ndaa-europe/ (8 décembre 2025) Publié dimanche, ce compromis entre les versions précédentes du National Defense Authorization Act de la Chambre des représentants et du Sénat empêcherait le Pentagone de réduire ses effectifs en Europe à moins de 76 000 soldats pendant plus de 45 jours. Passé ce délai, le secrétaire à la Défense et les dirigeants du Commandement européen des États-Unis devraient démontrer au Congrès qu'ils ont consulté les alliés de l'OTAN et que leur décision est conforme aux intérêts de la sécurité nationale américaine. -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/live/2025/12/10/en-direct-guerre-en-ukraine-la-russie-juge-les-propos-de-donald-trump-sur-le-rapport-de-force-avec-kiev-conformes-a-sa-vision-du-conflit_6656313_3210.html Noël Reports avertit d un projet de loi "sortie de l'OTAN" de Thomas Massie, représentant US. Fait confirmé par la presse US. Avez vous des infos ? Dans un message sur les réseaux sociaux, cet élu du Kentucky à la Chambre a écrit : « L’OTAN est un vestige de la guerre froide. Les Etats-Unis devraient se retirer de l’OTAN et utiliser cet argent pour défendre leur pays, et non des pays socialistes. J’ai présenté aujourd’hui la résolution HR 6508 visant à mettre fin à notre adhésion à l’OTAN. » Mais Thomas Massie est un critique féroce de Donald Trump – il a notamment critiqué le Big Beautiful Bill Act ou soutenu l’Epstein Files Transparency Act – ce qui a conduit le président à soutenir Ed Gallrein, un ancien officier des Navy SEAL, pour une primaire républicaine. Lors de son premier mandat, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises, en privé, la menace de retirer les Etats-Unis de l’OTAN, rapportait le New York Times en 2019. Plus récemment, Elon Musk et certains élus républicains se sont lancés dans une course à l’échalote autour du concept d’« AmerExit ». Comme le rapporte Politico, l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN, Matthew Whitaker, a laissé entendre que l’Allemagne devrait reprendre le poste de plus haut responsable militaire de l’OTAN occupé actuellement par un Américain, à un moment où Washington recentre son attention sur l’Arctique et l’Indo-Pacifique. Mais même si l’administration Trump souhaite quitter l’OTAN, le Congrès américain pourrait s’y opposer. En effet, les projets de loi sur la défense adoptés à la fois par la Chambre et par le Sénat veulent limiter une baisse des troupes en Europe, malgré la volonté de l’administration Trump. Une loi impose au Pentagone de maintenir au moins 7 000 militaires sans accord préalable du Congrès et consultation de l’OTAN. Les parlementaires craignent qu’un retrait n’encourage Moscou et veulent empêcher Washington d’abandonner le commandement militaire suprême de l’OTAN en Europe. -

Guerre Russie-Ukraine 2022+ : géopolitique et économie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Skw dans Politique etrangère / Relations internationales
Karaganov déteste l'Europe. Quelqu'un en doutait ? C'est un scoop ? Voilà ce qu'il disait plus concrètement s'agissant du sujet de ce fil : 1er avril 2025 Que veut la Russie ? À quoi ressemble une victoire en Ukraine ? 16:00 Écraser la colonne vertébrale morale de l'Europe, ou des Européens, qui pour la troisième fois en 100 et quelques années conduisent le monde vers une troisième guerre mondiale. Ils sont désespérés, ils sont des malades mentaux, ce sont eux la véritable menace. Nous ne voulons pas prendre toute l'Ukraine : que Dieu nous en préserve ! Cela a été un boulet aux pieds soviétiques en termes de volumes de subventions. Non merci. Mais je pense que nous allons nous réunifier avec les régions proprement russes. Et ensuite nous aimerions avoir une zone tampon totalement démilitarisée et neutralisée à partir de ce qui reste de l'Ukraine. Mais le problème n'est pas l'Ukraine. Le problème, c'est les élites européennes, qui se meuvent vers l'Europe si j'ai bien compris, qui sont désespérées, qui ont perdu tout ce qu'elles espéraient, et qui conduisent leurs pays vers une grande guerre. Je veux dire : ce qui est en train de se passer en Europe est incroyable. C'est pire non seulement que la période précédant 1914, la première guerre mondiale, mais c'est pire que la période précédant la seconde guerre mondiale. Je suis historien aussi, quoique pas du même calibre que le professeur Mearsheimer, mais l'hystérie anti-russe y est pire que dans l'Allemagne hitlérienne. [normal, il y avait le pacte Molotov-Ribbentrop] 37:48 Nous avons un but, qui est d'éliminer l'Ukraine en tant que fer de lance proche du coeur de la Russie, en tant que fer de lance occidental. Il sera éliminé. Totalement démilitarisé, nous espérons. Notre autre but est de saper les Occidentaux, aujourd'hui principalement les Européens qui se sont faits nos ennemis. À la fin du jeu, nous devrons avoir écrasé la colonne vertébrale morale de cette Europe. J'espère que nous pourrons ensuite les laisser se battre entre eux, ou se comporter amicalement entre eux, peu importe. Nous ne sommes plus intéressés. Notre chemin vers l'Europe est fini. Dieu merci ! Cela a duré trop longtemps : 130 années superflues ! Nous disons « au revoir » avec enthousiasme. Bien sûr nous sommes culturellement en partie européens, et nous aimons, comme a dit Dostoïevski, les saintes tombes de l'Europe. Je les aime aussi. J'ai un appartement à Venise, que j'espère pouvoir revisiter avant de mourir. Pensez-vous que les Russes vont s'emparer d'Odessa ? Pensez-vous qu'ils vont prendre Kharkhiv ? Vous avez dit, et je crois selon ma propre perspective que vous avez raison, qu'il serait déraisonnable pour la Russie de conquérir l'ensemble de l'Ukraine et de l'annexer à la Russie. Qu'est-ce qui selon vous est la portion de territoire idéale que les Russes devraient prendre à l'Ukraine pour assurer la sécurité de la Russie ? 41:50 Les quatre oblast et la Crimée sont le minimum. Ensuite il devrait y avoir une très large zone démilitarisée contrôlée par les Chinois, les Arabes, etc... La priorité est de rétrocéder nos provinces de la Mer Noire, qui ont été partie intégrante de la Russie culturellement, politiquement et économiquement. 42:49 Ca va prendre du temps avant que nous ne puissions mettre un terme à cette guerre, car à ce stade les Européens voudront mettre le feu à des crises les unes après les autres, mais la meilleure solution est l'Est du Dniepr et le Sud. Mais cela pourrait être coûteux, à la fois pour la résurrection de ces territoires, la rééducation de leurs populations, et en termes de pertes militaires. Nous essayons de limiter les pertes au maximum. -

Mexique
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.cbsnews.com/news/national-guardsman-kills-fellow-service-members-mexico/ (9 décembre 2025) Un membre de la Garde nationale mexicaine a abattu trois de ses collègues dans une caserne ce week-end dans l'État de Michoacán, dans l'ouest du Mexique, où le gouvernement a renforcé les forces de sécurité à la suite de récents meurtres très médiatisés. La fusillade s'est produite samedi, quelques heures après l'explosion d'une voiture piégée à Coahuayana, dans l'État de Michoacán, qui a tué cinq personnes devant un poste de police local. Selon Héctor Zepeda, commandant de la police communautaire, l'explosion a été si puissante que des restes humains ont été dispersés dans toute la zone. L'explosion et les tirs de la Garde nationale sont survenus alors que le gouvernement fédéral avait renforcé les mesures de sécurité dans l'État, envoyant des troupes supplémentaires après deux assassinats très médiatisés. Le mois dernier, Sheinbaum a envoyé 2 000 soldats supplémentaires à Michoacan, en plus des 4 300 soldats permanents et des 4 000 soldats déployés dans les États voisins, à la suite des assassinats d'un représentant très actif des producteurs de citrons verts et d'un maire populaire qui s'opposait aux cartels. L'assassinat du maire d'Uruapan, Carlos Manzo, a déclenché deux jours de manifestations menées par des jeunes en novembre, au cours desquelles les manifestants ont incendié des bâtiments publics et affronté la police, faisant plus de 100 blessés. https://www.theguardian.com/world/2025/dec/01/mexico-kill-drug-trafficker-el-pichon-pedro-inzunza-coronel (1er décembre 2025) Pedro Inzunza Coronel, alias « El Pichón », a été tué lors d'une opération antidrogue menée par la marine mexicaine à Sinaloa. Avec son père, Pedro Inzunza Noriega, Coronel était l'un des plus grands trafiquants de fentanyl du Mexique. L'année dernière, les autorités mexicaines ont mené des raids dans plusieurs lieux contrôlés par le duo et saisi plus de 1,65 tonne de drogue, ce qui représente la plus importante saisie de fentanyl au monde. -

Bielorussie. Présent et avenir.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tetsuo dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ledevoir.com/monde/europe/940086/quand-je-dois-apprendre-fils-ou-frere-est-mort-on-lance-quoi (9 décembre 2025) Membre du bataillon Volat, Dzianis Urbanovič reprend des forces, en convalescence à Kiev. Il affiche un teint blême, un corps usé, l’âme écorchée par trop de compagnons d’armes morts au front. La guerre lui a perforé un poumon, laissé des problèmes d’estomac. Il a déjà failli partir pour de bon. Une fois, on l’avait déclaré mort cliniquement « pendant une minute et deux secondes ». Il dit s’être senti comme transporté, « avec cette sensation de voler, de plonger dans l’obscurité, puis de revenir à quelque chose de lumineux ». Soldat respecté, il n’est pas simplement connu pour ses faits d’armes sur le champ de bataille. Lors de sa jeunesse militante, il y a une dizaine d’années, M. Urbanovič formait déjà l’avant-garde de la résistance au régime de Loukachenko. On le connaissait alors comme l’un des gardiens de la mémoire de la forêt Kourapaty, en lisière de Minsk, lieu d’exécution de l’intelligentsia biélorusse lors des purges staliniennes de la seconde moitié des années 1930. Une époque qui paraît lointaine pour le soldat, qui fit l’expérience des geôles biélorusses, avec des dizaines de kilos en moins. Au début de la guerre, drapé d’une certaine naïveté, il brûlait d’envie de se rendre en Biélorussie pour « faire quelque chose » sur place. Dzianis Urbanovič ne se fait guère d’illusion, « il n’y a malheureusement aucun moyen démocratique de changer quoi que ce soit en Biélorussie, cela ne peut être fait que par la force ». Et il sait aussi que déloger la dictature dans son pays ne sera pas aisé, surtout face à Moscou qui risquerait d’y intervenir militairement. « Il est facile de dire “libérer la Biélorussie”. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Après tout ce que j’ai vu ici, pendant cette guerre, les cités en ruine, Bakhmout, je ne souhaite pas forcément voir quelque chose de semblable en Biélorussie », avoue-t-il. Il rêve de pouvoir rentrer dans son pays, pour humer de nouveau les conifères de Kourapaty et, pourquoi pas, mener des fouilles archéologiques dignes de ce nom sur ce lieu méprisé par la dictature de Minsk. Il espère rester en vie, aussi, afin de pouvoir raconter l’histoire de « ceux qui ont sacrifié leur vie ici de manière anonyme, et dont les corps reposent toujours dans la terre du Donbass ». -

Bielorussie. Présent et avenir.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Tetsuo dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.ledevoir.com/monde/europe/940116/entre-ukraine-opposition-bielorusse-dialogue-reste-limite (9 décembre 2025) C’est un cheval de bataille de l’opposante numéro un au régime d’Alexandre Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaïa : « Sauver la réputation du peuple biélorusse », largement opposé à la guerre, selon elle, en le dissociant du potentat de Minsk. « Nous ne pouvons pas fournir [à l’Ukraine] des armes ni des milliards, comme le font les Européens ou les Américains, notre solidarité est indéfectible », a lancé au Devoir la chef des forces démocratiques — exilée à Vilnius, capitale lituanienne — rencontrée à l’automne en marge d’un sommet sur la sécurité. Or, depuis le début de l’invasion russe, la leader peine toutefois à se faire entendre par le gouvernement ukrainien. « Volodymyr Zelensky et son équipe ne voient aucun bénéfice politique concret à tirer de Tikhanovskaïa, et la situation au sein des forces démocratiques [minées par les divisions internes] n’incite pas Kiev à revoir son approche », souligne le politologue ukrainien Yevhen Mahda. L’analyste déplore toutefois le manque de stratégie de long terme des autorités ukrainiennes vis-à-vis de la Biélorussie. Car a contrario de l’Union européenne, qui a imposé plusieurs trains de sanctions contre Alexandre Loukachenko, les affaires ont continué de rouler entre Minsk et Kiev après le soulèvement populaire écrasé de 2020 en Biélorussie, jusqu’au déclenchement de la guerre. -

Cela chauffe en Centrafrique.
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Fenrir dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.jeuneafrique.com/1747417/politique/elections-en-centrafrique-un-quadruple-scrutin-a-haut-risque/ (9 décembre 2025) « Le fait qu’une série d’accords de paix aient été signés avec les groupes armés du Nord et de l’Est a créé des conditions d’apaisement qui n’avaient pas été observées depuis des années, » rappelle toutefois François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, au micro de RFI. Mais ces fragiles accords ont contraint le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un troisième mandat, à demander un appui sécuritaire renforcé à son homologue rwandais, Paul Kagame. -

Le Burkina Faso
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Coriace dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.jeuneafrique.com/1747700/politique/laes-denonce-une-violation-de-son-espace-aerien-apres-latterrissage-en-urgence-dun-avion-militaire-nigerian-au-burkina/ (9 décembre 2025) Un appareil de l’armée de l’air nigériane s’est posé « par précaution » à Bobo-Dioulasso L’appareil avait décollé de Lagos et se rendait au Portugal. -

Bénin
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Wallaby dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20230925-dans-le-nord-du-bénin-l-opération-militaire-mirador-face-à-la-pression-terroriste (25 septembre 2023) En mai 2019, l’enlèvement de deux Français au Bénin, et l’assassinat de leur guide béninois, fait monter le niveau d’alerte sécuritaire dans les départements du Nord. Depuis, le pays fait face à des attaques de terroristes implantés au Sahel qui cherchent à étendre leurs actions vers les pays du Golfe de Guinée. Pour contrer cette menace et sécuriser les frontières, l'armée a lancé, début 2022, l'opération Mirador. 3 000 militaires, dans ces zones dont certaines sont devenues difficiles d’accès pour les journalistes. L’état-major béninois a accepté d’y emmener plusieurs médias, dont RFI, pendant une semaine. [Grand reportage - 19 minutes] L'immense réserve [de Pendjari] qui accueillait en moyenne 6000 visiteurs chaque année est fermée aux touristes depuis un peu moins de 2 ans. [quelques rares touristes la visitent en 2025 grâce à la construction d'un aéroport - voir ci-dessous] https://www.kas.de/fr/web/sipodi/veranstaltungsberichte/detail/-/content/opperation-mirador-au-benin-l-etat-major-general-et-le-programme-sipodi-sont-en-phase (séminaire d’évaluation, tenu les 3 et 4 juillet 2024 à Parakou) Les échanges ont permis de répondre à plusieurs enjeux majeurs : Analyser les résultats de l’Opération Mirador et tirer des enseignements pour l’avenir. Identifier les faiblesses de l’opération et proposer des ajustements stratégiques. Renforcer les actions engagées et optimiser les modes de communication opérationnelle. Contrer la propagande terroriste en mettant en avant les succès de l’opération. Favoriser la confiance des populations en assurant une meilleure communication sur les efforts sécuritaires de l’État. En soutenant cette initiative, SIPODI contribue non seulement à la professionnalisation des forces armées africaines, mais aussi à une meilleure démocratisation de l’information en matière de redevabilité et de transparence. L’État-Major Général des Armées du Bénin a exprimé sa profonde reconnaissance envers la KAS et le Programme SIPODI pour leur soutien décisif dans l’organisation et la réussite de cet événement. https://www.benin-voyage-afrique.online/safari-afrique (2021 ?) Présentation du Pendjari Safari Lodge Votre hébergement est implanté à 50 km de l’entrée du parc au cœur du parc de la Pendjari, Il est alimenté par des panneaux solaires, et se situe en face d’une mare sur une colline, de la terrasse du Lodge vous observez les animaux venant s’abreuver Le Lodge fermera pour cette saison le 15 Aout 2022. Tente Deluxe dans le Parc de la Pendjari Détendez-vous le soir, après votre safari, dans une grande tente de 47 mètres carrés qui surplombe les points d'eau de la Pendjari. Cet tente safari, climatisée, dispose d’un coin salon avec bureau et sofa, d’une chambre avec un lit double équipé d’une moustiquaire, d’une salle bain avec douche eau chaude eau froide, toilette et une douche extérieure privée. source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/benin/#securite (8 décembre 2025) En raison d’activités possibles de groupes armés et du risque d’enlèvement, il est formellement déconseillé de se rendre dans : les zones frontalières du Burkina Faso et du Niger ; la totalité des parcs nationaux de la Pendjari et du W, les zones mitoyennes à ces parcs ; la ville de Banikoara et ses environs immédiats ; la frontière nord-ouest avec le Togo ; la frontière nord-est avec le Nigéria jusqu’aux environs de la ville de Nikki. https://theconversation.com/benin-pourquoi-les-djihadistes-ciblent-les-parcs-nationaux-253605 (mai 2025) Des attaques djihadistes coordonnées ont visé des positions militaires béninoises dans le parc national du W, le 17 avril 2025, au nord du pays. Le dernier bilan officiel fait état de 54 soldats tués, ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière jamais enregistrée contre l'armée béninoise. Quelques semaines auparavant, le 8 janvier, une attaque près de Karimama, dans la même zone, a coûté la vie à une trentaine de militaires. Ces attaques illustrent la menace grandissante qui pèse sur la partie nord du pays et en particulier sur cette aire protégée. Depuis 2019, en effet, le Parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin, est la cible privilégiée de groupes armés, notamment affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM). Située au nord du Bénin, la Réserve de biosphère de la Pendjari (RBP), également connue sous le nom de Parc national de la Pendjari, est la cible récurrente de groupes armés depuis 2019, tout comme ses environs. Plus de 120 militaires ont été tués tués entre 2021 et 2024. Sans compter les civils et le carnage sur la faune et la flore. Depuis 2018, les groupes Ansar-ul Islam, Serma, Sékou muslimou et Abou Hanifa opérant au Burkina Faso – assimilés à des djihadistes – agissent pour la plupart sous l’égide du JNIM, la branche d’Al Qaïda au Sahel. Des luttes sanglantes sont engagées pour conquérir des territoires forestiers spéciaux, ce que j’ai appelé le « djihadisme des aires protégées ». Les groupes armés travaillent avec les trafiquants d’essence frelatée (?) en provenance du Nigéria, appelée au Benin le “Kpayo”. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Kpayo : Il ne s'agit pas nécessairement d'un produit frelaté ou de mauvaise qualité.) Ils achètent chez eux, chaque semaine, des milliers de litre d’essence à des prix exorbitants. Les raisons politiques sont liées à l’absence de l’État, malgré l’opération anti-terroriste Mirador lancée en 2021 avec un déploiement de plus de 3000 soldats. Depuis la première attaque de 2019, plus de 120 millions de dollars ont été alloués pour la sécurité du pays. Or le nombre d’attaques et d’enlèvements a augmenté, malgré l’existence d’une unité spéciale pour lutter contre les insurgés dans la région Nord du Bénin. C’est dans le secteur de Porga, vers le Burkina Faso, que les Forces armées béninoises (FAB) maitrisent le plus les incursions meurtrières. Les collaborations sous-régionales entre États sont presque inexistantes. L’Initiative d'Accra, composée de 5 pays – Bénin, Burkina Faso, Ghana, Côte d’ivoire et Togo – lancée depuis 2017, semble stagner depuis la désintégration de certains États de la Cedeao. Une véritable force régionale capable de contrecarrer les activités de ces groupes armés est nécessaire. Le Bénin développe certes un partenariat militaire avec la France. Mais les querelles diplomatiques entre le Bénin et ses voisins – Niger et Burkina – et la politique ambivalente du Togo qui « menace » de rejoindre l’Alliance des Etats du Sahel (AES) – ne sont pas des facteurs favorisant une coopération régionale militaire efficace. Il y a une baisse significative du nombre de touristes qui ne se rendent presque plus par route au parc. Les cascades de Tanougou non loin du parc, les plus prisées par les touristes, sont pratiquement fermées au public. Avec l’aide des APN et des FAB, la sécurité du parc a été immensément renforcée car fortement militarisée – avec un « camp avancé » – à l’intérieur même du parc. Une piste d’atterrissage, sans impact sur la valeur universelle exceptionnelle, a été construite dans le parc depuis 2019. C’est d’ailleurs sur cette piste qu’atterrissent les aéronefs des rares touristes qui visitent le Pendjari aujourd’hui. Il n'est pas trop tard pour contrecarrer la montée du djihadisme dans cette zone. L'espoir est toujours permis si la Cedeao s’investit davantage dans la coopération militaire avec le Benin. A l'état actuel des choses dans le Sahel, il est quasi impossible pour un État de lutter seul contre les groupes armés qui sont souvent plus informés et maitrisent mieux les terrains d’opération que les États. Il faudrait une synergie politique et une volonté de cooperation commune; -

Australie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Philippe Top-Force dans Politique etrangère / Relations internationales
Tu penses que c'est une mauvaise idée ? -

Australie
Wallaby a répondu à un(e) sujet de Philippe Top-Force dans Politique etrangère / Relations internationales
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/12/09/en-australie-l-acces-aux-reseaux-sociaux-bloque-pour-les-adolescents-de-moins-de-16-ans_6656629_3210.html Les adolescents de moins de 16 ans sont officiellement interdits de réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat et Reddit ont l’interdiction de conserver les comptes d’utilisateurs d’Australie de moins de 16 ans ou d’en permettre la création. -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
https://legrandcontinent.eu/fr/2025/12/06/strategie-de-securite-nationale-americaine-le-plan-de-la-maison-blanche-contre-leurope-texte-integral/ Stratégie nationale américaine - texte intégral en français. J'ai lu ce texte en entier. Je dirais que pour l'essentiel, je n'ai pas été surpris car ce sont des propos que j'ai plus ou moins déjà lus dans la presse et les productions des think tanks républicains américains. Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est plus l'opinion de chercheurs indépendants, mais la politique officielle du gouvernement américain. Si je devais rencontrer un responsable de la Maison Blanche, la première chose que j'ai envie de lui dire est à propos de ce passage : Parmi les problèmes plus importants auxquels l’Europe est confrontée, citons les activités de l’Union européenne et d’autres organismes transnationaux qui sapent... (etc.) Pas besoin de lire la suite pour ce que j'ai à dire. Ce qui est implicite dans cette phrase, c'est que l'Union européenne est vue comme un organisme transnational comme un autre. On sait que les milieux politiques qui ont produit ce texte n'aiment pas les organismes transnationaux comme l'ONU, l'UNESCO, le GIEC, la CPI... dont l'actuel gouvernement américain fait tout pour se désengager. Le point que je développerais en face d'un responsable de la Maison Blanche, c'est que l'Union Européenne n'est pas une organisation transnationale comme une autre : c'est un embryon d'État fédéral européen, avec notamment une monnaie. Donc j'ai envie de lui dire : chiche ! Démantelez votre État fédéral ! Démantelez votre Constitution fédérale ! Démobilisez votre armée fédérale ! Restituez la souveraineté de chaque État. Donnez l'indépendance à Hawaii, à la Californie et au Vermont ! Et démantelez le dollar ! Et puis si cela donne de bons résultats, les Européens vous emboîteront le pas pour démanteler leurs propres institutions. -

[OTAN/NATO]
Wallaby a répondu à un(e) sujet de zx dans Politique etrangère / Relations internationales
(1) Je suis d'accord pour l'essentiel, même s'il ne faut pas négliger un courant atlantiste en France même. Il y a une intrication des économies, des dépendances technologiques, voire énergétiques, auxquelles nous ne pouvons pas renoncer facilement, et une volonté d'extraterritorialité du droit américain via le dollar qui a son origine en Amérique elle-même. (2) Pourrais-tu expliciter ? Je ne vois pas bien la différence entre atlantisme tout court et "néo". (3) Je vois mal comment ces "nationalistes" envisagent de nommer le territoire situé entre Dunkerque et Perpignan si le mot "France" doit être abandonné. Des nationalistes qui suppriment la nation, c'est bizarre. Tu veux probablement les critiquer, mais la caricature pour moi obscurcit plus qu'elle n'éclaire.